ACTUALITÉ
SOCIAL

Réforme des allègements de charges sociales patronales : les recommandations de la Cour des comptes
À compter de 2026, les trois dispositifs d’allègements généraux de charges sociales patronales (réduction du taux de cotisations maladie, du taux de cotisations famille et réduction dégressive générale) seront fusionnés au sein d’une réduction générale dégressive unique dont le plafond sera ramené à 3 Smic (lire notre article). Dans  un nouveau rapport, la Cour des comptes recommande de « calibrer le plafond d’éligibilité, l’assiette de calcul et le profil de la future réduction générale dégressive dans l’objectif de contribuer au retour à l’équilibre financier de la sécurité sociale ». Dans le détail, elle préconise notamment d’élargir l’assiette de calcul en y intégrant la participation et l’intéressement.
un nouveau rapport, la Cour des comptes recommande de « calibrer le plafond d’éligibilité, l’assiette de calcul et le profil de la future réduction générale dégressive dans l’objectif de contribuer au retour à l’équilibre financier de la sécurité sociale ». Dans le détail, elle préconise notamment d’élargir l’assiette de calcul en y intégrant la participation et l’intéressement.

L’astreinte peut être du travail effectif si les contraintes imposées au salarié le justifient
Un salarié, engagé comme employé d’exploitation polyvalent dans un hôtel, avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires se rapportant à ses périodes d’astreinte.
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Pour qu’il y ait astreinte, deux conditions doivent être réunies :
- son lieu d’exécution (hors interventions) ne doit pas être le lieu de travail du salarié ;
- les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, sans quoi la qualification de temps de travail effectif devrait être retenue.
En plus de ses 39 heures de travail hebdomadaires, le salarié effectuait, quatre nuits par semaine, des périodes d’astreinte de 23 heures à 6 heures (lundi et mardi matin) ou à 6h30 (samedi et dimanche matin) et demeurait, au cours de ces périodes, dans une chambre d’hôtel qui constituait son logement de fonction. Il soutenait que la totalité de ses périodes d’astreinte constituait du temps de travail effectif.
La demande du salarié avait été en partie rejetée par la cour d’appel. Pour les juges du fond, l’existence d’une borne automatique permettant aux clients d’accéder librement à l’hôtel 24 heures sur 24, sans avoir besoin de s’adresser au salarié de permanence, limitait de facto les interventions du salarié durant la nuit, bien que le salarié soit appelé à intervenir régulièrement durant ses périodes d’astreinte compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel.
Le salarié s’était alors pourvu en cassation.
Au soutien de ses prétentions, et s’appuyant sur la méthode de qualification des temps élaborée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE 9 mars 2021 aff. 344/19, D. J. c/ Radiotelevizija Slovenija), il faisait valoir que les conditions d’exécution de ses périodes d’astreinte ne lui permettaient pas de gérer librement son temps et de vaquer à des occupations personnelles lorsque ses services professionnels n’étaient pas sollicités.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, les juges du fond ne pouvaient pas faire partiellement droit à la demande du salarié sans vérifier, s’il avait été soumis, au cours de ces périodes d’astreintes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Autrement dit, les juges du fond ne pouvaient pas valablement statuer sur l’affaire en se contentant d’affirmer que le nombre d’interventions du salarié se trouvait limité en raison de la présence de la borne automatique.
Par cette décision, la chambre sociale rappelle une nouvelle fois la méthode de qualification des temps élaborée par la Cour de Justice de l’Union européenne, invoquée par le salarié, et confirme, par la même occasion, sa volonté de reprendre et d’appliquer cette méthode (arrêt du 26 octobre 2022 ; arrêt du 21 juin 2023).
► A notre sens, la publication de cet arrêt ne s’explique pas par la nouveauté de la solution mais peut-être plus par la volonté de la Cour de cassation de rappeler aux juges du fond la méthode à suivre.
Une période donnée peut ainsi être qualifiée d’astreinte ou de temps de travail effectif selon l’intensité des sujétions auxquelles le salarié est soumis durant celle-ci.
S’agissant d’un litige relatif à une période d’astreinte, les juges du fond doivent procéder à une analyse concrète, et, à notre sens, approfondie, des conditions d’exécution de celle-ci afin de déterminer si ces conditions constituent ou non des contraintes d’une intensité telle qu’elle justifie que la totalité des périodes d’astreinte soit qualifiée de temps de travail effectif.
En l’espèce, la présence du numéro de téléphone du salarié sur la borne d’accès, la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel qui pouvaient, le cas échéant, amener les clients à contacter plus fréquemment le salarié, le fait que celui-ci était le seul salarié de permanence devant répondre à l’ensemble des urgences des clients et des exigences de sécurité ainsi que la fréquence de ses interventions constituaient des éléments de l’appréciation de l’intensité des contraintes auxquelles le salarié était soumis. On perçoit bien la difficulté du travail à laquelle les juges du fond peuvent être confrontés en fonction des éléments à leur disposition. Il semble notamment que la société n’ait pas mis en place un cahier d’interventions rempli par le salarié et contrôlée par elle, alors même que ce document était prévu par le contrat de travail. Un tel document aurait pu notamment permettre aux juges du fond d’évaluer la fréquence et la durée moyenne des interventions.


Pas de contrat de sécurisation professionnelle en cas de départ volontaire sans licenciement
Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, si l’entreprise compte moins de 1 000 salariés, l’employeur doit proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement (C. trav. art. L 1233-66, al. 1). Les salariés non menacés de licenciement qui adhèrent volontairement au plan de départs dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont-ils concernés ? C’est la question qui était soumise, dans cette affaire, à la Cour de cassation.
La société employeur a conclu un accord collectif prévoyant un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un PSE sans licenciements contraints. Ce plan prévoyait la possibilité pour les salariés occupant des postes relevant de «groupes sensibles», de postuler à un départ volontaire. Si leur candidature était validée, ils bénéficiaient de diverses mesures d’accompagnement au reclassement externe.
Dans le cadre de cet accord, deux salariés qui avaient trouvé un emploi dans une autre entreprise ont signé une convention de rupture amiable du contrat de travail avec avenant de mise à disposition auprès de cette entreprise d’une durée équivalente à leur période d’essai. Le contrat de travail devait être rompu d’un commun accord le dernier jour de la mise à disposition, sous réserve de leur embauche définitive en contrat à durée indéterminée. À défaut, les salariés retrouvaient leur emploi au sein de la société employeur.
Les contrats de travail de ces deux salariés ont été définitivement rompus, leur période d’essai ayant été confirmée. L’employeur ne leur a pas proposé d’adhérer au CSP. Mais, considérant qu’il aurait dû leur faire cette proposition, Pôle emploi (devenu France Travail) lui a adressé un appel à contribution spécifique CSP, puis une mise en demeure par salarié. La société n’ayant pas donné suite, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte pour un montant de plus de 19 000 €. L’employeur a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A noter : Pour rappel, quand un salarié ayant au moins un an d’ancienneté adhère au CSP, l’employeur contribue au financement du dispositif en versant à France Travail une contribution équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 3 mois de salaire, majorée de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes (C. trav. art. L 1233-69, al. 1). En cas de non-paiement pas l’employeur, la contribution est passible de majorations de retard. Par ailleurs, si l’employeur manque à son obligation de proposer le CSP à un salarié, il doit verser à France Travail une contribution égale à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois lorsque l’ancien salarié adhère au CSP sur proposition de France Travail (C. trav. art. L 1233-66, al. 2).
La cour d’appel de Grenoble a donné tort à l’employeur, en s’appuyant sur les termes de l’article L 1233-3 du Code du travail. Ce texte dispose en effet que les règles relatives au licenciement économique s’appliquent à toute rupture reposant sur un motif économique, à l’exclusion de la rupture conventionnelle homologuée et de la rupture amiable dans le cadre visé par l’article L 1237-17 du même Code (accord de GPEC ou rupture conventionnelle collective). Selon elle, l’opération de mise à disposition des salariés visait bien à mettre fin aux contrats de travail, et l’employeur était tenu de proposer le CSP aux salariés.
La cour d’appel a donc validé la contrainte et condamné l’employeur à verser la contribution à Pôle emploi. Elle a également mis à sa charge les frais de signification de la contrainte, et l’a condamné à verser 2 000 € à Pôle emploi au titre de l’article 700 du CPC (CA Grenoble 11-1-2022 no 19/02008). L’employeur s’est pourvu en cassation, soutenant qu’il n’était pas tenu de proposer un CSP à ses anciens salariés.
La Cour de cassation, saisie du litige, donne raison à la société employeur, dans un arrêt destiné à être publié au bulletin de ses chambres civiles (pourvoi n° 22-11.901). La rupture du contrat de travail s’inscrivant dans le cadre d’un plan de départs volontaires sans aucun licenciement ne relève pas du champ d’application du CSP.
La Haute Cour, après avoir rappelé les textes applicables, déroule son raisonnement de la manière suivante :
– l’acceptation par le salarié du CSP est une modalité de licenciement (Cass. soc. 16-5-2013 n° 11-28.494 F-PB) ;
– le salarié doit être informé du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail (Cass. soc. 27-5-2009 n° 08-43.137), qu’il peut contester même s’il a adhéré au CSP (Cass. soc. 5-3-2008 n° 07-41.964) ;
– en revanche, la rupture pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires soumis au comité social et économique constitue une résiliation amiable du contrat de travail qui exclut l’application de la procédure de licenciement économique (Cass. soc. 2-12-2003 n° 01-46.540). Le salarié ne peut donc pas contester le motif économique de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement (Cass. soc. 26-6-2024 n° 23-15.498). D’ailleurs, l’employeur n’est pas tenu de lui adresser une lettre énonçant les motifs de la rupture (Cass. soc. 2-12-2003 précité).
Pour la Cour de cassation, les salariés n’étaient pas menacés de licenciement. Ils étaient volontaires au départ, leur candidature étant motivée par la conclusion d’un contrat de travail avec une autre entreprise. La rupture de leur contrat de travail était suspendue à la confirmation de leur période d’essai avec cette dernière. Elle en déduit que l’employeur n’était pas tenu de leur proposer un CSP, et annule donc la contrainte.
A noter : Selon l’Unédic, le CSP s’applique aux salariés visés par une procédure de licenciement économique, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, y compris les départs volontaires, départs négociés ou autres résultant d’un motif économique au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail (Circ. Unédic 2022-04 du 28-2-2022 no I, 1.2.2).
La Cour de cassation semble être en désaccord avec cette analyse, au moins s’agissant des plans de départs volontaires excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs fixés en termes de suppression d’emplois. Ce n’est pas parce que la rupture repose sur un motif économique qu’elle ouvre droit au CSP. Ce dispositif est étroitement lié au licenciement économique : sans licenciement, pas de CSP.


Métiers en tension : le ministre de l’intérieur impose une liste resserrée
Malgré plusieurs reports liés à l’instabilité gouvernementale puis aux divergences entre les ministres du travail et de l’intérieur, la liste des métiers et zones géographiques en tension permettant l’embauche et la régularisation des travailleurs étrangers a été finalement actualisée par l’arrêté du 21 mai 2025 publié au Journal officiel du 22 mai 2025.
Depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, cette liste doit être actualisée au moins une fois par an (article L.414-13, al. 2 du code des étrangers). Elle avait été généreusement complétée début 2024 pour le secteur agricole mais sa mise à jour intégrale était très attendue d’autres secteurs dépendant fortement des travailleurs étrangers, tels que la construction, l’hôtellerie, la restauration, le traitement des déchets, la logistique ou encore la santé et l’aide à la personne.
La nouvelle liste était d’autant plus attendue que la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a ouvert jusqu’au 31 décembre 2026 une nouvelle voie de régularisation exceptionnelle par le travail destinée exclusivement aux travailleurs exerçant des métiers en tension et que dans une circulaire récente l’actuel ministre de l’intérieur a recentré la régularisation par le travail sur les métiers en tension.
► Avant même la question de la régularisation par le travail, l’inscription sur la liste des métiers et zones géographiques dits « en tension » permet la délivrance d’une autorisation de travail à un étranger sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposée. En effet, une autorisation de travail n’est accordée, en principe, que si elle concerne un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et, lorsque l’emploi proposé ne relève pas de la liste des métiers en tension, une offre d’emploi doit avoir été publiée pendant trois semaines auprès du service public de l’emploi sans avoir pu être satisfaite (article R.5221-20, 1° du code du travail).
L’arrêté du 21 mai 2025 est entré en vigueur le 23 mai 2025, lendemain de sa publication auJournal officiel. Il abroge l’arrêté du 1er avril 2021 qui comportait la liste des métiers en tension applicable antérieurement.
L’annexe I reproduit la liste des métiers reconnus en tension dans chacune des 13 régions métropolitaines, sous la forme d’un tableau par région. En réalité ces tableaux, qui utilisent la nomenclature des familles professionnelles FAP, ne comportent pas des métiers, mais des familles professionnelles. Il convient donc de se reporter à l’annexe II pour trouver les métiers correspondants.
L’annexe II propose une table de correspondance entre les familles professionnelles figurant dans l’annexe I et les codes Rome du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, étant précisé que le plus souvent une même famille professionnelle regroupe plusieurs codes Rome et que c’est sur la base de ces codes que statuent les plateformes de main-d’oeuvre étrangère et les préfectures.
La liste antérieure, qui datait de 2021, comportait autour de 29 métiers en tension pour chaque région métropolitaine (sauf pour la Corse et la région Grand Est qui en comptaient respectivement 14 et 21). Début 2024, quatre métiers agricoles avaient été ajoutés pour l’ensemble des régions. Mais sur le terrain, cette liste était jugée en décalage avec les réalités de l’emploi. Lors des concertations régionales qui se sont tenues début 2025, les partenaires sociaux avaient respecté la limite de 40 métiers par région, qui était imposée par l’Etat. Dans ces conditions le projet d’arrêté qui leur a été présenté fin février 2025 avait beaucoup déçu. La liste finalement retenue n’a quasiment pas évolué par rapport au projet soumis aux partenaires sociaux.
La nouvelle liste comporte en moyenne 32 métiers reconnus en tension par région métropolitaine, avec néanmoins de fortes disparités. La Bretagne et la Normandie n’en comptent respectivement que 23 et 26, tandis que l’Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Auvergne-Rhône-Alpes se démarquent avec 41, 39 et 37 métiers en tension. Sans surprise, sur le plan qualitatif, la liste des métiers en tension concerne les secteurs dépendant des travailleurs étrangers (voir précédemment) et des emplois, soit réputés peu qualifiés et exigeant physiquement, soit très qualifiés comme en l’Île-de-France où la liste comporte de nombreux intitulés de métiers d’ingénieurs et de techniciens.
A cet égard, le communiqué du ministère du travail du 22 mai 2025, indique que le gouvernement a élaboré la nouvelle liste à partir du critère de tension de recrutement, mais également d’un critère de présence significative des travailleurs étrangers par rapport à la moyenne nationale.

Titres restaurant : une proposition de loi vise à pérenniser l’achat de produits alimentaires
Une proposition de loi, déposée, le 13 mai, par Karim Benbrahim (député socialiste de Loire-Atlantique), vise à « moderniser » le dispositif des titres restaurant.
Concrètement, le texte entend pérenniser la possibilité d’acheter des produits alimentaires non directement consommables. Une mesure qui permettrait de soutenir le « pouvoir d’achat des Françaises et des Français qui bénéficient de titres restaurant », mais aussi d’adapter ces titres à l’évolution « des modes de travail et de consommation ». Avec à la clef, un plafond journalier d’utilisation différencié, l’un pour l’achat de produits directement consommables dans les restaurants et les commerces de bouche ; l’autre pour les grandes et moyennes surfaces.
Pour rappel, la loi du 21 janvier 2025 prolonge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026, la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire, comme cela était possible jusqu’au 31 décembre 2024.

Inutile de dater les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit énoncer le motif invoqué par l’employeur à l’appui de la rupture (C. trav. art. L 1232-6). La jurisprudence exige que la lettre de licenciement soit motivée de manière suffisamment précise pour que le salarié comprenne les raisons de son éviction et que, en cas de litige, le juge puisse exercer son contrôle. Pour être considéré comme suffisamment précis, le motif doit être matériellement vérifiable (Cass. soc. 14-5-1996 n°s 93-40.279 et 94-45.499), c’est-à-dire concret : l’employeur ne peut pas se contenter de griefs vagues, d’éléments inconsistants, d’impressions ou de sentiments. En revanche, il résulte d’une jurisprudence constante que l’employeur n’est pas tenu d’indiquer, dans la lettre de licenciement, la date des faits qu’il invoque (voir par exemple Cass. soc. 11-7-2012 n° 10-28.798). C’est ce principe que rappelle, dans cette affaire, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-19.214)
Une salariée est embauchée en tant que collaboratrice par son mari, agent d’assurances. Une dizaine d’années plus tard, le couple engage une procédure de divorce, et la salariée est licenciée pour faute grave dans la foulée. L’employeur motive le licenciement par plusieurs fautes : son ex-épouse l’aurait dénigré à plusieurs reprises dans le cadre professionnel, aurait demandé à une collègue de travail de lui mentir sur ses heures d’arrivée au bureau, et aurait contesté de manière agressive plusieurs de ses décisions, notamment lorsqu’elle a été placée en activité partielle au moment de la crise sanitaire. La salariée, soutenant que ces motifs sont imprécis, l’attaque aux prud’hommes. La cour d’appel donne raison à la salariée et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse car, selon elle, les faits reprochés n’étaient pas datés ni circonstanciés, étaient formulés en termes vagues et ne constituaient pas des motifs précis et matériellement vérifiables de licenciement.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Après avoir rappelé que la datation des faits évoqués par l’employeur n’est pas exigée dans la lettre de licenciement, la Haute Cour indique qu’en cas de litige, l’employeur est en droit d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs sur lesquels il s’appuie (jurisprudence constante, voir notamment Cass. soc. 15-10-2013 n° 11-18.977).
A noter : Rappelons, d’ailleurs, que si l’employeur mentionne dans la lettre de licenciement le jour où les faits ont été commis, une erreur de date constitue une simple erreur matérielle qui n’a pas d’incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement (Cass. soc. 17-9-2014 n° 13-24.874).
Pour la Cour de cassation, qui exerce un contrôle lourd sur ce point, la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables qui pouvaient être discutés devant les juges du fond. La cour d’appel aurait donc dû vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, et exercer son pouvoir souverain d’appréciation des faits invoqués à l’appui de la rupture. C’est donc la cour d’appel de renvoi qui s’attachera à vérifier si les motifs invoqués dans la lettre de rupture justifiaient ou non le licenciement et, dans l’affirmative, s’ils caractérisaient une faute grave.
Exemple —————————————————————————————————————
Pour la Cour de cassation, la lettre de licenciement qui invoque des absences répétées ayant désorganisé le service est suffisamment motivée (Cass. soc. 25-1-1995 n° 93-46.010), mais pas celle qui se borne à mentionner des absences prolongées qui engendrent «de graves préjudices» (Cass. soc. 1-7-2009 n° 08-40.701). De même, la lettre qui fait état de divergences importantes entre le salarié et le conseil d’administration sur un dossier particulier est jugée précise (Cass. soc. 8-3-1995 n° 93-44.220), alors que celle qui se réfère à une mésentente, sans autre indication, ne l’est pas (Cass. soc. 5-2-2002 n° 99-44.383).

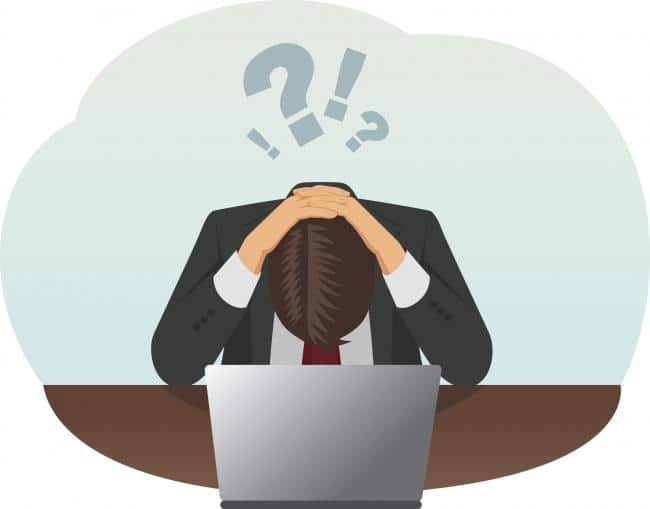
Le management causant une situation de souffrance au travail est nécessairement fautif
En l’espèce, un responsable d’édition ayant plus de 2 ans d’ancienneté se voit notifier un avertissement en raison de son management inadapté à l’égard de ses subordonnés. Il lui est reproché son comportement excessivement autoritaire, dénué ou manquant d’empathie, rigide et rugueux qui dévalorise et exerce une pression importante sur certains salariés dont il n’est pas satisfait, voire les casse psychologiquement. Son comportement ayant persisté, le salarié est licencié 9 mois plus tard pour faute grave. Il conteste son licenciement en justice et demande qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, le salarié obtient gain de cause devant la cour d’appel. Celle-ci juge que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse :
– bien que les faits reprochés soient établis (par des attestations de salariés, témoignages concordants et constatations médicales faisant état d’une souffrance au travail pour près de la moitié des salariés de l’établissement) et constitutifs d’une faute, de sorte que l’avertissement est justifié et proportionné, et que ce comportement litigieux ait perduré malgré l’avertissement ;
– dès lors que l’employeur n’a pas mené d’enquête interne sérieuse, ni entendu les chefs de services, ni organisé d’audit social, ni fait appel à des intervenants extérieurs ou mis en place une médiation et n’a pas aidé, assisté ou contrôlé le salarié dans l’exercice des fonctions managériales à la suite de l’avertissement.
L’employeur conteste la décision des juges du fond. Selon lui, le harcèlement moral du salarié envers ses subordonnés constitue une faute grave. En effet, son comportement a entraîné une dégradation importante de l’état de santé des salariés, et a persisté malgré l’avertissement et ses sommations de cesser immédiatement ces agissements et de traiter ses subordonnés avec humanité et respect.
La Cour de cassation (pourvoi n° 23-14.492) casse l’arrêt d’appel au visa notamment de :
– l’article L 1152-1 du Code du travail prohibant les agissements répétés de harcèlement moral ;
– l’article L 4122-1 du Code de travail selon lequel, conformément aux instructions données par l’employeur, il incombe au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Il en résulte que les salariés sont tenus à une obligation de vigilance en matière de santé et de sécurité : à défaut, ils peuvent faire l’objet d’une sanction.
S’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, la Cour de cassation relève que, même après l’avertissement, les méthodes de management du salarié ont continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés et le médecin du travail. Elle en déduit que ce comportement est de nature à caractériser une faute grave et ce, peu importe l’attitude de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Autrement dit, et contrairement à la position des juges du fond, les éventuels manquements de l’employeur en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ne permettent pas au salarié d’échapper à la qualification de faute grave.
A noter : Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que certaines méthodes de management constituent une faute grave, peu importe l’ancienneté importante du salarié ou l’absence de reproches. Tel est le cas lorsqu’un directeur d’établissement ayant 26 ans d’ancienneté a des méthodes de management humiliantes qui caractérisent un harcèlement moral (Cass. soc. n° 11-11.371) ou d’un directeur général d’une association en fonction depuis 5 ans qui a un management de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés (Cass. soc. n° 21-11.535 ; dans le même sens : Cass. soc. n° 22-14.385). Il en va de même d’une assistante marketing ayant 22 ans d’ancienneté et aucun passé disciplinaire dont le comportement est inadapté et harcelant envers ses collègues (Cass. soc. n° 22-23.620).
Ici, la Cour de cassation n’approuvant pas la décision des juges du fond aurait pu se contenter de casser l’arrêt d’appel et de laisser ainsi le soin à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur le sort du licenciement. Mais malgré le contrôle léger qu’elle exerce en principe sur la faute grave, elle décide de qualifier le management inadapté du salarié de faute grave et confirme ainsi la validité du licenciement prononcé à son égard.
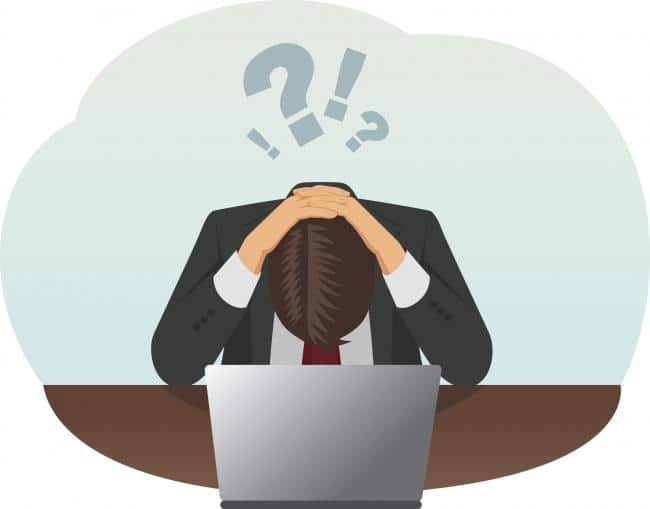

Engagement d’un auto-entrepreneur : attention à la période d’essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (article L.1221-20 du code du travail). Toutefois, pour que la période d’essai soit valable, elle doit être conforme à son objet et ne doit pas être utilisée pour s’affranchir des règles protectrices du salarié, en particulier en matière de licenciement.
En l’espèce, une agente commerciale a collaboré pendant neuf mois avec une société en qualité de travailleuse indépendante, sous le statut d’auto-entrepreneuse. Elle a ensuite été engagée en qualité d’agenceuse-vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une période d’essai de deux mois. Mais l’employeur a mis fin à l’essai au cours de cette période.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en nullité de la période d’essai et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande a été rejetée en appel et elle s’est pourvue en cassation.
► La salariée avait également formé une demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle effectuée en tant qu’indépendante, mais cette demande n’a pas prospéré.
Pour rejeter la demande en nullité de la période d’essai, la cour d’appel a jugé que la salariée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pas déjà pu apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Après avoir rappelé les dispositions légales relatives à l’objet de la période d’essai, elle décide que la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour y être rejugée.
► Lorsque la conclusion d’un contrat de travail intervient après l’exercice par le salarié d’une activité indépendante, la Cour de cassation a déjà jugé qu’une cour d’appel qui a constaté que les fonctions de la salariée, embauchée comme VRP, étaient les mêmes que celles exercées durant les sept années passées en tant qu’agente commerciale, en a exactement déduit qu’une période d’essai ne pouvait pas être prévue (arrêt du 21 janvier 2015).


Arrêt maladie : fin de la tolérance d’indemnisation des jours non prescrits en cas de prolongation
Depuis le 1er septembre 2024, la CNAM a modifié sa doctrine concernant la gestion des jours d’arrêts non prescrits, soit en général les samedi et dimanche, si une prolongation d’arrêt de travail ne suit pas immédiatement un arrêt précédent. Dorénavant, toute période sans prescription médicale entre deux arrêts de travail n’est plus indemnisée, quelle que soit sa durée, et même si elle fait ensuite l’objet d’une prolongation.
Rappelons qu’avant le 1er septembre 2024, la prescription de l’arrêt de travail en prolongation était bien prise en compte même si elle ne couvrait pas les 2 jours du week-end et le lundi. Ces journées étaient indemnisables. Si une prolongation ne suivait pas immédiatement un arrêt précédent, l’absence de prolongation était comblée si la période non couverte comptait :
• 1 jour (férié ou non férié) ;
• 2 jours (week-end) ;
• 2 jours (1 jour de week-end + 1 jour férié ou non) ;
• 2 jours (1 jour férié + 1 jour non férié) ;
• 3 jours (2 jours de week-end + 1 jour férié ou non).
Ce changement de doctrine est précisé sur le site internet de la CNAM, à la fin de la fiche «Indemnités journalières maladie : conditions d’obtention, calcul et modalités de versement», mise à jour en dernier lieu le 25 mars 2025, sans plus de détails. Certaines CPAM ont néanmoins apporté des précisions que vous trouverez ci-après.
Dès lors que l’interruption est inférieure ou égale à 2 jours calendaires, les règles applicables pour la période de prolongation sont :
• si la prescription de la prolongation de l’arrêt de travail est cochée initiale :
– pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ;
– application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ;
– une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.
Exemple :
Un salarié est absent du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025, puis du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet.
Sur les deux arrêts de travail, le médecin a coché arrêt initial.
Pour le premier arrêt, le salarié perçoit des IJ, après l’application du délai de carence du 30 juin au 2 juillet, pour les 3 et 4 juillet.
Faute de prescription, aucune IJ n’est versée pour les 5 et 6 juillet.
Pour le deuxième arrêt de travail, un nouveau délai de carence s’applique du 7 au 9 juillet et le salarié perçoit des IJ pour les 10 et 11 juillet.
• si la prescription de la prolongation de l’arrêt par le médecin est cochée prolongation :
– pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ;
– pas de nouveau délai de carence de 3 jours ;
– il n’est pas nécessaire de fournir une nouvelle attestation de salaire.
Exemple :
Un salarié est absent aux mêmes dates que dans l’exemple précédent, soit du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025, puis du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet.
Sur le deuxième arrêt de travail, le médecin a coché prolongation.
Pour le premier arrêt, le salarié perçoit des IJ, après l’application du délai de carence du 30 juin au 2 juillet, pour les 3 et 4 juillet.
Faute de prescription, aucune IJ n’est versée pour les 5 et 6 juillet.
Pour le deuxième arrêt de travail, il n’y a pas de nouveau délai de carence et le salarié perçoit des IJ du 7 au 11 juillet.
Dès lors que l’interruption entre l’arrêt de travail initial et la prolongation de l’arrêt est supérieure ou égale à 3 jours calendaires, ce sont les règles classiques d’indemnisation des arrêts maladie qui s’appliquent pour la période de prolongation quelle que soit la prescription cochée par le médecin (initiale ou prolongation) :
• pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ;
• application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ;
• une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.
Exemple :
Un salarié est absent du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025, puis du mardi 8 juillet au vendredi 11 juillet.
Pour le premier arrêt, le salarié perçoit des IJ, après l’application du délai de carence du 30 juin au 2 juillet, pour les 3 et 4 juillet.
Faute de prescription, aucune IJ n’est versée du 5 au 7 juillet.
Pour le deuxième arrêt de travail, un nouveau délai de carence s’applique du 8 au 10 juillet et le salarié perçoit des IJ uniquement pour le 11 juillet.
Jusqu’à présent, en cas de prolongation d’arrêt, en DSN il ne fallait jamais envoyer de nouveau signalement de nature » arrêt de travail « . Il suffisait en effet déclarer la nouvelle date de fin de l’arrêt en DSN mensuelle, au niveau de la rubrique » Date de fin prévisionnelle – S21.G00.60.003 » pour l’individu considéré (net entreprises, fiche no 1983). Cela doit désormais, nous semble-t-il, être réservé au cas où l’arrêt de travail est bien coché « prolongation » et où les deux arrêts ne sont pas interrompus par une période supérieure à 2 jours. «


Reclassement préalable au licenciement : la qualité des offres l’emporte sur leur quantité
Une entreprise de la grande distribution engage une procédure de licenciement économique et négocie un plan de sauvegarde de l’emploi par accord collectif majoritaire. Cet accord prévoit que chaque salarié doit se voir proposer au moins deux offres de reclassement dans le groupe, en privilégiant les postes situés au sein de l’établissement le plus proche de son domicile. Les salariés non reclassés, contestant la légitimité de leur licenciement, ont saisi le juge prud’homal.
Pour remplir son obligation de reclassement, l’employeur s’est appuyé sur une bourse de l’emploi en ligne, mise en place au sein du groupe, qui recensait l’ensemble des emplois vacants en France. Faisant valoir que cet outil était adapté pour collecter « en temps réel » les emplois disponibles en France en vue du reclassement, l’employeur a produit devant le juge la liste des postes recensés par cet outil à la date de conclusion de l’accord collectif majoritaire.
Pour la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, en s’appuyant uniquement sur cette bourse de l’emploi en ligne, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Les licenciements sont donc dépourvus de cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la diffusion des offres de reclassement n’est pas nécessairement personnalisée : elle peut aussi prendre la forme d’une liste (article L.1233-4, al. 4 du code du travail). Mais dans ce cas, la liste doit répondre aux critères fixés par l’article D.1233-2-1 du code du travail : elle doit recenser les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. En l’espèce, ces informations n’étaient pas données sur la bourse de l’emploi du groupe.
► Rappelons que la Cour de cassation a jugé récemment qu’à défaut de ces mentions, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt du 8 janvier 2025).
Par ailleurs, pour les juges, la seule présentation de deux offres de reclassement à chaque salarié ne suffit pas à établir le respect de l’obligation de reclassement, lequel suppose que l’employeur ait proposé l’ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement. Or en l’espèce, la liste produite par l’employeur devant le juge date de la conclusion de l’accord collectif majoritaire : les licenciements n’ont été notifiés que près d’un an plus tard.

