ACTUALITÉ
SOCIAL
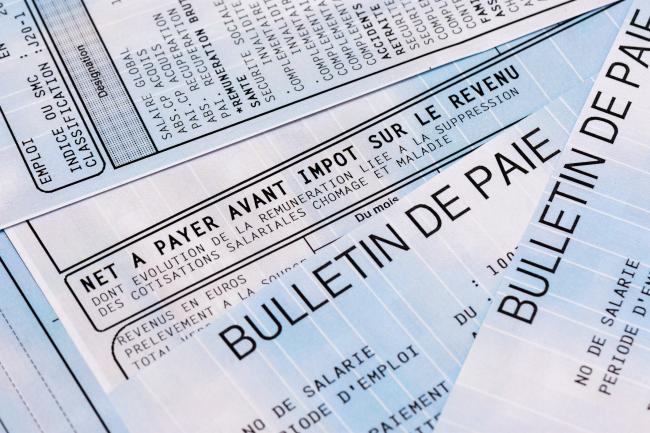
Les effets de la revalorisation du Smic sur les réductions des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales
Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil pour les périodes courant depuis le 1er novembre 2024, les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage bénéficient :
– d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, ramené de 13 % (taux de droit commun) à 7 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 2,5 Smic applicable au 31-12-2023 et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (articles L 241-2-1 et D 241-1-2 du code de la sécurité sociale) ;
– d’une réduction de 1,8 point sur le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, ramené de 5,25 % (taux de droit commun) à 3,45 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 3,5 Smic applicable au 31-12-2023 et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (articles L 241-6-1 et D 241-3-2).
L’application des dispositions des articles D 241-1-2 et D 241-3-2 du Code de la sécurité sociale implique la prise en compte de la valeur du Smic au 31-12-2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sur l’ensemble de l’année 2024.
Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a précisé qu’à titre indicatif, à compter du 1er novembre 2024, les plafonds de rémunération déterminant le bénéfice de ces réductions de taux correspondent respectivement à 3,3939 fois le Smic applicable au 1-11-2024 et 2,4242 Smic applicable au 1-11-2024
À noter. Le calcul de la réduction générale dégressive des cotisations patronales continue, en l’état de réglementation applicable, de se baser sur la revalorisation du Smic courant.
Le site net-entreprise.fr a précisé que, conformément à l’actualité publiée par le Boss le 31-10-2024 (ci-dessus), il est admis de pouvoir utiliser, pour la détermination de l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter du 1-11-2024, le Smic revalorisé au 1-11-2024, en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté, à savoir :
– pour les cotisations patronales d’allocations familiales : 3,3939 fois le Smic applicable au 1-11-2024 (au lieu de 3,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023).
– pour les cotisations patronales d’assurance maladie : 2,4242 fois le Smic applicable au 1-11- 2024 (au lieu de 2,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023).
La consigne DSN 1265 consiste donc en 2024 à déclarer dans la valeur du Smic portée en DSN (en bloc 79, sous le code « 01 ») celle seulement applicable pour le calcul de la réduction générale dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, et d’assurance chômage.
Ces éléments ne tiennent pas compte des effets éventuels complémentaires du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en cours de discussion.
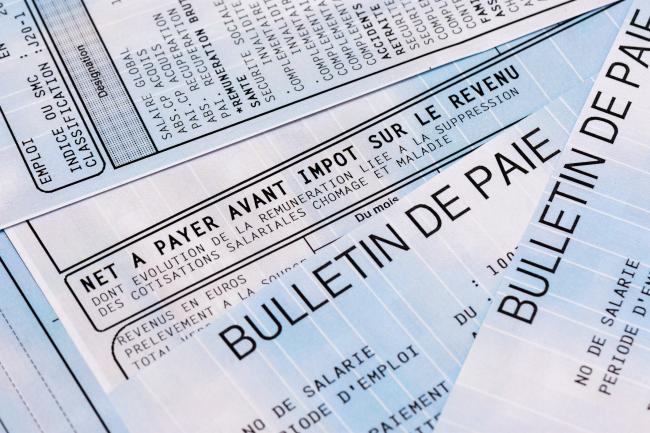

Les députés modifient considérablement le PLFSS pour 2025 avant le vote solennel
« L’Insee, tout comme la mission d’information de la Commission des finances sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, ont pointé les limites des dispositifs d’intéressement et de participation : ils profitent essentiellement aux salariés des grandes entreprises les mieux payés et créent un salariat à deux vitesses. Les primes (c’est notamment le cas des « »primes Macron » »), quant à elles, se substituent aux salaires. Les pertes pour la Sécurité sociale liées aux dispositifs de partage (participation, intéressement, plans d’épargne entreprise) sont estimés à 2,1 milliards d’euros pour 2024″. Tel est l’argument de députés LFI-NFP qui a séduit l’Assemblée nationale. Au point que cette dernière a adopté leur amendement déposé dans le cadre de la 1ère lecture du PLFSS pour 2025. Rappelons que la participation et l’intéressement sont (sous conditions) exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à CSG-CRDS au taux de 9,7 %. De plus, ils peuvent faire l’objet du forfait social de 20 % dans certaines situations (pour les primes de participation, dans les entreprises d’au moins 50 salariés ; pour les primes d’intéressement, dans les entreprises d’au moins 250 salariés).
Cet amendement va même plus loin. Il prévoit d’étendre l’assiette des cotisations de sécurité sociale à tous les dividendes perçus par les personnes afilliées au régime général des assurances sociales. Rappelons qu’actuellement les dividendes ne sont en principe pas soumis à cotisations sociales mais le sont au prélèvement social au taux forfaitaire de 17,2 %.
Autre amendement adopté par l’Assemblée nationale, l’augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine. Cette contribution passerait ainsi de 9,2 % à 12 % pour les revenus qui sont concernés par les articles L 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale.
La chambre basse s’oppose aussi à deux mesures clés voulues par le gouvernement. Tout d’abord celle emblématique qui concerne les allègements de cotisations patronales. Rappelons que l’exécutif juge les dispositions actuelles coûteuses pour les finances publiques et enclines à accentuer le phénomène de trappes à bas salaires. Mais sa réforme (voir les détails), qui reviendrait globalement à augmenter le coût du travail, a été intégralement rejetée.
Celle sur les charges sociales qui pèsent sur l’apprentissage a subi le même sort. Le gouvernement souhaite en effet assujettir ces rémunérations à la CSG et à la CRDS dès lors qu’elles dépassent la moitié du Smic. Il veut aussi, via un décret, abaisser le seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du Smic.
La question est de savoir quelle suite sera donnée sur ces sujets dans le contexte politique actuel très incertain. En particulier, l’Assemblée nationale va-t-elle maintenir ses positions lors du vote solennel en 1ère lecture sur l’ensemble du PLFSS pour 2025 qui est prévu aujourd’hui ? Autre question : le gouvernement laissera-t-il les débats se poursuivre ou engagera-t-il sa responsabilité au titre de l’article 49 alinea 3 de la constitution ?

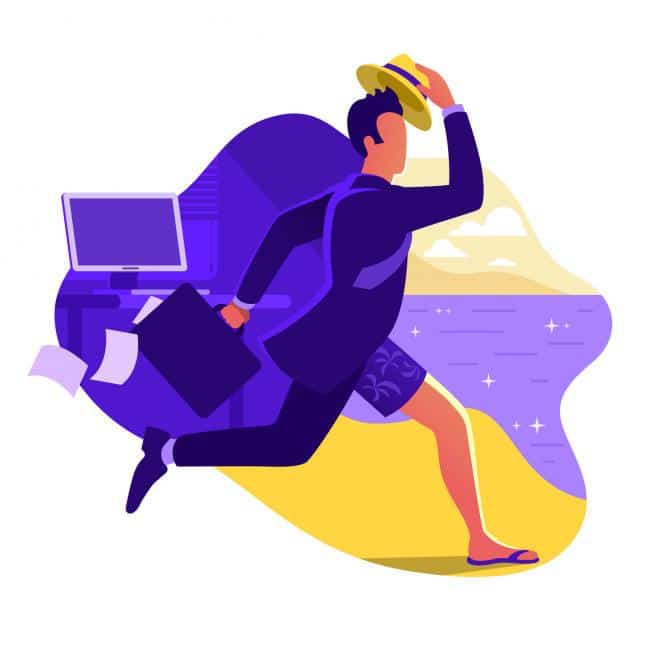
Sans réponse de l’employeur, le congé sabbatique, même demandé trop tard, est forcément accepté
Il résulte des articles L 3142-28 et suivants et D 3142-14 et suivants du Code du travail que, sauf modalités différentes prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche, le salarié informe son employeur au moins 3 mois à l’avance de la date et de la durée de son congé sabbatique. L’employeur y répond dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande du salarié. À défaut, son accord est réputé acquis.
La Cour de cassation (cassation n° 23-20.560) confirme ici que l’employeur qui ne répond pas à une demande de congé sabbatique est réputé accepter tacitement le congé, même dans le cas où le salarié a formulé cette demande hors délai (Cassation n° 06-43.866 ; Cassation n° 16-24.027). Il en résulte que l’absence du salarié, dans ces conditions, n’est pas fautive et ne peut pas justifier son licenciement.
A noter : La décision de la Cour de cassation est rendue en application de l’article L 3142-98 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi Travail du 8 août 2016. Ce texte prévoyait expressément que l’accord de l’employeur au départ du salarié en congé sabbatique était réputé acquis à défaut de réponse de sa part. Mais cette précision a été supprimée par la loi Travail. Cette suppression résultait manifestement d’une erreur de plume du législateur, puisqu’elle a été réintroduite par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21), à l’article L 3142-30, alinéa 2 du Code du travail.
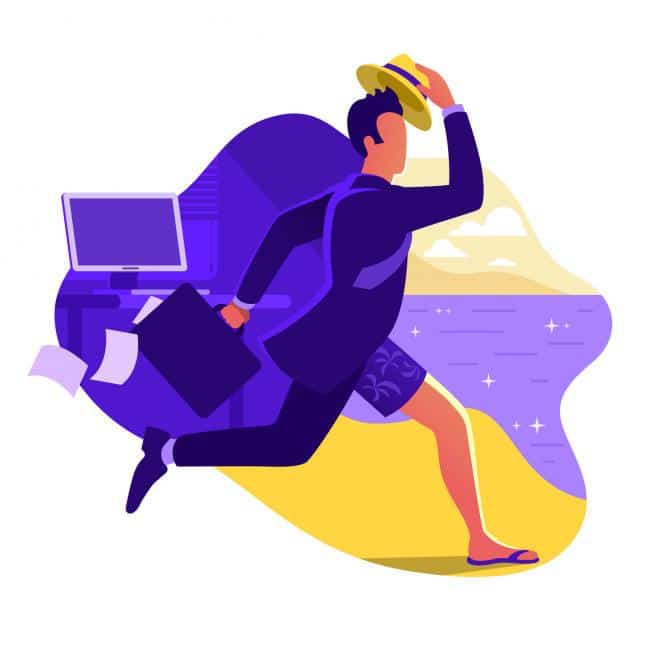
Les députés veulent augmenter la CSG sur les revenus du patrimoine
La semaine dernière, l’Assemblée nationale a adopté en séance un amendement au PLFSS pour 2025 qui relève la CSG sur les revenus du patrimoine. Le taux passerait de 9,2 % à 12 % pour les revenus qui sont concernés par les articles L 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale.

Assurance chômage et bonus-malus : les règles actuelles sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2024
Un décret du 30 juillet 2024 avait prolongé une nouvelle fois les règles actuelles d’assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024. Ce décret avait également prolongé jusqu’au 31 octobre 2024 le bonus-malus dont l’application n’était prévue que jusqu’au 31 août 2024.
Un nouveau décret en date du 29 octobre 2024, publié hier au Journal officiel, prolonge ces deux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2024.
Une prorogation qui laisse aux organisations syndicales et patronales le temps de poursuivre leurs négociations sur l’assurance chômage au siège de l’Unédic.

« Le rôle des managers est devenu plus difficile à exercer »
La crise du Covid a-t-elle fait émerger de nouveaux styles de management ?
Les prérogatives des managers restent les mêmes mais le contexte a changé : leur rôle est devenu plus difficile à exercer qu’auparavant. D’une part, ils doivent aujourd’hui composer avec les nouvelles aspirations de leurs équipes. Car pendant la crise, les salariés ont changé. Ils expriment aujourd’hui un rejet du management par le contrôle, un souhait d’autonomie dans leur organisation personnelle, et une envie de développement professionnel. Ces attentes, en gestation depuis longtemps, sont devenues des exigences.

D’autre part, le travail hybride a révélé certaines de leurs lacunes. Les interactions sont totalement différentes. En mode présentiel, on échange, on ajuste plein de petites choses en temps réel pour pallier le manque de consignes claires. En mode distantiel, les managers doivent faire preuve de beaucoup plus de rigueur, fixer des objectifs précis, avoir une vision claire des projets et s’assurer que l’équipe a compris et que chacun sait comment y contribuer pour ne laisser personne dans l’ambiguïté ou l’expectative.
Or, tous n’ont pas pris la mesure de ces nouvelles compétences. C’est tout particulièrement le cas des managers intermédiaires. D’autant qu’ils sont peu formés et peu soutenus. Ils se distinguent par une vulnérabilité particulière. Ils sont d’ailleurs parmi les plus touchés par l’absentéisme. Du jamais vu jusqu’ici.
Comment l’expliquez-vous ?

La pression est forte et toujours présente. Ils doivent faire face à des injonctions contradictoires : il n’y a pas une journée où ils entendent qu’ils doivent être bienveillants, empathiques à l’écoute. Mais en même temps, ils doivent faire « tourner la boutique », c’est-à-dire assurer le quotidien et, bien sûr, performer. La sociologue Marie-Anne Dujarier parle même de « surhumanisation des managers ». Or, les managers n’ont pas vocation à être des héros ou des héroïnes. Ils sont happés par l’opérationnel. Ils continuent à faire le job, garder les grands comptes, lancer des projets. Le management vient en plus, les tâches se superposent. Avec, à la clef, des journées à rallonge. Résultat ? Ils sont épuisés. Ce qui engendre de la souffrance au travail : s’il y a une théorie du ruissellement qui fonctionne, c’est bien celle du ruissellement managérial ! Quand le management dysfonctionne, toutes les strates inférieures sont affectées.
Or, à une époque où on veut retenir les talents et préserver leur motivation, il faut être attentif à ces situations, même si elles relèvent du ressenti, car elles génèrent de la sous-performance.
Les DRH ont-ils pris la mesure du problème ?

Ils reconnaissent que les managers ne savent pas tous faire leur métier de manager. Qu’ils sont « lost in management », comme l’affirmait le sociologue François Dupuy. Mais malgré cette prise de conscience, l’évitement est fréquent : les entreprises considèrent que le management est encore la voie royale pour progresser. Ce qui, au passage, écarte de nombreuses femmes moins intéressées par ces postes en raison des contraintes de leur vie privée.
On continue à confier les clefs du management aux meilleurs experts. Or, le meilleur ingénieur n’est pas forcément un bon directeur de laboratoire, le meilleur vendeur n’est pas forcément un bon chef de ventes. Etre manager c’est notamment faire le deuil de son expertise. Il faut y être préparé, et développer de nouvelles compétences : on cesse d’être le meilleur de son équipe, on devient celui qui accompagne le développement des talents de son équipe.
Tant que cette situation perdurera, le jeu sera triplement perdant : pour le manager, ses collaborateurs et l’entreprise.
Que préconisez-vous ?

Il faudrait tout d’abord reconnaître que le management est un métier qui s’apprend tout au long de la vie. Toutes les strates du management tireraient un grand bénéfice à suivre des formations dédiées, non pas sur étagère mais approfondies. Mais il faudrait aussi permettre des alternances entre management et expertises via, par exemple, la création de passerelles tous les quatre/ cinq ans qui faciliterait ces mobilités. Ces allers-retours apporteraient des compétences directement transférables à l’une et l’autre des fonctions exercées.
Pensez-vous que la fonction de manager ne fait plus rêver la jeune génération ?

C’est en partie vrai. Mais dans les faits, cette idée reste un mythe. La question du statut reste importante. J’enseigne à des jeunes de Sciences Po, d’écoles de management ou à des étudiants de master 2. Pour eux, cette fonction reste aussi attractive car elle permet d’emmener des équipes vers de nouveaux projets, de coordonner le travail, de faire bouger les lignes, de créer une ambiance positive, bienveillante. Ce sont des défis très motivants.


DSN de substitution : net-entreprises fixe le calendrier de déploiement
Les Urssaf sont chargées d’assurer la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs pour toutes les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement. Un décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 a organisé, à compter du 1er janvier 2024, ce dispositif de correction de la DSN, notamment la procédure de correction forcée à laquelle cette procédure peut aboutir, par la mise en oeuvre d’une DSN de substitution par l’Urssaf, remplaçant la déclaration faite par l’employeur. Le communiqué du 24 octobre 2024 précise les modalités concrètes de déploiement de cette faculté en prévoyant la mise en oeuvre, au préalable, de CRM de rappel.
Les entreprises sont en principe appelées à corriger leur DSN au fil de l’eau. Des comptes-rendus métiers (CRM) dits «normalisés» sont envoyés aux employeurs, chaque mois, en cas d’anomalies constatées. Ces derniers sont donc invités à consulter mensuellement ces CRM et à opérer les corrections soit, si cela est encore possible, la veille de l’échéance de la DSN (selon les cas, les 5 ou 15 du mois) jusqu’à minuit via une DSN «annule et remplace», soit à opérer la correction dans la DSN suivante.
Des CRM dits «de rappel» vont désormais être mis en œuvre. Ainsi, si l’Urssaf ou la MSA continuent de constater en début d’année N + 1 la présence d’anomalies non corrigées sur les mois de l’année N (et remontées dans les CRM normalisés Urssaf ou MSA), ils transmettront au déclarant un tel CRM pour l’informer des anomalies non encore corrigées.
En l’absence de correction de la part des déclarants, suite à l’émission de CRM de rappel, l’Urssaf (ou la MSA) pourra effectuer une DSN de substitution, cette possibilité restant un «dernier recours». Aussi, à terme, le processus proposé s’opèrera en plusieurs étapes :
– Mars N + 1 (au titre de l’année N) : envoi des CRM de rappel, avec signalement des anomalies accompagnées des valeurs de correction et identifiées comme susceptibles d’être subtituées en l’absence de corrections par l’employeur ;
– Avril/Mai N + 1 : correction des anomalies demandées ou, conformément au principe du contradictoire, opposition de l’employeur aux propositions de correction de ses anomalies de manière motivée (corrections à opérer au plus tard lors de la seconde échéance déclarative suivant la notification du CRM de rappel soit dans la majorité des cas, au plus tard dans la DSN déposée en juin) ;
– Mai/Juin de l’année N + 1 : si les anomalies n’ont toujours pas été corrigées au plus tard à l’échéance précisée ci-dessus et si les anomalies sont avérées et non contestées, l’Urssaf et la MSA réaliseront des «DSN de substitution» qui corrigeront les anomalies impactant les droits à retraite de base et complémentaire ;
– Après l’emission de la DSN de substitution : l’Urssaf et la MSA informeront l’employeur des corrections réalisées par un CRM d’information dédié.
En pratique, les premiers CRM de «rappel» seront émis en mars 2025, au titre de l’année 2024. Toutefois, le communiqué de net-entreprises précise que, « à ce stade, l’absence de correction des anomalies restituées au moyen des CRM de rappel ne donnera pas lieu à l’émission d’une DSN de substitution, laquelle n’interviendra qu’à partir de 2026 ». Ce n’est donc qu’en 2026 que le déploiement des DSN de substitution débutera en plusieurs phases :
– en mars 2026, les entreprises concernées seront destinataires d’un CRM de rappel au titre de l’année 2025 ;
– à compter de cette notification et jusqu’au plus tard en mai 2026 (aux échéances du 5 ou 15), l’employeur devra effectuer les corrections demandées ou s’y opposer ;
– si, à l’issue de cet échange, les anomalies sont avérées et non contestées par le déclarant ou non corrigées, l’Urssaf et la MSA réaliseront des DSN de substitution en mai/juin 2026 corrigeant les anomalies impactant les droits retraite de base et complémentaire des salariés ;
– les employeurs seront ensuite informés des corrections opérées via un CRM d’information dédié.
Ce déploiement est conforme à la feuille de route de l’Urssaf et de la DSN visant à mieux garantir la fiabilité des déclarations DSN.
A noter : Des DSN de substitution lors d’un redressement suite à contrôle sur place/sur pièce réalisé par les inspecteurs ou contrôleurs du recouvrement pourront être émises par les Urssaf dès 2025. Auparavant, les résultats des contrôles étaient transmis à la Cnav pour valorisation des droits à la retraite des salariés par l’intermédiaire d’une DADS. Selon le communiqué du 24 octobre 2024, ces DSN de substitution suite à un contrôle constituent une « modernisation des modalités d’échange d’informations entre organismes sans impact pour les déclarants ». Par ailleurs, selon le cahier technique de la DSN 2025.1.1, des DSN de substitution pourraient, dans un usage à venir, aussi être réalisées à la suite d’actions de lutte contre le travail illégal.

Déclaration en DSN d’un refus d’un CDI après un CDD
Dans une fiche consigne n° 2695, le site Net-entreprise détaille les modalités et les règles de valorisation de la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission – S21.G00.62.021 ».
L’employeur doit renseigner au moment de la fin du contrat de travail, à l’occasion du signalement de la fin de contrat de travail, la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission – S21.G00.62.021 », en la valorisant à « 01 – Proposition refusée », seulement s’il a proposé un CDI à un salarié, dans les formes et conditions prévues légalement, et que celui-ci a refusé.
Pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique doit être renseignée directement dans la DSN mensuelle. Pour les autres, elle doit être renseignée dans le signalement FCTU et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois M du signalement FCTU.
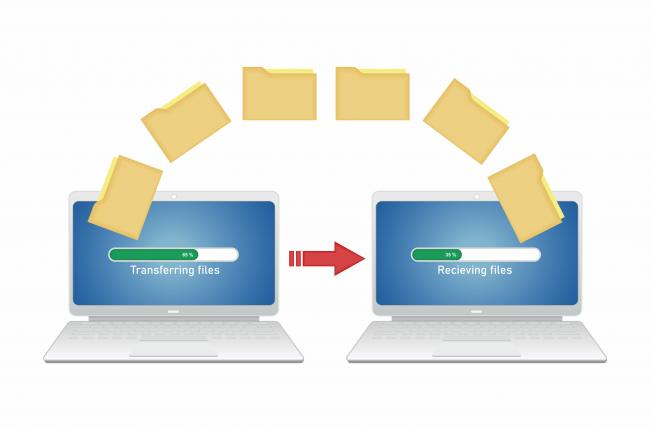
La violation du secret professionnel justifie un licenciement pour faute grave
Selon l’article L 161-29 du code de la sécurité sociale, le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. Dans le cadre du droit du travail, comment l’employeur doit-il dès lors réagir en présence d’une violation de ce secret par les salariés ? L’ancienneté et le passé disciplinaire sans reproche des intéressés peuvent-ils atténuer la gravité de la faute ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans ces deux affaires (cassation n° 22-13.531 et n° 22-13.532).
Deux techniciens de prestations à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), respectivement depuis 1980 et 1977, sont licenciés pour faute grave pour avoir divulgué des données personnelles concernant, pour l’un, un ministre en exercice et, pour l’autre, un joueur de rugby connu. Pour justifier leur licenciement, la CPAM soutient que la divulgation de ces données confidentielles constitue une faute grave, indépendamment de l’ancienneté et du passé disciplinaire des salariés. Ces derniers, quant à eux, contestent la gravité de la faute, invoquant leur longue carrière sans incident disciplinaire.
La cour d’appel, tout en constatant que les salariés ont violé le secret professionnel, juge que le licenciement des deux salariés ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu’ils cumulent respectivement 36 ans et 39 années d’ancienneté sans passé disciplinaire. La caisse se pourvoit en cassation.
Alors que la cour d’appel constate la violation du secret professionnel, pouvait-elle considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse ? La Cour de cassation répond par la négative. Sans remettre en cause les constats des juges d’appel, elle censure l’erreur manifeste d’appréciation.
A noter : La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond se livrent au contrôle de la véracité et de la gravité des faits commis par le salarié. Elle censure les erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle constate que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations. Elle opère donc une application de ce contrôle renforcé dans le cadre de cette affaire de violation du secret professionnel.
Pour la Cour de cassation, le fait pour les salariés de méconnaitre l’obligation de secret professionnel à laquelle ils étaient astreints en transmettant à un tiers, sans raison valable, dans un cas, la fiche du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie d’un ministre en exercice et dans l’autre, l’attestation de salaire d’une personnalité publique comportant des données confidentielles, à laquelle ils avaient eu accès dans le cadre de leurs fonctions, constitue une faute grave de nature à rendre impossible leur maintien dans l’entreprise, quels qu’aient donc pu être leur passé disciplinaire et leur ancienneté.
A noter : En retenant la faute grave, l’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure. Une telle faute avait, par exemple, été retenue à l’encontre d’un cadre administratif qui avait divulgué le montant du salaire de ses collègues (Cass n° 16-24.069). Cette solution s’impose d’autant plus qu’il ne s’agit pas ici de divulgation d’informations confidentielles mais bien d’une violation du secret professionnel. Face à une telle violation, l’ancienneté des salariés est sans incidence sur la qualification de la faute grave. Il est probable que la notoriété des victimes de la violation ait joué également dans la sévérité de la Cour de cassation.
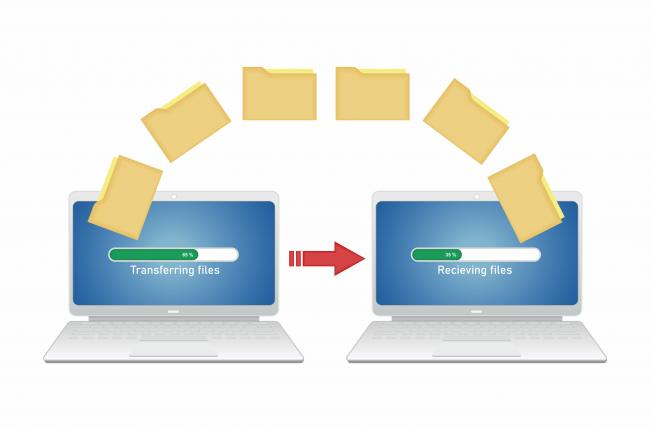
Smic : revalorisation anticipée au 1er novembre
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est revalorisé de façon anticipée au 1er novembre 2024 alors que cette revalorisation aurait dû intervenir au 1er janvier 2025. Avec une hausse de 2 %, le Smic horaire brut s’établira à 11,88 € en métropole à partir du 1er novembre (décret n° 2024-951).
