ACTUALITÉ
SOCIAL
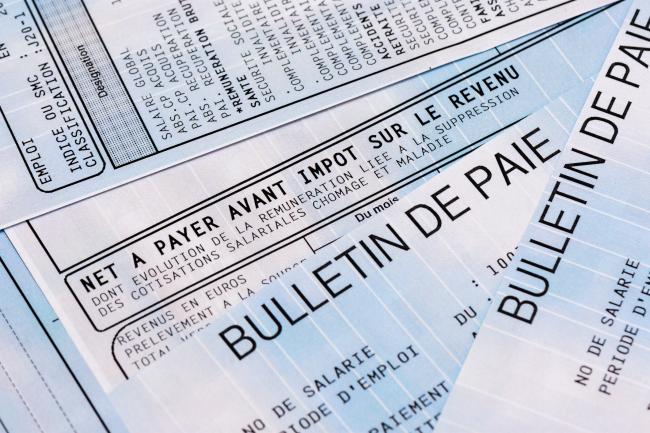
Plafond de sécurité sociale 2025 : quelles principales incidences en paie ?
Les différents plafonds périodiques prévus par l’arrêté à paraître en fin d’année seront, comme l’a précisé le Boss, fixés comme suit au 1er janvier 2025.
| Plafonds 2025 | |
| Annuel | 47 100 € |
| Trimestriel | 11 775 € |
| Mensuel | 3 925 € |
| Quinzaine | 1 963 € |
| Hebdomadaire | 906 € |
| Journalier | 216 € |
| Horaire | 29 € |
Contributions chômage et AGS
Le plafond des contributions d’assurance chômage et AGS (4 plafonds de sécurité sociale) est fixé comme suit en 2025 :
| Par mois | Par trimestre | Pour l’année |
| 15 700 € | 47 100 € | 188 400 € |
Retraite complémentaire Agirc-Arrco
La valeur des plafonds applicables aux cotisations Agirc-Arrco en 2025 est la suivante :
| Tranche de rémunération | Par mois | Par trimestre | Pour l’année |
| Tranche 1 | 3 925 € | 11 775 € | 47 100 € |
| Tranche 2 |
entre 3 925 et 31 400 € |
entre 11 775 et 94 200 € |
entre 47 100 et 376 800 € |
Contributions de prévoyance complémentaire
| Les contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire (y compris les régimes couvrant les frais de santé) sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, dans la limite ci-contre | Somme de 6 % du Pass (soit 2 826 €) et de 1,5 % de la rémunération, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du Pass, soit 5 652 € |
| Les cotisations salariales et patronales versées aux régimes de prévoyance complémentaire (à l’exception des régimes couvrant les frais de santé) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite ci-contre |
Somme de 5 % du montant du Pass (soit 2 355 €) et de 2 % de la rémunération. Sans que le total puisse excéder 2 % de 8 fois le montant du Pass, soit un montant maximal déductible de 7 536 € |
Contributions de retraite supplémentaire
| Les contributions patronales sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la plus élevée des deux valeurs ci-contre | 5 % du Pass (soit 2 355 €) ou 5 % de la rémunération, retenue dans la limite de 5 fois le montant du Pass (soit 11 775 €) |
| Les contributions salariales et patronales (hors frais de santé) échappent à l’impôt sur le revenu dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, retenue à concurrence de 8 fois le Pass | Soit une déduction maximale de 30 144 € |
CSG-CRDS
| Réduction représentative de frais professionnels | La base de la CSG et de la CRDS assises sur les salaires fait l’objet d’une réduction représentative de frais professionnels de 1,75 %, mais l’assiette de cette déduction est limitée à 4 Pass. |
Assiette maximale de la déduction : 188 400 €/an (15 700 €/mois) Montant maximal de la déduction : 3 297 €/an (274,75 €/mois) |
Indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du mandat social
|
Leur régime social et fiscal dépend notamment des seuils suivants : |
Soit pour 2025 : |
| 2 Pass | 94 200 € |
| 3 Pass | 141 300 € |
| 5 Pass | 235 500 € |
| 6 Pass | 282 600 € |
| 10 Pass | 471 000 € |
Stage
| Gratification |
Montant minimal de la gratification pour le stage de plus de 2 mois : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) Fraction de la gratification exonérée de cotisations (quelle que soit la durée du stage) : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage |
4,35 € × nombre d’heures de stage réalisées au cours du mois |
Cadeaux, bons d’achat et chèques-vacances
| Bons d’achat et cadeaux attribués par le CSE | Présomption de non-assujettissement à cotisations dans la limite de 5 % du PMSS(1) par salarié et par an | 196 € |
| Chèques-vacances | La participation de l’employeur ne peut pas dépasser 50 % ou 80 % de la valeur libératoire selon que la rémunération moyenne du salarié est au moins égale ou inférieure au PMSS(1) au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution |
Si rémunération moyenne < 3 925 €, participation maximale = 80 % Si rémunération moyenne ≥ 3 925 €, participation maximale = 50 % |
Indemnités journalières de sécurité sociale
| IJSS de maternité, paternité et adoption | Pour les salariés mensualisés, elle est égale à 1/91,25e du montant des salaires des 3 mois civils précédant l’arrêt de travail, pris en compte dans la limite du PMSS(1) et abattus de 21 % | Montant maximal : 101,94 € net avant précompte de la CSG et de la CRDS |
| IJSS accident du travail ou maladie professionnelle | IJSS accident du travail ou maladie professionnelle : égale à 60 ou 80 % du salaire journalier de base lui-même égal à 1/30,42e de la dernière paie dans la limite de 0,834 % du Pass |
Salaire journalier de base maximal : 392,81 € Montant maximal IJ : 235,69 € (60 %) ou 314,25 € (80 %) |
Participation et intéressement
| Participation aux résultats de l’entreprise | Salaire maximal pris en compte en cas de répartition proportionnelle aux salaires : 3 fois le Pass | Salaire maximal : 141 300 € |
| Droits maximaux pouvant être attribués à un salarié : 75 % du Pass | Droits maximaux : 35 325 € | |
| Intéressement | Montant maximal des primes distribuées à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice : 75 % du Pass | 35 325 € |
| PEE (Plan d’épargne entreprise) | Montant maximal de l’abondement de l’entreprise : 3 fois la contribution du salarié, dans la limite de 8 % du Pass (16 % du Pass en cas de versement unilatéral de l’employeur sur le plan pour acquisition de titres de l’entreprise) | 3 768 € (ou 7 536 €) |
| Montant maximal de la majoration pour acquisition de titres de l’entreprise : 80 % de ce montant | 7 536 € | |
| Perco/Pereco | Montant maximal de l’abondement de l’entreprise : 3 fois la contribution du salarié, dans la limite de 16 % du Pass par participant | 7 536 € |
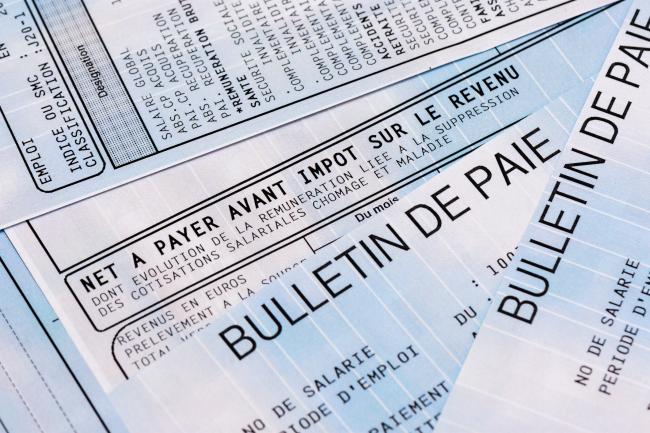

L’ancienneté non prise en compte dans une prime peut justifier une différence de salaire
Une salariée, licenciée près de 6 ans après son embauche, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment un rappel de salaire en application du principe d’égalité de traitement. A l’appui de sa demande, elle invoque la comparaison avec une autre salariée ayant près de 7 ans d’ancienneté. L’employeur, quant à lui, se prévaut de la différence d’ancienneté pour justifier de la disparité de rémunération. La cour d’appel donne raison à la salariée, considérant que l’ancienneté supérieure peut justifier tout au plus une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire de base. Sans surprise, l’arrêt est cassé au visa du principe d’égalité de traitement (Cassation n° 23-16.226).
A noter : En application de ce principe, les différences de traitement entre salariés placés dans une situation identique doivent reposer sur des règles préalablement définies et contôlables (Cassation n° 98-44.745) et être justifiées par des raisons objectives et pertinentes (Cassation n° 07-45.356). Parmi ces raisons figure l’ancienneté, à condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale (Cassation n° 06-44.795 ; Cassation n° 07-40.609) et ce, même si la prime ne prend en compte que particiellement la durée de présence des salariés dans l’entreprise (Cassation n°s 22-18.155 et 22-17.250).
Dans cette affaire, en l’absence de prime d’ancienneté, il incombait donc au juge de vérifier si l’ancienneté pouvait justifier la différence de rémunération constatée (Cassation n° 10-19.438), ce que n’a pas fait la cour d’appel. La cour d’appel de renvoi devra donc déterminer si cette différence d’ancienneté d’une année justifie l’écart de rémunération.


Pas de cumul des indemnités de départ à la retraite et de licenciement
La rupture du contrat de travail peut donner lieu au versement de différentes indemnités de rupture, lorsque le salarié remplit leurs conditions d’attribution. Ainsi, lors de son départ volontaire à la retraite, le salarié peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, légale ou conventionnelle (article L 1237-9 du code du travail ; arrêt du 5 avril 2018). Ou lorsqu’il est licencié, il peut bénéficier d’une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle (article L 1234-9du code du travail ; arrêt du 15 octobre 1997). Mais ces deux indemnités peuvent-elles se cumuler lorsque leurs conditions d’attribution sont toutes réunies ? Si cette situation reste rare, elle peut se produire dans les contentieux de requalification de la rupture du contrat de travail.
Dans cette espèce une cour d’appel avait requalifié 37 ans de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée. Elle avait ainsi indemnisé la salariée concernée à la fois de la rupture de son contrat de travail constitutive d’un licenciement et de son départ à la retraite qui avait eu lieu deux ans avant la fin de la relation de travail sans qu’aucune indemnité ne lui soit alors versée.
Devant la Cour de cassation, le pourvoi de l’employeur faisait valoir que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite ont le même objet, à savoir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, et ne devaient donc pas se cumuler. En effet, la Cour de cassation juge, concernant l’indemnité de mise à la retraite, que lorsque la mise à la retraite est requalifiée en licenciement, le salarié ne peut pas cumuler les avantages liés au départ en retraite et ceux dus au titre du licenciement (arrêt du 3 octobre 1991 ; arrêt du 8 juillet 2003 ; arrêt du 22 juin 2011).
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel en énonçant que l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas se cumuler avec l’indemnité de licenciement. Elle précise que l’indemnité de licenciement n’était due que sous déduction de l’indemnité de départ à la retraite.
La Haute juridiction adopte ainsi la même solution que pour l’indemnité de mise à la retraite.
►A notre avis : Si le principe de non-cumul de l’indemnité de mise à la retraite avec l’indemnité de licenciement est fondé sur l’identité d’objet de ces indemnités venant indemniser la perte d’emploi à l’initiative de l’employeur (voir en ce sens l’arrêt du 21-11-1990), le non-cumul de l’indemnité de départ à la retraite avec l’indemnité légale de licenciement est fondé sur une identité d’objet différente, ces indemnités ayant seulement en commun de se rapporter à la rupture du contrat de travail.


Solde de tout compte : la Cour de cassation se prononce sur les effets de l’absence de signature du salarié
Pour rappel, à l’occasion de toute rupture du contrat de travail l’employeur est tenu d’établir, en double exemplaire, un document dit « reçu pour solde de tout compte » récapitulant les sommes versées au salarié (montant des salaires, primes, indemnités diverses…) à ce titre. Le salarié a la possibilité de le dénoncer par lettre recommandée dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Si l’employeur a l’obligation de remettre un reçu pour solde de tout compte au salarié, ce dernier n’est pas tenu de le signer.
Dans le cas où le salarié ne signerait pas ou refuserait de signer le reçu pour solde de tout compte, cette absence de signature a-t-elle un impact sur la valeur de ce document ? Cela a-t-il une incidence sur le délai de prescription applicable à l’action en paiement des sommes mentionnées ? Plus précisément, le fait que le salarié n’ait pas signé son reçu pour solde de tout compte en raison de son incarcération empêche-t-il la prescription de courir ? Autant de questions auxquelles la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 14 novembre 2024.
L’affaire concernait un salarié licencié pour motif disciplinaire par lettre du 11 avril 2013 avec dispense de préavis de 2 mois. A l’issue de celui-ci, l’employeur avait établi son solde de tout compte en date du 13 juin 2013.
Mais le salarié ne l’a jamais signé du fait de son incarcération du 25 juin 2013 jusqu’au 22 juin 2017. A sa sortie, il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de son solde de tout compte.
La cour d’appel avait déclaré sa demande recevable. La Cour de cassation lui donne tort et expose sa position dans un attendu de principe.
La Haute Cour rappelle tout d’abord les termes des articles L.1234-20 relatif au reçu pour solde et L.1471-1 du code du travail qui concerne le délai de prescription applicable à l’action.
► Le délai de prescription appliqué dans cette affaire est celui de l‘article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Ce texte avait prévu que ce délai (passé de cinq ans à deux ans) pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail devait s’appliquer aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Elle poursuit en indiquant que « le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié, qui n’a pas de valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas ou n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
► Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure sur les effets de l’absence de signature du reçu pour solde de tout compte. La Cour de cassation a déjà précisé que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées. Il appartient en conséquence à l’employeur de justifier de ce paiement (arrêt du 27 mars 2019). Implicitement, la Cour de cassation ne retient pas l’incarcération comme cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu, pour déclarer l’action recevable, que le solde de tout compte, que le salarié n’avait jamais signé en raison de son incarcération (du 25 juin 2013 au 22 juin 2017) n’avait produit aucun effet libératoire et qu’aucune prescription n’avait commencé à courir. Or, elle avait aussi constaté que la prescription s’était appliquée à compter du 16 juin 2013 et que le salarié avait eu jusqu’au 16 juin 2015 pour engager toute action portant sur l’exécution et la rupture de son contrat travail. Mais comme elle n’avait pas en l’espèce caractérisé une cause d’interruption ou suspension du délai de prescription, celui-ci était donc logiquement forclos. L’arrêt devait donc être cassé.
Conséquences pratiques : la signature du salarié apparaît un élément essentiel du reçu pour solde de tout compte. Son absence prive ce document de son effet libératoire au-delà du délai de six mois prévu par l’article L.1234-20 du code du travail. Comme le salarié n’a aucune obligation de le signer, l’employeur ne peut pas conditionner le paiement des sommes mentionnées dans ce document à la signature du salarié.
De son côté le salarié reste libre tant qu’il n’a pas signé son reçu de tout compte de contester le contenu de celui-ci.
Toutefois, le salarié reste tenu, s’il veut contester les sommes mentionnées dans ce reçu pour solde de tout compte non signé, d’agir dans le délai de prescription puisque l’absence de signature du salarié ne produit pas d’effet sur le délai de prescription. Celui-ci continue de courir. Seule l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure peut interrompre celui-ci. L’incarcération du salarié n’est pas un motif, en soi, permettant de suspendre le délai de prescription.


NAO 2025 : les entreprises devraient mettre en avant les packages salariaux
Dernière ligne droite pour la négociation annuelle obligatoire : dans les entreprises, DRH et organisations syndicales se retrouvent actuellement pour finaliser les projets d’accord sur les augmentations salariales 2025. Un dossier où les sujets de friction sont nombreux. Car cette année, rien ne milite pour un excès de générosité. Sous la triple influence de la chute de l’inflation, de la conjoncture économique et des incertitudes sur le PLF et le PLFSS pour 2025, les employeurs devraient jouer la prudence.
Concrètement, les entreprises devraient octroyer des budgets d’augmentation médians de 2,8 % voire de 2,5%, contre 3,5 % en 2024 et 4,7 % en 2023, selon l’Observatoire annuel de performance sociale et des rémunérations de LHH, qui présentait son étude le 27 novembre. Quelques secteurs consentiront toutefois à des efforts particuliers, à l’instar de la banque (3 %), des produits et biens d’équipement (2,75 %) et des assurances/mutualité (2,65 %).
L’étude s’appuie sur un panel de 180 entreprises (représentant 1 200 000 salariés) de plusieurs secteurs d’activité dont 43 % employant plus de 1 000 salariés.
Sans surprise, les augmentations individuelles devraient faire leur grand retour. Car si en 2023, les entreprises avaient fait la part belle aux augmentations générales (AG) avec un taux médian de 3 %, cette mesure, comme en 2024, est en perte de vitesse.
Autre tendance : ces augmentations ne sont plus réservées aux seuls cadres. Car si 67 % des cols blancs perçoivent ce coup de pouce, 60 % de techniciens/ agents de maîtrise et 50 % des employés et ouvriers en bénéficient également.
Et comme l’an passé, la prime de partage de la valeur devrait être moins attractive. En effet, ces bonus sont désormais soumis à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS pour les personnes travaillant dans les entreprises de plus de 50 salariés, en vertu de la loi ad hoc du 29 novembre 2023. 25 % des entreprises l’ont versée cette année pour un montant médian de 750 euros.
Mais les DRH comptent s’appuyer sur d’autres leviers pour gonfler les fiches de paie. « La perspective d’un package est un marqueur important de l’offre employeur », assure Nathalie Germanicus, directrice de projet en charge du pilotage des études de rémunération au sein de LHH.
Dans le détail, elles devraient privilégier l’épargne salariale qui permet d’associer les salariés aux bénéfices de l’entreprise. Même si la réalité varie énormément selon les entreprises, les salariés des grands groupes étant plus favorisés. Reste qu’il s’agit « d’une pièce du puzzle importante pour apporter de l’attractivité ». Un atout non négligeable dans un contexte où les tensions sur le marché de l’emploi restent vives. Ainsi, en 2024, 88 % d’entre elles ont mis en place un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne groupe (PEG). Par ailleurs, 71 % ont opté pour un dispositif de retraite complémentaire pour permettre aux salariés de se constituer un capital ou une rente au moment du départ à la retraite, qu’il s’agisse du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco). Et 64 % ont privilégié le compte épargne-temps.
Autres alternatives : parmi les périphériques de rémunération, les entreprises devraient favoriser, en 2025, le relèvement des titres restaurants, les chèques emploi service universel, vacances, cadeaux mais aussi la participation à des activités de loisirs ou sportives.
Enfin, plus de la moitié des DRH (57 %) devrait axer leurs enveloppes sur la mobilité durable qui inclut la forfait mobilité, le covoiturage, l’achat ou l’usage d’un vélo. Même si la voiture de fonction a toujours le vent en poupe : 79 % des entreprises mettent toujours un véhicule à disposition de certains salariés amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions.

PLFSS 2025 : Michel Barnier recourt au 49-3
Le 2 décembre, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement, sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Deux motions de censure ont été déposées par des députés du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement national. Elles seront discutées et mises aux voix après un délai de 48 heures à compter de leur dépôt.
En cas de rejet des deux motions, le projet de loi est considéré comme adopté. Si l’une des motions est adoptée, le texte est rejeté et le gouvernement doit présenter sa démission.

La commission mixte paritaire du Parlement s’accorde pour réduire la hausse du coût du travail
Le débat sur la réforme des charges sociales patronales avance. Mercredi dernier, la commission mixte paritaire (CMP) du Parlement, qui réunit 7 députés et 7 sénateurs, a trouvé un accord sur le fameux article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Un texte parfois différent de celui transmis par le gouvernement au Sénat en 1ère lecture — rappelons que l’exécutif avait repris la main sur le PLFSS pour 2025 à transmettre à la chambre haute en 1ère lecture après que l’Assemblée nationale n’ait pas pu voter l’ensemble du texte (lire notre article) — et/ou de celui adopté par le Sénat (voir notre tableau ci-dessous).
Premier sujet, le coefficient maximal servant à déterminer la réduction dite Fillon (cf articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale). La CMP souhaite laisser inchangé en 2025 son niveau qui est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas — la problématique serait différente à partir de 2026. Le gouvernement, qui voulait le réduire de deux points l’année prochaine, semble reculer pour les plus bas revenus. « J’ai entendu la demande légitime de préserver le coût du travail dans les entreprises qui ont beaucoup de salariés au niveau du Smic. J’ai eu des discussions avec des parlementaires du socle commun et nous avons décidé de préserver finalement intégralement le 0 charge au niveau du Smic pour les entreprises », a avancé jeudi dernier Michel Barnier en visite au salon Impact PME (voir cette vidéo à environ 25 mn du début).
Second sujet, celui relatif à la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale). Le débat porte sur le plafond de revenus, actuellement fixé à 2,5 Smic, éligibles à cet allègement. Le gouvernement voulait à l’origine le passer en 2025 à 2,2 Smic — cette réduction disparaîtrait ensuite, à partir du 1er janvier 2026. La CMP a opté pour une limite fixée à 2,25 Smic en 2025.
Le débat est similaire sur la réduction de cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) dont le plafond de revenus éligibles est actuellement fixé à 3,5 Smic. Le gouvernement voulait à l’origine passer cette limite en 2025 à 3,2 Smic — cette réduction disparaîtrait ensuite, à partir du 1er janvier 2026. La CMP a opté pour un niveau fixé à 3,3 Smic en 2025.
Enfin, un accord semble se dessiner sur l’évolution du plafond de revenus éligibles à la réduction Fillon. Le gouvernement voulait à l’origine le faire passer de 1,6 Smic (niveau actuel) à 3 Smic à partir du 1er janvier 2026. La CMP a retenu la même modalité.
Le processus parlementaire n’est toutefois pas terminé. La prochaine étape est prévue pour aujourd’hui. L’Assemblée nationale doit examiner le texte issu de la CMP sachant que seuls les amendements du Gouvernement ou ceux acceptés par lui peuvent être déposés. (voir les explications ici et ici pour en savoir davantage sur cette procédure).
| Dispositif actuel | Texte transmis au Sénat en 1ère lecture (1) | Texte voté par le Sénat en 1ère lecture (2) | Texte adopté en commission mixte paritaire (3) |
| Coefficient maximal servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) |
► Réduction de 2 points à partir du 1er janvier 2025. ► Réduction de deux points supplémentaires à partir du 1er janvier 2026 mais augmentation partielle via les suppressions des réductions de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales (voir ci-dessous). Le coefficient maximal passerait ainsi à 35,74 % ou 36,14 % selon le cas. La définition du coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait considérablement modifié (lire notre article). |
Pas de réduction de ce coefficient | Pas de réduction de ce coefficient |
| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) |
► Plafond réduit à 2,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 |
► Plafond réduit à 2,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |
► Plafond réduit à 2,25 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |
| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) |
► Plafond réduit à 3,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 |
► Plafond réduit à 3,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |
► Plafond réduit à 3,3 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |
| Plafond, fixé actuellement à 1,6 Smic, des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale | Plafond fixé à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %) à compter du 1er janvier 2026 | Plafond fixé à 2,05 Smic (Smic augmenté de 105 %) à compter du 1er janvier 2026 | Plafond fixé à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %) à compter du 1er janvier 2026 |
(1) Ce texte est identique à celui présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, la chambre basse n’ayant pas pu voter l’ensemble du texte (lire notre article)
(2) Suite au vote solennel du PLFSS pour 2025 par le Sénat en 1ère lecture
(3) Suite à l’accord conclu par la commission mixte paritaire le 27 novembre

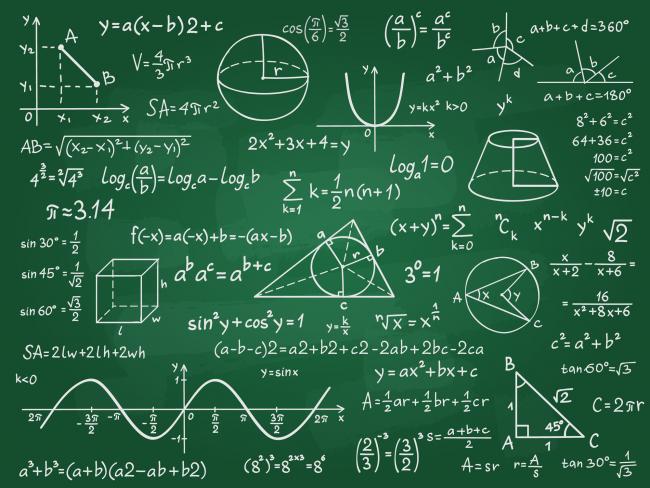
Licenciement abusif d’un salarié ayant adhéré au CSP : comment calculer l’indemnité ?
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent accorder au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Les planchers et plafonds de ce barème, qui s’imposent au juge (Cassation n°s 21-15.247 et 21-14.490 ; Cassation n° 21-21.011), sont exprimés en mois de salaire brut (Cassation n° 20-18.782) et varient en fonction du montant du salaire mensuel de l’intéressé et de son ancienneté, exprimée en années complètes.
En l’espèce, une salariée, après avoir conclu un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), avait contesté la rupture de son contrat de travail pour motif économique en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation préalable de reclassement. Les juges ayant conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intéressée pouvait prétendre à une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 20 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de plus de 30 ans.
Depuis la loi 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L 1235-3 précité prévoit que, pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur, invoquant ce dernier texte, soutenait, à l’appui de son pourvoi, que, si une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était due à la salariée, la cour d’appel, qui a alloué à celle-ci près de 20 mois de salaire, aurait dû tenir compte de la somme déjà perçue par elle en application de l’article L 1233-67 du Code du travail au titre du CSP, représentant déjà près de 10 mois de salaire.
Selon ce dernier article, la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au CSP, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis, ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur à France Travail représentatif de cette indemnité.
La chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-19.629) en déduit logiquement ici que la somme versée au salarié en application de l’article L 1233-67 du Code du travail au titre de l’indemnité légale de licenciement n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejette l’argument de l’employeur.
A noter : En tout état de cause, la prise en compte des indemnités de rupture dans la détermination de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est qu’une faculté pour le juge, et non une obligation. Les indemnités visées sont sans doute les indemnités contractuelles de licenciement, le cas échéant négociées au moment de la conclusion du contrat de travail, ou les indemnités conventionnelles.
L’employeur reprochait, par ailleurs, à la cour d’appel d’avoir, pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu un salaire de référence de 2 005 € par mois, correspondant au montant du salaire brut de septembre 2019, alors que la moyenne des salaires sur un an, de septembre 2018 à septembre 2019, était de 1 893,97 €. Mais, là encore, il n’obtient pas gain de cause.
En effet, si avant l’ordonnance précitée de 2017, le Code du travail ordonnait de prendre la moyenne des 6 derniers mois de salaire avant la rupture du contrat de travail, l’article L 1235-3 est, depuis, muet sur ce point et n’exclut donc pas que le juge puisse prendre comme salaire de référence le salaire brut mensuel du dernier mois précédant le licenciement.
Pour la Cour de cassation, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’étendue du préjudice subi dès lors que l’indemnité allouée au salarié abusivement licencié est comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème (Cassation n° 22-12.462). La Haute Cour ajoute qu’il n’a pas, notamment, à s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’il a retenus.
A noter : Comme indiqué par l’avocat général, dans son avis diffusé sur le site de la Cour de cassation, celle-ci exerce en la matière un contrôle de légalité en vérifiant que les juges du fond se sont conformés au barème d’indemnités de l’article L 1235-3 du Code du travail. Il leur appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux qui y sont prévus (Cassation n°s 21-14.490 et 21-15.247 ; Cassation n° 21-24.857).
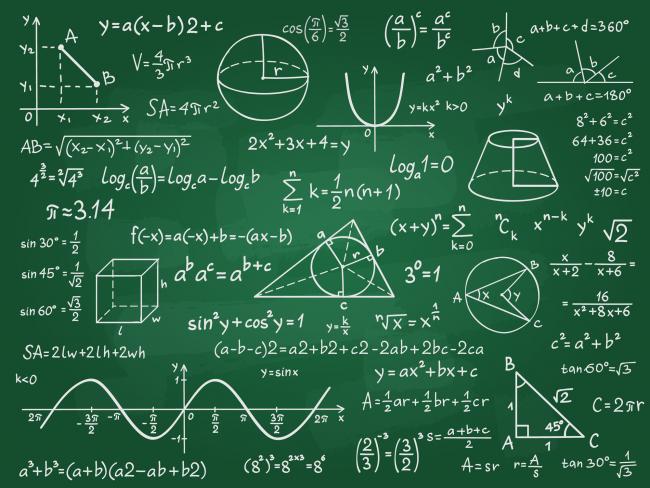
Le Sénat adopte l’ensemble du PLFSS pour 2025
Hier, la Chambre haute a procédé au vote solennel en 1ère lecture en faveur de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La commission mixte paritaire chargée de s’accorder sur un texte final, composée de sept sénateurs et sept députés, devrait se réunir aujourd’hui.

Quelle indemnisation pour la salariée enceinte licenciée qui ne demande pas sa réintégration ?
L’employeur qui licencie une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après ce dernier ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes, encourt la nullité du licenciement, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (articles L 1225-4 et L 1225-70 du Code du travail).
La nullité du licenciement ouvre droit, si la salariée le demande, à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent (Cassation n° 00-44.811 ; Cassation n° 01-44.503). L’intéressée peut aussi prétendre au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration ou la date de son refus si elle renonce à la réintégration demandée (Cassation n° 08-45.640), sans déduction des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier durant cette période (Cassation n° 18-21.862), et aux congés payés afférents (Cassation n° 89-42.302).
Si la salariée ne demande pas sa réintégration, l’employeur doit lui verser, outre une indemnité de préavis (Cassation n° 88-40.806 ; Cassation n° 89-42.302), une indemnité égale à au moins 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement (articles L 1225-71 et L 1235-3-1, al. 8 du Code du travail).
Cette dernière indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L 1225-71 du Code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle (article L 1235-3-1, al. 9 du Code du travail).
A noter : L’article L 1225-71 du Code du travail a été réécrit par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail. Avant le 24 septembre 2017, l’article L 1225-71, alinéa 2 prévoyait que, si le licenciement de la salariée était nul en raison du non-respect des règles relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, l’employeur devait lui verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Mais cette précision a disparu de l’article L 1225-71, dans sa rédaction issue de l’ordonnance. En effet, depuis le 24 septembre 2017, il prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des règles relatives à la protection de la grossesse et de la maternité peut donner lieu, au profit de la salariée, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du Code du travail, c’est-à-dire égale à au moins 6 mois de salaire. Or l’article L 1235-3-1 du même Code fait toujours référence au salaire dû en application de l’article L 1225-71 qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Par un arrêt du 6 novembre 2024 (n° 23-14.706), la Cour de cassation se prononce pour la première fois, à notre connaissance, depuis la modification de l’article L 1225-71 par l’ordonnance du 22 septembre 2017, sur le droit de la salariée enceinte, dont le licenciement est jugé nul et qui ne demande pas sa réintégration, à percevoir une indemnité égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
En l’espèce, une caissière employée libre-service licenciée pour faute grave saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter notamment la nullité de son licenciement qui aurait été prononcé en lien avec son état de grossesse. Jugeant que l’existence d’une faute grave n’est pas démontrée et que l’employeur avait connaissance de la grossesse de la salariée au moment du licenciement, la cour d’appel fait droit à sa demande. À ce titre, elle lui octroie notamment une indemnité égale à au moins 6 mois de salaire en application de l’article L 1235-3-1 du Code du travail ainsi qu’une indemnité correspondant aux salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité qui court du jour du licenciement jusqu’à 10 semaines suivant l’expiration du congé de maternité. Pour rendre sa décision, elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la salariée qui demande sa réintégration de principe ou qui y renonce est en droit d’obtenir une indemnité correspondant au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, sans déduction des revenus de remplacement.
Estimant ne pas devoir cette dernière indemnité à la salariée, l’employeur se pourvoit en cassation. À l’appui de son pourvoi, il fait valoir que, si, lorsque le licenciement d’une salariée est jugé nul pour avoir été prononcé en lien avec son état de grossesse et que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit à l’attribution d’une indemnité équivalant à au moins 6 mois de salaire, elle n’a plus le droit en revanche, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond, mais invoque un autre fondement. Elle s’appuie sur les articles L 1225-71 et L 1235-3-1 du Code du travail, interprétés à la lumière des articles 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et 18 de la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
Selon la Haute Juridiction, il résulte de la combinaison de ces articles que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit :
– aux indemnités de rupture ;
– à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
– et aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Pour justifier sa décision, la Cour de cassation rappelle que, selon une jurisprudence constante de la CJUE, un licenciement pendant le congé de maternité, mais également pendant toute la durée de la grossesse ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe (CJUE 11-11-2010 affaire 232/09). Et, dans l’hypothèse d’un licenciement discriminatoire, le rétablissement de la situation d’égalité ne pourrait pas être réalisé à défaut d’une réintégration de la personne discriminée ou, alternativement, d’une réparation pécuniaire du préjudice subi (CJCE 2-8-1993 affaire 271/91). Lorsque la réparation pécuniaire est la mesure retenue pour atteindre l’objectif de rétablir l’égalité des chances effective, elle doit être adéquate en ce sens qu’elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables (CJUE 17-12-2015 affaire 407/14).
Dès lors, la cour d’appel qui avait jugé le licenciement de la salariée nul ne pouvait que condamner l’employeur à lui verser une indemnité couvrant la période comprise entre la date d’éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection de 10 semaines suivant l’expiration du congé de maternité, ainsi que les congés payés afférents.
A noter : par cet arrêt, la Cour de cassation comble donc une lacune qui figurait dans la loi depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, en recourant au droit européen et en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

