ACTUALITÉ
SOCIAL

Violation d’une clause de non-concurrence frappée de nullité : quelle incidence sur la contrepartie financière ?
Un salarié avait été engagé en qualité d’attaché technico-commercial sédentaire par une entreprise offrant des services d’aéraulique du bâtiment. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an sur l’ensemble du territoire français. Après sa démission, son employeur a saisi la juridiction prud’homale afin de voir constater la violation de son obligation de non-concurrence et d’obtenir en conséquence le remboursement de la contrepartie financière versée.
Devant la Cour de cassation, l’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé la clause de non-concurrence sans avoir apprécié concrètement la restriction à la liberté du travail apportée par la clause, de ne pas avoir préservé la clause en réduisant son champ d’application géographique au périmètre correspondant à l’intérêt légitime de l’entreprise et, enfin, de ne pas lui avoir accordé le remboursement de l’indemnité versée pour la période où le salarié n’a pas respecté l’obligation prévue par la clause annulée.
Constituant une entrave à la liberté de travailler du salarié, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Cassation 10-7-2002 n°s 00-45.135, n° 00-45.387 et n° 99-43.334).
Le seul champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle (Cassation 20-1-1999 n° 96-45.669 ; Cassation 3-7-2019 n° 18-16.134 ; Cassation 15-12-2021 n° 20-18.144). Ainsi, la clause comportant une interdiction de concurrence sur l’ensemble du territoire français n’est pas nécessairement nulle (Cassation 18-2-1997 n° 94-44.202 ; Cassation 15-12-2009 n° 08-44.847). C’est seulement associé à d’autres éléments, en particulier la portée de la clause et la spécificité de l’activité exercée, que le champ d’application géographique peut constituer une entrave à la liberté de travail (Cassation 25-3-1998 n° 95-41.543 ; Cassation 23-10-2001 n° 99-44.219).
Pour prononcer la nullité de la clause, il appartient aux juges du fond, à partir des éléments versés aux débats, d’établir en quoi celle-ci empêche le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle (Cassation 18-12-1997 n° 95-43.409 ; Cassation 15-12-2021 n° 20-18.144).
En l’espèce, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-17.036) approuve la cour d’appel d’avoir annulé la clause après avoir relevé que le caractère concurrentiel et mouvant de l’activité de l’entreprise ne justifiait pas la restriction à la liberté de travail du salarié prévue par la clause de non-concurrence, excessive au regard de sa qualification de technico-commercial, et fait ainsi ressortir que cette clause, compte tenu des fonctions effectivement exercées, n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Le juge peut, lorsqu’une clause de non-concurrence ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en limitant son effet dans le temps, dans l’espace ou ses autres modalités (Cassation 18-9-2002 n° 00-42.904).
Au sujet d’une clause de non-concurrence incompatible avec les stipulations de la convention collective applicable, la Cour de cassation a estimé que le juge ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié (Cassation 12-10-2011 n° 09-43.155).
Cette exigence devait-elle s’appliquer au-delà du contexte d’une clause incompatible avec la convention collective ? L’arrêt du 22 mai 2024 répond à cette question par l’affirmative. La Cour de cassation confirme, en effet, cette solution : le juge ne peut réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité est invoquée par le salarié.
En principe, un contrat nul ne peut produire aucun effet, ce qui implique que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Mais cela n’est pas toujours possible lorsque le contrat a été exécuté, en particulier lorsqu’il s’agit d’une clause de non-concurrence prévoyant une entrave à la liberté de travailler en contrepartie du versement d’une indemnité. Et la situation se complique d’autant lorsque la clause annulée n’a pas été respectée.
Pour faire droit au pourvoi de l’employeur reprochant à la cour d’appel de ne pas lui avoir accordé le remboursement de l’indemnité pour la période où le salarié n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence, la Cour de cassation articule sa jurisprudence organisant les restitutions résultant d’une clause de non-concurrence nulle avec celle sur les conséquences de la violation d’une clause de non-concurrence.
Le salarié conserve l’indemnité perçue…
Selon la Cour de cassation, si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré. Il s’ensuit que, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle (Cassation 17-11-2010 n° 09-42.389). Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
A noter : Pour attribuer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi, la Cour de cassation se fonde sur le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et sur l’article L 1121-1 du Code du travail, aux termes duquel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Pour rappel, en cas de violation de la clause de non-concurrence, le salarié conserve le droit au paiement de la contrepartie pécuniaire pour la période antérieure pendant laquelle il a respecté son obligation (Cassation 27-3-1996 n° 92-41.992 ; Cassation 18-2-2003 n° 01-40.194) ; la violation de la clause ne lui permet plus de prétendre au bénéfice de cette contrepartie même s’il respecte à nouveau son obligation de non-concurrence (Cassation 31-3-1993 n° 88-43.820 ; Cassation 5-5-2021 n° 20-10.092 ; Cassation 24-1-2024 n° 22-20.926).
Dans l’arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation, qui applique sa jurisprudence au cas d’une clause nulle, estime que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Ainsi, la Haute Juridiction décide que, pour débouter l’employeur de ses demandes d’indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d’appel ne pouvait retenir que la clause de non-concurrence était nulle, sans rechercher si le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.
A noter : Si le salarié ayant violé une clause de non-concurrence nulle ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave à la liberté de travailler, il devrait néanmoins pouvoir être indemnisé du préjudice distinct résultant de la nullité de la clause comme cela a été jugé antérieurement (Cassation 27-9-2017 n° 16-12.852).


Discrimination liée au handicap et non-respect de l’obligation de reclassement : régime probatoire
En vertu de l’article L.5213-6 du code du travail, l’employeur doit prendre des mesures appropriées d’aménagements raisonnables pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserves que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 du même code. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination.
Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur le régime probatoire applicable en cas de non-respect de ces obligations.
► Le rapporteur fait valoir que l’étude des arrêts d’appel sur ce sujet révèle une confusion sur cette question, les cours d’appel se fondant tantôt sur l’obligation de reclassement et tantôt sur la discrimination. Or, le mécanisme probatoire de ces deux notions, les sanctions et le contrôle qu’exerce la Cour de cassation dessus sont discincts.
Ainsi, la notice jointe à l’arrêt rappelle qu’il convient de distinguer ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce qui relève du droit de la discrimination, dont la sanction est la nullité du licenciement.
En l’espèce, une salariée reconnue en qualité de travailleur handicapé est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été discriminée car l’employeur n’a pas mis en place de mesures d’aménagements, elle saisit les tribunaux pour obtenir la nullité de son licenciement.
Les juges d’appel font droit à sa demande. Ils retiennent que la société n’a pas respecté les obligations de l’article L.5213-6 du code du travail, puisqu’elle n’a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé et n’a proposé aucune mesure particulière à la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant à la cour de ne pas avoir appliqué le mécanisme probatoire de la discrimination issu de l’article L.1134-1 du code du travail. Elle en livre un mode d’emploi en deux temps pour les juges du fond saisis d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap. Ceux-ci doivent ainsi :
- en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ;
- en second lieu, rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
En conséquence, si le salarié décide de fonder son action sur la discrimination, il doit dans un premier temps présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, la seule qualité de travailleur handicapé ne constituant pas, à elle seule, un tel élément.
► La Cour de cassation avait déjà jugé dans une précédente affaire que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le fait que l’employeur refuse de prendre les mesures pour permettre au salarié de conserver son emploi, sans justifier de leur caractère disproportionné, caractérise une discrimination liée au handicap et entraîne la nullité du licenciement (arrêt du 3 juin 2020).


Organisation du travail pendant les JOP 2024 : synthèse des dispositifs mobilisables
Les modalités d’organisation du travail à la disposition des entreprises diffèrent en raison soit de leur implication directe dans l’organisation et l’encadrement des Jeux Olympiques et paralympiques (JOP) soit de l’atteinte portée à la continuité de leur activité :
- pour les entreprises contribuant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), la loi du 19 mai 2023 a créé une dérogation au repos dominical et le décret du 23 novembre 2023 une dérogation au repos hebdomadaire.
- pour les entreprises dont l’activité sera gênée en raison des limitations de circulation et de déplacement, des questions-réponses et un guide du ministère du travail ont précisé les dispositifs mobilisables d’aménagement du temps de travail pour minimiser les impacts des JO sur la continuité de leur activité.
► Les épreuves des Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 et les jeux paralympiques du 28 août au 18 septembre 2024.
1) Principe
L’article 25 de la loi du 19 mai 2023 sur l’organisation des JOP 2024, permet au Préfet, dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, d’autoriser certains commerces à déroger temporairement au repos dominical, pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
► Les commerces visés pourraient notamment être des commerces alimentaires, qui ne peuvent actuellement être ouverts que le dimanche matin, des commerces vendant du matériel informatique, de photographie ou de téléphonie, des commerces d’habillement ou encore des commerces de services, tels que les coiffeurs (selon l’avis Sénat). il s’agit d’une dérogation temporaire et ciblée, plus adaptée que les cas de dérogations légales existantes.
Pour simplifier les démarches des commerces concernés, le préfet, après avoir accordé une autorisation à un commerce, pourra étendre cette autorisation à plusieurs établissements éligibles dans les mêmes conditions sans qu’ils aient besoin de déposer de demandes individuelles.
A l’égard des salariés, travailler le dimanche doit reposer sur le volontariat, ouvrir droit au double de la rémunération ou à un repos compensateur équivalent, donner lieu à un autre jour de repos hebdomadaire. A défaut, l’employeur pourra être sanctionné par une amende de 1 500 euros par salarié concerné (3 000 euros en cas de récidive) (Décret du 12 avril 2024).
Attention ! En raison des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, il est à noter que l’employeur devra prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote (article L. 3132-25-4 du code du travail, alinéas 1, 4 et 6).
Le non-respect par l’employeur des règles précitées est sanctionné par une amende de 1 500 euros par salarié concerné (3 000 euros en cas de récidive) (Décret du 12 avril 2024).
► A noter que peuvent aussi être mises en place les dérogations légales existantes : ouverture le dimanche jusqu’à 13 heures dans les commerces alimentaires, ouverture le dimanche dans les commerces situés dans les zones touristiques internationales, ouverture autorisée par le maire….
2) Dérogation sur Paris : précisions apportées par le préfet de Paris
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a fixé les modalités d’application de la dérogation permettant aux commerces de Paris de rester ouverts les dimanches du 15 juin au 30 septembre 2024 en prévision d’une affluence exceptionnelle de touristes à l’occasion des Jeux. Il a présenté les modalités de la dérogation dans un communiqué du 15 décembre 2023. Un nouveau communiqué de presse du 23 avril 2024 a précisé que la dérogation au repos dominical est étendue à l’ensemble des arrondissements de Paris.
Les branches d’activité concernées par cette ouverture sont les plus à même de satisfaire les besoins du public pendant les Jeux : commerce de détail alimentaire, articles de sport et loisirs, magasins multicommerces, cycles motocycles, grands magasins, habillement prêt à porter et librairie papeterie.
Les commerces situés dans les zones touristiques internationales seront par ailleurs ouverts de plein droit.
Un décret du 23 novembre 2023, précisé par un questions-réponses du ministère du travail publié le 30 novembre 2023, prévoit la possibilité exceptionnelle de suspendre le repos hebdomadaire, entre le 18 juillet et le 14 août, pour les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail :
- pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 ;
- ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques. Ces sites ont été précisés par arrêté ministériel du 11 mars 2024.
► La possibilité de suspendre le repos hebdomadaire, en l’état des textes, ne comprend pas la période des Jeux Paralympiques qui s’étend du 28 août au 9 septembre. A noter que la période de suspension du repos hebdomadaire s’étend entre le 18 juillet et le 14 août alors que les JO ont lieu entre le 26 juillet et le 11 août.
L’employeur peut la mettre en œuvre sous sa seule responsabilité, sans autorisation administrative préalable. Il doit seulement informer immédiatement l’inspection du travail territorialement compétente et ce, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail (article R. 3172-7 du code du travail). Cette information doit contenir les circonstances qui justifient la suspension, la date et la durée de cette suspension, le nombre de salariés auxquels elle s’applique, ainsi que les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
Il est possible de suspendre le repos hebdomadaire mais sous réserve de respecter les règles suivantes :
- cette mesure doit rester exceptionnelle et ne peut être prise qu’en dernier recours ;
- le repos quotidien et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des temps de repos minima doivent être respectés ;
- la suspension du repos est limitée à deux par mois et six par an (article L. 3132-5 du code du travail)
► A noter que le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation intenté par la CGT et la CFDT contre ce décret.
Les heures travaillées pendant le jour de repos hebdomadaire sont rémunérées comme des heures supplémentaires (article L. 3132-5 du code du travail) et ouvre droit à un repos compensateur immédiatement après le 14 août (Décret du 23 novembre 2023).
Un guide, publié par le gouvernement le 23 avril 2024 (voir en pièce jointe), présente l’ensemble des possibilités d’aménagement du travail prévues par le code du travail ou qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre du dialogue social dans les entreprises pour minimiser les impacts des JOP sur leur activité.
Le ministère rappelle que, pour éviter notamment de faire se déplacer les salariés dans les zones de forte affluence, il est possible de faire coïncider la période de congés payés avec les Jeux, voire de fermer l’entreprise pendant ces congés. Dans ce cas, « en raison notamment des impératifs de garde d’enfants, de réservation des billets de transports et des locations saisonnières, il est souhaitable que la période de prise des congés et les dates de départs soient connues des salariés et fixés le plus en amont possible ».
►Rappelons que l’information des salariés sur la période de prise des congés doit être effectuée deux mois avant et que l’ordre des départs doit être communiqué à chaque salarié un mois avant le départ. Les dates de départ en congés ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant (articles L. 3141-15 et D. 3141-6 du code du travail)
Le gouvernement incite à recourir au télétravail pendant les Jeux Olympiques, mais ce mode de fonctionnement reste optionnel et basé sur le volontariat.
En effet, seules des circonstances exceptionnelles auraient permis d’imposer le télétravail (article L. 1122-11 du code du travail). Or l’organisation des JO n’a pas été considérée comme un événement exceptionnel. Cette notion est appréciée strictement par les juges.
Le guide du ministère du travail préconise également d’adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports. « À l’instar de ce qui est organisé dans les entreprises pendant les périodes de canicule, les employeurs peuvent autoriser les salariés à venir travailler sur des plages horaires décalées ».
Deux options s’offrent alors : avancer les heures d’ouverture de l’entreprise pour permettre une arrivée et un départ plus tôt, ou retarder les heures de prise et de fin de poste, ce qui peut passer par une modification de l’horaire collectif applicable.
Dans tous les cas de figure, une information et la consultation du CSE doivent être organisées.
► Mais attention ! Si ce changement d’horaires porte atteinte au respect de la vie personnelle et familiale du salarié ou s’il bouleverse les conditions de travail (passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit par exemple) , il s’agit alors d’une modification du contrat que le salarié est fondé à refuser.
Le guide rappelle les conditions dans lesquelles les durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail peuvent être augmentées et le repos quotidien réduit par voie d’accord ou sur autorisation/décision administrative.
Si le principe est que l’organisation des JOP n’est pas une situation ouvrant droit d’office à l’activité partielle, l’interdiction de circuler dans certaines zones conduisant à la fermeture de l’entreprise a amené le ministère du travail à tolérer le recours à l’activité partielle dans certains cas. Un questions-réponses, publié sur le site du ministère du travail le 6 juin 2024, précise les différents cas de figure ouvrant droit ou non à l’activité partielle :
- sauf cas exceptionnels et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison de la tenue des jeux olympiques et paralympiques (JOP), il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle en raison de l’organisation des JOP ;
- les entreprises indirectement affectées par l’organisation des JOP ne pourront pas recourir au dispositif d’activité partielle ;
- sauf cas très exceptionnel, les entreprises affectées par les mesures de restriction de circulation décidées à l’occasion des JOP ne peuvent pas mobiliser le dispositif d’activité partielle. En effet, les restrictions de circulation des véhicules motorisés prévues par la préfecture de police dans les zones de sécurité (périmètre SILT, zone rouge, zone bleue) sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les informations relatives aux périmètres de sécurité, la liste des véhicules autorisés sont disponibles sur le site de la préfecture de police, permettant ainsi aux entreprises et aux salariés d’anticiper leurs déplacements pendant la période JOP ;
- toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas par les services de la Drieets, dès lors que l’entreprise serait en mesure de démontrer la réalité du lien entre ces mesures de restriction et la baisse significative de son activité ;
- les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle sous réserve qu’elles démontrent que leur baisse d’activité y est bien directement liée.
Tout dépôt de demande en lien avec les JOP devra se faire sur le motif « conjoncture économique » visé au 1° de l’article R. 5122-1 du code du travail. Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’État de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. L’avis du comité social et économique (CSE) doit être transmis avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, conformément à l’article R. 5122-2 du code du travail.
Pour justifier de sa demande d’autorisation préalable d’activité partielle pendant la période des JOP, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JOP.


Obligation d’information des salariés sur les éléments de la relation de travail : les modèles sont publiés
La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a notamment renforcé les obligations d’information de l’employeur vis-à-vis de ses salariés sur les éléments essentiels de la relation de travail. Une procédure spécifique a parallèlement été créée au bénéfice des salariés en cas de défaillance de l’employeur sur ce point. Cette loi a mis le droit interne en conformité avec la Directive (UE) 2019/1152 du 29 juin 2019, qui liste les informations à fournir, ainsi que leurs délais et supports de transmission. Si un grand nombre d’informations étaient déjà couramment transmises via divers supports (contrat de travail, DPAE, bulletin de salaire, CPF …), il a néanmoins fallu les compléter pour s’accorder avec la directive, qui en a étoffé la liste, et adapter les délais de transmission pour certaines d’entre elles (lire cet article).
Un décret du 30 octobre 2023 a donc fixé la liste des informations à transmettre ainsi que les délais et modalités de cette transmission. Rappelons que cette nouvelle obligation d’information s’applique pour les embauches effectuées à compter du 1er novembre 2023. Les salariés en poste à cette date et qui n’auraient pas reçu certaines informations peuvent les demander à tout moment à leur employeur, qui a alors sept jours calendaires pour les leur communiquer.
Ce même décret du 30 octobre dernier renvoyait à un arrêté le soin de fixer des modèles de documents pour faciliter la mise en oeuvre de cette obligation (étant entendu que les employeurs ne devaient pas en attendre la publication pour se conformer aux nouvelles obligations). Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 16 juin. Il comporte cinq annexes :
- Annexe 1 : la liste des principales informations sur la relation de travail à fournir au salarié;
- Annexe 2 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié au plus tard sept jours après la date d’embauche ;
- Annexe 3 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié au plus tard 30 jours après la date d’embauche ;
- Annexe 4 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié appelé à travailler à l’étranger ;
- Annexe 5 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivré au salarié détaché à l’étranger.
Chaque modèle rappelle les dispositions légales et réglementaires applicables.
| Information à délivrer | Délai de transmission |
| Identité des parties | 7 Jours |
| Nom et Prénom du salarié | |
| Nom ou raison sociale de l’employeur | |
| Numéro SIRET ou numéro de cotisant de l’employeur | |
| Lieu de travail | |
| Adresse du lieu de travail | |
| Autres adresses du lieu de travail éventuelles | |
| Adresse de l’employeur | |
| Fonctions occupées | |
| Intitulé du poste, des fonctions, de la catégorie socioprofessionnelle ou de la catégorie d’emploi | |
| Embauche | |
| Date d’embauche | |
| Relation à durée déterminée | |
| Date de la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission | |
| Ou durée du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission | |
| Travail temporaire | |
| Nom ou raison sociale de l’entreprise utilisatrice | 30 jours |
| Numéro SIRET de l’entreprise utilisatrice ou toutes autres références équivalentes | |
| Période d’essai | |
| Durée de la période d’essai : conformément aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21, aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, à l’article L. 1251-14 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | 7 jours |
| Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié : conformément à l’article L. 1221-26 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | |
| Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur : conformément à l’article L. 1221-25 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | |
| Formation professionnelle | 30 jours |
| Actions mises en œuvre ou prévues par l’employeur au titre de son obligation en matière de formation, conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail | |
| Congé payé | |
| La durée du congé payé : conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 à L. 3141-11 et L. 3141-21 à L. 3141-23 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | |
| Les modalités de calcul de la durée du congé payé, conformément aux articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | |
| Rupture du contrat | |
| En cas de licenciement pour motif personnel et de licenciement dans le cadre d’un accord de performance collective, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, R. 1232-1, R. 1232-2, R. 1232-3 du code du travail, aux articles L. 1232-6, L. 1235-2 et R. 1232-13 du code du travail et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif | |
| En cas de licenciement individuel pour motif économique et de licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail et le cas échéant à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| En cas de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-38, L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-43, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail et le cas échéant à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| En cas de démission, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| En cas de mise à la retraite, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-5 et L. 1237-7 et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| En cas de départ volontaire à la retraite, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| En cas de rupture conventionnelle individuelle, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14 et L. 1237-15 du code du travail. | |
| En cas de rupture dans le cadre d’un congé de mobilité, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L. 1237-18-4 | |
| En cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la procédure à observer par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 1237-19-1, L. 1237-19-2, L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4 du code du travail et lorsque la rupture intervient dans le cadre d’un congé de mobilité, aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L. 1237-18-4. | |
| En cas de rupture du contrat d’apprentissage, la procédure à suivre par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 6222-18, L. 6222-18-1, L. 6222-19, R. 6222-21, D. 6222-21-1 et R. 6222-23 du code du travai | |
| La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats internes mentionnés aux articles L. 2411-2 à L. 2411-14, L. 2411-17, L. 2412-2 à L. 2412-8, L. 2412-10, aux 1° à 8° et au 10° de l’article L. 2413-1 du code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que l’employeur a connaissance qu’un salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’au moins un de ces mandats, il lui transmet la procédure adéquate. | |
| La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats externes mentionnés aux articles L. 2411-15 et L. 2411-16, L. 2411-18 à L. 2411-25, L. 2412-9, L. 2412-11 à L. 2412-16, au 9° et au 11° à 15° de l’article L. 2413-1 ainsi qu’à l’article L. 2234-3 du code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que le salarié détenteur d’au moins un de ces mandats en informe son employeur, ce dernier lui transmet la procédure adéquate.Ces modalités relatives à la communication de la procédure adéquate s’appliquent si le salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’un mandat non visé dans le code du travail. | |
| Durée du préavis éventuel : conformément aux articles L. 1234-1, L. 1234-15, L. 1234-16, L. 1234-17, L. 1234-17-1 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| Documents de fin de contrat que doit remettre l’employeur au salarié lors de la rupture du contrat : certificat de travail conformément à l’article L. 1234-19 du code du travail, reçu pour solde de tout compte conformément aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du code du travail et attestation d’assurance chômage conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail | |
| Recours du salarié : le salarié voulant contester devant la juridiction prud’homale la rupture du contrat de travail dispose d’un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail. | |
| Rémunération | |
| Eléments constitutifs de la rémunération à indiquer séparément :- salaire de base ou minimum : fixé conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;- avantages en nature (s’il en existe) : fixés conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;- prime ou accessoire du salaire (s’il en existe) : fixé conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;- … | 7 jours |
| Majoration des heures supplémentaires ou complémentaires : conformément aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 3123-8, L. 3123-21, L. 3123-22 et L. 3123-29 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| Périodicité du versement de la rémunération : conformément aux articles L. 3242-1 du code du travail (salariés mensualisés) ou L. 3242-3 du code du travail (salariés non mensualisés) ou L. 3123-38 du code du travail (salariés en contrat de travail intermittent) et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| Modalités de paiement de la rémunération : conformément à l’article L. 3241-1 du code du travail. | |
| Durée du travail | |
| La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence : conformément aux articles L. 3121-18 à L. 3121-26 et L. 3121-41 à L. 3121-47 ainsi qu’aux articles L. 3123-6 à L. 3123-11 et L. 3123-27 du code du travail, ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| Heures supplémentaires ou complémentaires : conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-40 ainsi qu’aux articles L. 3123-6 à L. 3123-10, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] | |
| Modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes : conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. | |
| Conventions et accords collectifs | 30 jours |
| Liste des conventions et accords collectifs applicables au salarié | |
| Protection sociale | |
| Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié :Régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […] | |
| Chômage : […] | |
| Régime de retraite complémentaire : […] | |
| Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […] | |
| Date de remise du document | |
| Date : |
- le salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France et appelé à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives (article R. 1221-36 du code du travail). Les missions d’une durée égale ou inférieure à quatre semaines ne sont donc pas concernées ;
- le salarié détaché dans le cadre d’une prestation de services européenne (envoi dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, dans le cadre d’une prestation de services).
| Protection sociale |
| Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié : régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […] |
| Chômage […] |
| Régime de retraite complémentaire : […] |
| Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […] |
| Le présent document informe également le salarié sur les règles et conditions essentielles d’exercice des fonctions à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines en application de l’article R. 1221-36 du code du travail. Ces informations doivent lui être communiquées avant son départ à l’étranger, conformément à l’article R. 1221-37 du code du travail |
| Pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue |
| Pays : […] |
| Durée prévue : […] |
| Devise servant au paiement de la rémunération |
| Devise : […] |
| Eventuels avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées |
| Avantages en espèces : […] |
| Avantages en nature : […] |
| Le cas échéant, conditions de rapatriement du salarié |
| Rapatriement prévu : […] |
| Conditions du rapatriement : […] |
| Date de remise du document |
| Date : [ …] |
| Protection sociale complémentaire |
| Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié : régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […] |
| Chômage …[…] |
| Régime de retraite complémentaire : […] |
| Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […] |
| Le présent document informe également le salarié des règles et conditions essentielles d’exercice de ses fonctions en tant que travailleur détaché dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour une durée supérieure à quatre semaines en application de l’article R. 1221-36 du code du travail. Ces informations doivent lui être communiquées avant son départ à l’étranger, conformément à l’article R. 1221-37 du code du travail. |
| Pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et durée prévue |
| Pays […] |
| Durée prévue […] |
| Devise servant au paiement de la rémunération |
| Devise […] |
| Eventuels avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées |
| Avantages en espèces : […] |
| Avantages en nature : […] |
| Le cas échéant, conditions de rapatriement du salarié |
| Rapatriement prévu : […] |
| Conditions du rapatriement : […] |
| Rémunération prévue par le droit applicable de l’Etat d’accueil |
| Rémunération : […] |
| Allocations propres au détachement et modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture |
| Allocations : […] |
| Modalités de remboursement des dépenses de voyage, logement et de nourriture : […] |
| Adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil précisant les conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs détachés sur son territoire |
| https: // europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_fr.htm |
| Date de remise du document |
| Date : […] |


Apprentis et stagiaires : le Boss s’enrichit de deux nouvelles rubriques
Deux nouvelles rubriques ont été mises en ligne le 30 mai 2024 dans la partie « Allègements et exonérations » du Boss. Elles concernent l’exonération de cotisations applicable aux contrats d’apprentissage et le régime social applicable aux rémunérations des stagiaires. Ces contenus font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 12 juillet 2024. Une version amendée tenant compte des remarques faites dans le cadre de cette consultation pourra, le cas échéant, être mise en ligne. Sous cette réserve, ces nouvelles rubriques du Boss seront opposables à l’administration à partir du 1er septembre 2024, date à laquelle les circulaires DSS ayant le même objet seront abrogées. Tel est le cas notamment de la circulaire DSS 2007-236 du 14 juin 2007 relative à la protection sociale des stagiaires.
La nouvelle rubrique « Exonération applicable aux contrats d’apprentissage » rappelle tout d’abord les dispositions du Code du travail relatives au champ d’application du contrat d’apprentissage (employeurs concernés, travailleurs éligibles). Elle précise ensuite le régime applicable aux rémunérations versées aux apprentis.
Réduction générale de cotisations patronales
Le Boss rappelle que l’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage du secteur privé ne s’applique plus pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette date, c’est la réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique, ce régime étant exposé dans la rubrique du Boss relative aux allégements généraux (BOSS-Exo. Apprenti-50).
Exonération plafonnée pour les cotisations salariales
L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, dans la limite de 79 % du Smic. L’exonération couvre les cotisations de retraite complémentaire, y compris celles calculées au taux supplémentaire conventionnel. Mais elle n’intègre pas les cotisations liées à la prévoyance, à la complémentaire santé, aux accords de prévoyance et de mutuelle, ni la cotisation Apec, dans l’hypothèse où l’apprenti aurait le statut de cadre, ce qui est rare en pratique. Par ailleurs, la totalité du salaire versé est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS (BOSS-Exo. Apprenti-110).
Le plafonnement de l’exonération à 79 % du Smic s’apprécie mensuellement, sur la base de la rémunération réelle de l’apprenti. En cas d’absence ou de temps partiel, le plafond n’est pas modifié (BOSS-Exo. Apprenti-120).
En cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois, le plafond est modifié à l’instar de la méthode de proratisation du Smic retenue dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Il est alors corrigé du rapport entre la rémunération due par l’employeur et celle qui aurait été due si l’apprenti avait été présent sur l’ensemble du mois, après déduction, pour la détermination de ces deux montants, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que des primes forfaitaires et des diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (BOSS-Exo. Apprenti-120).
Exemple —————————————————————————————————————
Un apprenti est rémunéré 1 100 € par mois, dont 100 € de prime. Il n’effectue aucune heure supplémentaire et son contrat de travail s’achève le 15 mars. Si sa rémunération de base lors de ce mois est de 500 € et qu’il ne touche pas de prime, le plafond au-delà duquel l’exonération des cotisations salariales ne s’applique plus est égal pour ce mois à (Smic mensuel × 79 %) × (500 ⁄ 1 000) (BOSS-Exo. Apprenti-120).
——————————————————————————————————————————
Règles de cumul et d’articulation
Les réductions et exonérations de cotisations patronales et salariales sont cumulables avec l’aide unique à l’embauche d’apprentis ou l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur du montant du Smic annuel (BOSS-Exo. Apprenti-150). L’exonération de cotisations salariales, de CSG et de CRDS est cumulable avec la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article L 241-17 du CSS. Pour les apprentis dont la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic est déjà exonérée de l’ensemble des cotisations salariales, la réduction au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ne s’applique que sur la part de la rémunération supérieure à ce plafond, à proportion de la part de la rémunération due au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération (BOSS-Exo. Apprenti-140).
Exemple —————————————————————————————————————
Un apprenti est rémunéré mensuellement 1 652,46 €, dont 114,11 € d’heures supplémentaires. La rémunération de ces heures représente 114,11 € / 1 652,46 € = 6,91 % de la rémunération totale de ce mois. La rémunération excédant de 256,60 € le plafond de 79 % du Smic (1 395,86 € au 1-1-2024), la réduction ne s’appliquera donc que sur 6,91 % de la rémunération excédant 79 % du Smic, soit 17,73 € (BOSS-Exo. Apprenti-140).
——————————————————————————————————————————
Exonération applicable aux stagiaires
La nouvelle rubrique « Régime social applicable aux rémunérations des stagiaires » est divisée en trois chapitres :
– le stage en milieu professionnel. Il s’agit là des stages intégrés dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire ;
– les chantiers et stages à caractère éducatif. Cela vise les actions mises en œuvre à l’initiative de communes ou d’associations locales à destination de jeunes sans activité ou en difficulté. Ils ne concernent pas les employeurs de droit privé et ne sont donc pas développés ici ;
– le stage de la formation professionnelle continue. Ce dispositif concerne des demandeurs d’emploi non indemnisés et des jeunes de moins de 30 ans peu ou pas qualifiés qui sont rémunérés par l’État, la région ou l’Opco.
Stage en milieu professionnel
Dans sa nouvelle rubrique relative au régime social des sommes versées aux stagiaires en milieu professionnel, le Boss reprend pour l’essentiel la doctrine administrative antérieure. Nous avons toutefois relevé quelques points qui en diffèrent ou apportent des précisions, que nous exposons ci-après.
Pour rappel, les stages de plus de 2 mois doivent obligatoirement faire l’objet d’une gratification. À défaut d’accord plus favorable le montant de celle-ci est alors d’au moins 669,90 € par mois (pour un temps plein de 7 heures par jour sur 22 jours travaillés, soit un taux horaire minimum de 4,35 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 29 € en 2024).
Pour les stages de 2 mois et moins, l’employeur n’est pas tenu de verser une gratification mais peut décider d’en verser une, du montant qu’il souhaite. Qu’elle soit obligatoire ou non, la gratification fait l’objet d’une franchise de cotisations.
Cotisations visées par la franchise
Le Boss indique que la part des gratifications qui excède le plafond de l’exclusion d’assiette sociale est assujettie dans les conditions de droit commun aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie et au Fnal (BOSS-Exo. Stage-80). La part de gratification en dessous de ce plafond est affranchie de ces cotisations et contributions.
A noter : Une circulaire DSS du 14 juin 2007 citait également, parmi les cotisations et contributions concernées par la franchise de cotisations, le versement de transport, devenu depuis « versement mobilité » (Circ. DSS 2007-236 du 14-6-2007).
On peut penser qu’il s’agit d’un oubli, mais ce point sera à contrôler lors de la mise en ligne de la version « finale » du Boss à l’issue de la consultation, d’autant plus que le document de synthèse mis en ligne sur le site internet des Urssaf ne mentionne plus non plus le versement mobilité (Doc. Urssaf « Accueillir un stagiaire étudiant », publié le 22-1-2024).
On peut aussi signaler que le Boss indique que la part de gratification qui dépasse le plafond de l’exclusion d’assiette sociale ne bénéficie pas de la réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie (BOSS-Exo. Stage-80).
Même si ce point ne faisait guère de doute étant donné que l’administration s’était prononcée en ce sens pour la réduction de 1,8 point du taux des cotisations d’allocations familiales (Circ. Acoss 2015-42 du 2-7-2015), cette précision, nouvelle, est bienvenue.
Appréciation du plafond de la franchise
Le Boss précise que, pour l’appréciation du plafond d’exclusion de l’assiette sociale, les éventuels avantages en nature (autres que les avantages de repas) sont pris en compte (BOSS-Exo. Stage-80).
A noter :
Cette formulation générale exclut, selon nous, pour l’appréciation du plafond d’exclusion de l’assiette sociale, tous les avantages de repas, qu’il s’agisse de l’accès à la cantine, de la participation au financement de titres-restaurant ou encore de l’attribution de repas gratuite, obligatoire dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR), et ce, que la gratification soit facultative ou obligatoire.
Si elle est confirmée dans la version finale de la rubrique, cette rédaction permettrait de lever certaines ambiguïtés qui pouvaient subsister sur ce point du fait de tournures diverses employées par l’administration dans plusieurs circulaires (Circ. DSS 2007-236 du 14-6-2007 ; Circ. Acoss 2008-091 du 29-12-2008 ; Circ. Acoss 2015-42 du 2-7-2015) et sur le site internet des Urssaf (qui n’exclut expressément que l’accès à la cantine et uniquement lorsque la gratification est facultative : Doc. Urssaf « Accueillir un stagiaire étudiant », publié le 22-1-2024, précité) et qui ne permettaient pas de dégager une solution claire sur ce point.
On peut regretter que le Boss ne donne aucun exemple permettant de s’assurer de la portée de la règle énoncée ci-dessus et espérer que la version mise en ligne à l’issue de la concertation publique soit enrichie d’exemples sur ce point illustrant les différents cas de figure possibles (régime social applicable en cas d’accès à la cantine et/ou d’attribution de titres-restaurant selon que le stagiaire est gratifié ou non gratifié et, en cas de gratification, selon qu’elle atteint ou non le plafond d’exclusion de l’assiette sociale).
Notons que l’article D 136-1 du CSS dispose que le plafond d’exclusion est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. L’exclusion des avantages repas pour l’appréciation du plafond constitue donc une tolérance administrative.
Stage de la formation professionnelle continue
La nouvelle rubrique du Boss relative au régime social des sommes versées aux stagiaires de la formation professionnelle continue reprend les règles existantes quant au champ d’application du dispositif et au calcul des cotisations dues sur ces sommes.
Le Boss rappelle également que le stagiaire de la formation professionnelle est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale, soit à celui dont il relevait avant son stage, soit, à défaut, au régime général (Boss-Exo. Stage-180).
Champ d’application
Le dispositif concerne les demandeurs d’emploi qui relèvent du statut de stagiaire de la formation continue et qui ne sont pas rémunérés (demandeurs d’emploi non indemnisés, apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture…) ou qui sont rémunérés par l’État, l’opérateur de compétences (Opco) ou la région.
Sont également concernés les jeunes de moins de 30 ans qui effectuent, dans un organisme public ou privé, des stages correspondant à des actions d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation, d’appui à la définition d’un projet professionnel, d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle (Boss-Exo. Stage-180).
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour ces jeunes, qui est fixée par l’arrêté MTRD2113600A du 31 mai 2021, est reprise dans le BOSS (Boss-Exo. Stage-180).
Calcul des cotisations
Les cotisations de sécurité sociale salariales et patronales des stagiaires non rémunérés ou rémunérés par l’État, l’Opco ou la région sont calculées au taux de droit commun. Elles sont dues pour chaque heure de stage ainsi que, pour les heures de congés payés rémunérées et, pour les stages à temps plein, les heures d’absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération (Boss-Exo. Stage-190).
La CSG et la CRDS ne sont pas dues sur la gratification versée par l’État, l’Opco ou la région (BOSS-Exo. Stage-220).
Les cotisations dues sont intégralement prises en charge par l’opérateur ou l’administration publique.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire revalorisée au 1er janvier de chaque année compte tenu de l’évolution du plafond de la sécurité sociale (Boss-Exo-Stage-200).
Le Boss rappelle qu’au 1er janvier 2024 cette base est égale à 1,96 € et donne les taux et montants de cotisations applicables en 2024. Ainsi, pour un stagiaire non rémunéré ou rémunéré par l’État, le total des cotisations s’élève à 0,75 € par heure en 2024.
Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, une cotisation supplémentaire maladie s’applique au taux de 1,30 % (soit 0,02 € par heure en 2024).
L’entreprise d’accueil peut verser un complément de rémunération au stagiaire de la formation professionnelle. Le Boss rappelle que celui-ci, quelle que soit sa dénomination, est soumis à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, y compris à la CSG et à la CRDS, dès le premier euro (Boss-Exo. Stage-220).


Des propos à connotation sexuelle peuvent fonder un licenciement même s’ils ont dans un premier temps été tolérés par la hiérarchie
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 12 juin 2024, un salarié est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La mise à pied est levée 25 jours plus tard dans la perspective d’une convocation devant le conseil de discipline conventionnel auquel l’employeur – le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) – soumet une proposition de mise à pied d’une durée d’un mois.
Le salarié est finalement licencié pour faute simple, pour avoir tenu, de manière réitérée, des propos injurieux, dégradants et humiliants à connotation sexuelle à l’encontre de plusieurs collègues féminines.
La cour d’appel relève que le salarié avait bien tenu, auprès de certains collègues de travail, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de collègues de sexe féminin et qu’il avait déjà tenu par le passé des propos similaires, connus de sa hiérarchie mais non sanctionnés à l’époque. Elle estime que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la sanction était disproportionnée, l’employeur n’ayant pas sanctionné plus tôt un comportement dont il avait connaissance et ayant envisagé initialement une mise à pied disciplinaire avant de saisir le conseil de discipline conventionnel.
L’employeur se pourvoit en cassation. Il considère pour sa part :
- qu’il était de son devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dégradants à connotation sexuelle et attentatoires à la dignité, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ;
- que constitue une faute justifiant le licenciement tout comportement d’un salarié de nature insultante, humiliante, dégradante, sexiste ou de nature sexuelle à l’égard d’autres salariés, nonobstant le fait que ce comportement réitéré n’ait pas immédiatement été sanctionné ou qu’il ait pu être toléré dans un premier temps par ses supérieurs, ce fait ne conférant pas au salarié une immunité pour l’avenir contre toute mesure de licenciement et ne privait pas l’employeur de la faculté de le licencier par la suite en raison de la réitération de ces manquements ;
- qu’il avait la faculté de faire évoluer sa position pendant la procédure disciplinaire et avant le prononcé de la sanction définitive et qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir tenu compte de l’avis de l’organe disciplinaire paritaire précisément consulté pour avis.
La Cour de cassation approuve l’argumentation de l’employeur et censure, ce faisant, celle de la cour d’appel.
Elle rappelle en premier lieu qu’en vertu de l’article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Elle rappelle également que, selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.
Elle en déduit que le comportement du salarié était de nature à caractériser, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.


Contestation du licenciement au titre de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur : des précisions sur la prescription
Pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’action en contestation du licenciement au titre de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur (Cassation n° 22-19.401).
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail à compter du 20 février 2013 et licenciée le 23 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail le 5 octobre 2015, avait saisi le conseil de prud’hommes le 18 mai 2016 non seulement d’une demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais encore d’une demande visant à contester le bien-fondé du licenciement, en soutenant que son inaptitude était consécutive à ce manquement.
En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cassation 17-10-2012 n° 11-18.648 ; Cassation 3-5-2018 n°s 17-10.306 et 16-26.850 ; Cassation 6-7-2022 n° 21-13.387).
Notons que, à la date des faits, le délai de prescription des deux actions était régi par l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La cour d’appel avait déclaré les deux actions irrecevables sur le fondement de ce texte, retenant que la salariée avait eu connaissance des manquements qu’elle reprochait à l’employeur à la date de l’arrêt de travail, soit plus de 2 ans avant l’introduction de son action devant le conseil de prud’hommes. La salariée contestait dans son pourvoi l’irrecevabilité prononcée concernant les deux demandes.
A noter : Depuis l’ordonnance précitée, le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail est réduit à 12 mois.
En principe, le point de départ du délai de prescription d’une telle action correspond à la date à laquelle le salarié a connaissance des manquements de l’employeur. La salariée soutenait que, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est à l’origine d’une inaptitude, le point de départ de la prescription ne peut être que la déclaration d’inaptitude. Elle estimait que c’est seulement à cette date qu’un salarié peut avoir connaissance de l’incidence effective sur son état de santé des agissements de l’employeur.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Reprenant sa jurisprudence quant à l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la connaissance des manquements invoqués (Cassation 24-1-2018 n° 16-27.486 ; Cassation 4-7-2019 n°s 18-19.722 et 18-20.215), elle approuve la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription à la date de l’arrêt de travail de la salariée, le 20 février 2013.
A noter : Aucune règle n’impose aux juges du fond, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est suivi d’une déclaration d’inaptitude, de retenir cette déclaration comme point de départ du délai de prescription et, en l’espèce, les motifs de la cour d’appel retenant que la salariée avait eu connaissance à la date de son arrêt de travail des faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire n’étaient pas impropres. Le caractère très factuel des manquements à l’obligation de sécurité susceptibles d’être invoqués exclut en effet en la matière la détermination d’un point de départ général pour le délai de prescription (hormis des hypothèses très spécifiques, notamment dans l’action en réparation du préjudice d’anxiété pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité par exposition à des substances toxiques générant un risque élevé de développer des maladies graves, pour lequel le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à ces substances, point de départ qui ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin [Cassation 8-7-2020 n° 18-26.585]).
Concernant l’action en contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence fixant un point de départ unique du délai de prescription à la date de notification de ce licenciement (Cassation 9-10-2012 n° 11-17.829 ; Cassation 6-11-2019 n° 18-22.874). On rappellera d’ailleurs que, depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L 1471-1 du Code du travail prévoit expressément en son deuxième alinéa que le point de départ de l’action portant sur la rupture du contrat de travail est la date de la notification de la rupture.
En l’espèce, la chambre sociale en déduit, pour la première fois, que le salarié qui conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, le délai de prescription de l’action portant sur le licenciement ayant débuté le 24 décembre 2015, lendemain de la rupture du contrat de travail, l’action engagée par la salariée le 18 mai 2016 était recevable et celle-ci pouvait se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité même si l’action en dommages-intérêts liée à ce manquement était irrecevable.
A noter : La distinction faite entre le point de départ de l’action en responsabilité dirigée contre l’employeur à raison du manquement à son obligation de sécurité et celui de l’action en contestation du bien-fondé du licenciement au titre de ce manquement se situe en réalité dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale qui s’attache à l’objet de l’action, et non au moyen invoqué à son soutien, pour déterminer le régime de prescription applicable : s’agissant du bien-fondé du licenciement, ce ne sont pas les manquements éventuels de l’employeur qui seraient susceptibles d’en être à l’origine qui doivent être pris en considération pour rechercher le point de départ du délai de prescription, mais bien uniquement la date de notification du licenciement qui est contesté. En ce sens, la décision peut être rapprochée des décisions rendues en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cassation 27-11-2019 n° 17-31.258) et de résiliation judiciaire (Cassation 30-6-2021 n° 19-18.533 ; Cassation 27-9-2023 n° 21-25.973), qui font primer la date de la rupture (soit, dans le cas de la résiliation judiciaire, la poursuite de la relation de travail) sur toute autre considération – notamment quant aux manquements invoqués à l’appui de la demande – pour la détermination du point de départ du délai de prescription de la contestation de l’imputabilité de la rupture.


Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entreprise
Les élections législatives se dérouleront les 30 juin et 7 juillet 2024. La campagne officielle débute le 17 juin et pourrait faire intervenir des candidats issus de la société civile. L’employeur peut-il limiter l’expression des opinions politiques sur le lieu de travail ? De quels droits bénéficie le salarié candidat aux élections ou élu ? Comment réintégrer un salarié élu ayant perdu son mandat avec la dissolution de l’Assemblée nationale ?
Les salariés sont libres de leurs opinions et peuvent les exprimer dans l’entreprise au temps et au lieu du travail. On ne peut y apporter de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et sont proportionnées au but recherché (article L 1121-1 du code du travail).
Ainsi, l’employeur ne peut pas interdire les discussions politiques entre collègues. Il a d’ailleurs été jugé que la clause du règlement intérieur de l’entreprise qui prohibe ce sujet de conversation entre salariés est illicite (CE 25-1-1989 n° 64296). Le règlement intérieur peut toutefois contenir une clause dite «de neutralité» , dès lors que les restrictions qu’elle prévoit sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, et qu’elles sont proportionnées au but recherché (article L 1321-2-1 du Code du travail). En pratique, cette clause n’est le plus souvent admise que pour les salariés en contact avec la clientèle.
Si le salarié est libre d’exprimer des opinions politiques sur le lieu de travail, il est également en droit de taire ses convictions. De manière générale, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il émette une opinion ou qu’il prenne publiquement une position (Cassation 26-10-2005 n° 03-41.796). Toute sanction ou tout licenciement décidé en raison des opinions politiques du salarié est abusif. Ainsi jugé à propos de la rupture de la période d’essai d’un salarié motivée, non par un manquement à ses obligations professionnelles, mais par l’expression de ses opinions politiques au cours d’un repas à la suite d’une provocation intentionnelle de l’employeur (Cassation 27-6-1990 n° 86-41.009). Une telle mesure peut constituer une discrimination (article L 1132-1 du code du travail), l’employeur étant passible de sanctions pénales (article 225-1 à 225-4 du Code pénal).
A noter : Le salarié doit-il nécessairement être solidaire des engagements politiques de son employeur ? Il semble que non. Il a par exemple été jugé que, si un secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, on ne peut pas lui reprocher de se retirer de la liste électorale préparée par ce dernier en vue des élections (Cassation 28-4-2006 n° 03-44.527). De même, le salarié d’une association intercommunale est en droit d’apporter son soutien au candidat opposé au maire sortant d’une des communes membres de cette association (CA Grenoble 22-6-1992 n° 91-883).
L’engagement politique d’un salarié ne doit pas causer de troubles dans l’entreprise ni le conduire à commettre des fautes professionnelles. Tel est le cas, par exemple, lorsque le salarié s’absente de son poste pour distribuer des tracts électoraux (CA Paris 5-12-2013 n° 12-00973). Par ailleurs commet une faute grave le salarié d’un établissement pour personnes âgées qui, pendant ses heures de travail, exerce un militantisme politique actif en direction des personnes, psychologiquement fragiles, accueillies dans l’établissement et se fait remettre par l’un d’eux un chèque au profit d’une association collectant des fonds pour financer la campagne électorale d’un homme politique (CA Toulouse 4-3-2011 n° 09-6144).
De même est justifié par une faute grave le licenciement du salarié qui affranchit aux frais de l’employeur, à des fins personnelles et sans autorisation, des invitations dans le cadre d’une campagne municipale, créant pour l’entreprise un risque sérieux de poursuites pénales en matière de financement illégal d’une campagne électorale (CA Versailles 14-3-2012 n° 10-05816).
A noter : Si les faits se déroulent en dehors du temps et du lieu du travail, dans le cadre de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. Par exemple, un salarié ne commet pas de faute en remettant à un collègue le programme du parti politique auquel il appartient, à l’issue d’un salon professionnel auquel ils participent (Cassation 29-5-2024 n° 22-14.779). En effet, le salarié n’a pas commis un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, les faits relevant de sa vie privée. En revanche, l’employeur pourrait envisager un licenciement motivé par le trouble au bon fonctionnement de l’entreprise si, du fait de la remise de ce tract, des dissensions naissaient entre le salarié et ses collègues, les empêchant de travailler ensemble.
Le salarié candidat aux élections législatives a droit, quelle que soit son ancienneté, à un congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale. Pour en bénéficier, il doit avertir son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque absence, ce congé pouvant être fractionné en demi-journées. L’employeur ne peut pas s’y opposer. Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté (articles L 3142-79 à L 3142-82 du code du travail). Sur demande du salarié, ses absences peuvent être imputées sur les droits à congés payés qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin — cette année, le 30 juin 2024. À défaut, elles ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à récupération, en accord avec l’employeur (article L 3142-81 du Code du travail).
Une fois élu, le salarié titulaire d’un mandat parlementaire bénéficie de droits à congés destinés à lui permettre d’exercer ses fonctions. Le salarié élu à l’Assemblée nationale peut suspendre son contrat de travail pendant la durée de son mandat s’il justifie d’une ancienneté chez son employeur d’au moins un an à la date de son entrée en fonction (article L 3142-83 du Code du travail).
A noter : Si l’ancienneté du salarié est inférieure à un an, il ne peut pas prétendre à la suspension de son contrat de travail. Or l’exercice d’un mandat parlementaire paraît difficilement conciliable avec l’exécution d’un contrat de travail. En outre, le Code électoral prohibe l’exercice de certaines activités pour limiter les conflits d’intérêts. Si le salarié élu ne prend pas l’initiative de rompre le contrat de travail et, accaparé par son mandat, ne vient plus travailler, l’employeur peut lui reprocher un abandon de poste. Dans ce cas, il peut prononcer un licenciement disciplinaire pour ce motif. Il peut également appliquer la procédure de présomption de démission prévue par l’article L 1237-1-1 du Code du travail, et mettre en demeure le salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail dans le délai qu’il lui impartit. Si le salarié ne répond pas, il est présumé démissionnaire. Si le salarié répond et justifie son absence par l’exercice de son mandat parlementaire, la question se pose de savoir si ce motif peut être considéré comme légitime et de nature à faire obstacle à la présomption de démission. Ce n’est probablement pas le cas, mais ni l’administration ni la jurisprudence ne se sont prononcées sur cette question. Un décret aurait dû préciser les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, sont conservés pendant la durée du mandat (article L 3142-86 du code du travail). Toutefois, ce texte n’est pas encore intervenu à ce jour.
La suspension du contrat de travail prend effet 15 jours après que le salarié a notifié sa décision à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception (article D 3142-59 du code du travail). Le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur pendant cette période.
A notre avis : L’employeur ne peut pas s’opposer à la décision du salarié de suspendre son contrat de travail, même si l’intéressé ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée. Les juges considèrent généralement que les règles de forme prévues par le Code du travail ne conditionnent pas le droit du salarié à congé et ne constituent qu’un élément de preuve en cas de litige avec l’employeur. Les nombreuses décisions en ce sens ont été rendues à propos d’autres congés, mais sont selon nous transposables au congé pour exercice d’un mandat parlementaire.
À l’expiration de son premier mandat, le salarié qui le souhaite peut être réintégré dans l’entreprise. Pour cela, il doit informer l’employeur, dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat et par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de reprendre son poste. L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour réintégrer le salarié (aticles L 3142-84 et D 3142-60 du code du travail). Attention : l’employeur doit veiller à respecter ce délai de 2 mois. À défaut, il peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice : ainsi jugé à propos d’un employeur qui a volontairement fait traîner la procédure de réintégration, tentant ainsi de décourager le salarié de reprendre son poste (CA Paris 23-3-2017 n° 15/10429).
A noter : En d’autres termes, l’obligation de l’employeur de réintégrer le salarié ne court qu’à partir du moment où ce dernier se manifeste. Sans nouvelles, l’employeur peut considérer que le contrat de travail reste suspendu. Si toutefois le salarié tarde trop à se manifester, l’employeur peut avoir intérêt à lui adresser un courrier, en recommandé avec avis de réception, lui enjoignant de justifier des raisons de son absence ou de reprendre le travail.
Le salarié retrouve son précédent emploi ou, si celui-ci n’existe plus ou n’est plus vacant, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat. Il bénéficie, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail (aticle L 3142-84 du code du travail).
Le salarié ne bénéficie pas d’un droit à réintégration dans les cas suivants (article L 3142-85 du Code du travail) :
– le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension correspondant au premier mandat n’ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à 5 ans ;
– l’intéressé, titulaire d’un mandat de député, est élu au Sénat (ou inversement).
A noter : Bien que l’article L 3142-85 du Code du travail ne le prévoie pas expressément, il s’en déduit que le contrat de travail du salarié dont le mandat est renouvelé peut être rompu. Si le salarié ne prend pas l’initiative de démissionner, que peut faire l’employeur ? Selon nous, il ne doit pas considérer que le contrat de travail est rompu de plein droit en cas de renouvellement du mandat. Sauf accord avec le salarié, il peut engager une procédure de licenciement — non disciplinaire — en motivant la rupture par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en application de l’article L 3142-85 du Code du travail. À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur cette question.
À l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre (article L 3142-85 du code du travail). Il peut solliciter sa réembauche auprès de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat (article D 3142-61 du code du travail). En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ (article L 3142-85 du code du travail).

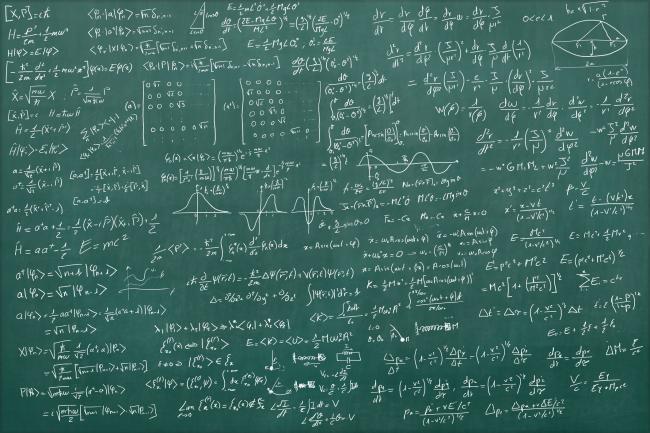
Réduction générale de cotisations patronales et indemnité compensatrice de congés payés
Les rémunérations inférieures à 1,6 Smic ouvrent droit à la réduction générale de cotisations patronales laquelle est calculée en multipliant la rémunération annuelle par un coefficient déterminé comme suit :
(T/0,6) × (1,6 × [(Smic annuel + (Smic horaire × nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)] / rémunération annuelle brute) -1.
La valeur « T » est égale à la somme des taux cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction.
Si le salarié n’a pas été présent toute l’année, le Smic pris en compte dans cette formule pour le mois où a lieu l’absence est corrigé selon le rapport entre les revenus d’activité dus (tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale) et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération non affectés par l’absence. Issue du décret 2010-1779 du 31 décembre 2010 et codifiée à l’article D 241-7 du CSS, cette règle s’applique depuis 1er janvier 2011.
S’agissant des diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (telles que les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de contrat), l’administration a précisé, qu’en application de cette règle, elles ne sont pas prises en compte pour déterminer le prorata de Smic à intégrer dans la formule de calcul (Circ. DSS 2015-99 du 1-1-2015 et BOSS-All.-gén.-800). Cette interprétation est ici confirmée par la Cour de cassation (Cassation n° 22-15.135), de sorte qu’elle était applicable depuis le 1er janvier 2011.
A noter : La règle litigieuse est de nature à réduire, voire annuler, le montant de la réduction générale dont bénéficie l’employeur puisque, si les indemnités de rupture ne sont pas prises en compte pour déterminer le prorata de Smic, elles sont en revanche retenues dans la rémunération annuelle brute si elles sont soumises à cotisations (BOSS-All. gén.-580).
En l’espèce, la cour d’appel avait annulé le redressement opéré au titre de l’année 2012 au vu des circonstances suivantes : la société produisait un courrier envoyé par l’Urssaf du Jura à son éditeur du logiciel paie le 16 janvier 2012 selon lequel la question de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés avait été posée au ministère et celui-ci avait attendu l’année 2015 pour préciser, via une circulaire, le sort de ces indemnités au regard de la réduction générale de cotisations patronales. Ces motifs étant impropres à faire échec à l’application d’un texte réglementaire, sa décision est censurée par la Cour de cassation.
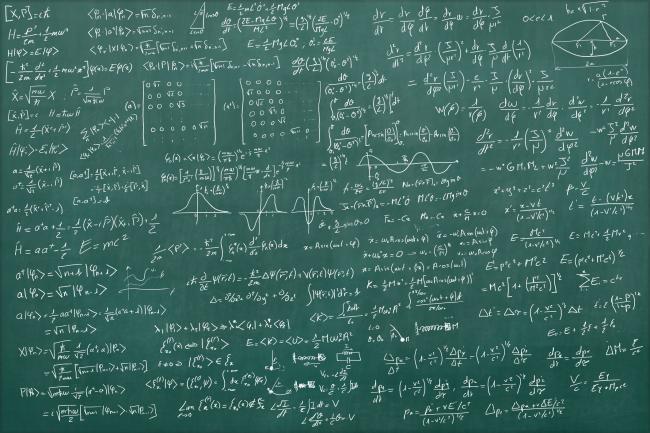

Dans quels cas le dispositif d’activité partielle pourra-t-il être mobilisé pendant les JO ?
Le ministère du travail précise, dans un questions-réponses diffusé sur son site internet le 6 juin 2024, les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’activité partielle par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des jeux olympiques et paralympiques.
En principe, non. Pour l’administration, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle, sauf cas exceptionnels, et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison des JO. Les entreprises sont invitées à privilégier les mesures alternatives à l’activité partielle notamment les mesures d’organisation du travail (adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, …). Le ministère conseille également d’anticiper les conséquences des restrictions de circulation pendant les JO en s’informant des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones concernées et en s’inscrivant si nécessaire sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de police de Paris.
Non, sauf cas très exceptionnel. En effet, les restrictions de circulation des véhicules motorisés prévues par la préfecture de police dans les zones de sécurité sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les informations relatives aux périmètres de sécurité, la liste des véhicules autorisés sont disponibles sur le site de la préfecture de police, permettant ainsi aux entreprises et aux salariés d’anticiper leurs déplacements.
Toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas, dès lors que l’entreprise serait en mesure de démontrer la réalité du lien entre ces mesures de restriction et la baisse significative de son activité.
Les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle à la condition de démontrer que leur baisse d’activité y est bien directement liée.
Le ministère précise que tout dépôt de demande en lien avec les JO devra se faire sur le motif «conjoncture économique» visé au 1° de l’article R 5122-1 du Code du travail. Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’Etat de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. Pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, l’avis du comité social et économique doit être transmis avec cette demande.
Pour justifier de leur demande d’autorisation préalable d’activité partielle, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JO.

