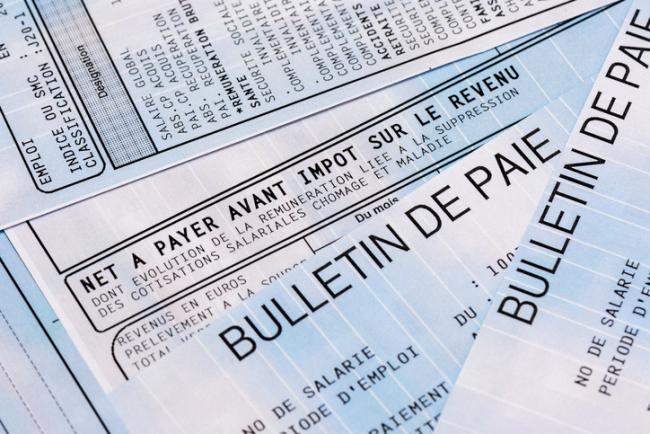ACTUALITÉ
SOCIAL

Défaut d’affiliation d’un salarié au régime de prévoyance complémentaire obligatoire : l’action du salarié se prescrit par 5 ans
Dans cette affaire, un agent multiservices est placé en invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2014 et perçoit une pension d’invalidité de la part de la sécurité sociale. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il sollicite alors le versement d’une rente d’invalidité auprès de l’organisme assureur du régime de prévoyance de son entreprise. Celui-ci rejette sa demande au motif que la souscription du contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date de placement en invalidité.
► Notons que l’employeur était pourtant tenu de couvrir ce risque par sa branche.
Le 1er janvier 2018, le salarié est placé en invalidité de deuxième catégorie et, le 15 janvier suivant, il saisit la justice pour solliciter notamment l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’action en réparation du salarié, considérant que, en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, celle-ci se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le salarié ayant été placé en état d’invalidité dès le 1er janvier 2014, c’est à cette date que le délai de deux ans commençait à courir. Son action est donc prescrite.
► L’article L.1471-1 du code du travail fixe le délai de prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Les juges d’appel ne remettent pas en cause le délai de prescription de l’action mais le point de départ de ce délai : celui-ci est fixé au jour où le salarié a été informé du refus de prise en charge de son invalidité (soit le 2 février 2017). Son action n’est donc pas prescrite.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation écarte des débats la question du point de départ mais se focalise sur le délai de prescription.
Pour elle, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription des actions personnelles ou mobilières de droit commun fixée par l’article 2224 du code civil. L’action du salarié se prescrivant par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, elle n’est donc pas prescrite, quel que soit le point de départ du délai retenu.

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise
Selon le site Ameli, le compte entreprise s’étoffe et intègre les fonctionnalités du compte AT/MP, réunissant ainsi en un seul point d’entrée tous les services en ligne de l’assurance maladie et de l’assurance maladie – risques professionnels sur net-entreprises.fr.

Contre-visite de l’employeur : les modalités sont enfin fixées
L’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix. L‘article L.1226-1 du code du travail prévoit en effet que l’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident doit être constatée par certificat médical et par une contre-visite organisée par l’employeur s’il y a lieu.
L’article L.1226-1 du code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. Ce décret – qui n’avait jamais été publié jusqu’à présent – vient de l’être le 6 juillet. Il crée quatre nouveaux articles dans le code du travail (articles R.1226-10 à R.1226-12 du code du travail), qui organisent la contre-visite de l’employeur.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 7 juillet 2024.
► En l’absence de dispositions réglementaires, la jurisprudence avait défini de nombreuses règles qui restent d’actualité.
En premier lieu, le nouvel article R.1226-10 du code du travail précise que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile. Il doit également porter à sa connaissance les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».
► L’avis d’arrêt de travail comporte une rubrique « adresse où le malade peut être visité (si différente de l’adresse habituelle) » qui doit être renseignée le cas échéant. Le volet n° 3 est transmis par le salarié à l’employeur.
En cas de changement de lieu de convalescence en cours d’arrêt de travail, le salarié devra en informer l’employeur afin que celui-ci puisse effectuer une éventuelle contre-visite médicale.
Par ailleurs, la jurisprudence avait déjà admis que le salarié disposant d’un arrêt de travail en « sortie libre » devait informer l’employeur des horaires au cours desquels les contre-visites peuvent s’effectuer (arrêt du 4 février 2009), afin de permettre le contrôle de son état de santé.
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Il se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (article R.1226-11 du code du travail).
La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il lui a communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. En cas d’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en en précisant les raisons.
L’article R.1226-12 du code du travail prévoit que le médecin informe l’employeur :
- soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
- soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile).
L’employeur transmet également sans délai cette information au salarié.
Au terme de sa contre-visite, le médecin doit également respecter les obligations issues du code la sécurité sociale (article L.315-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, lorsque le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié malade, il transmet, dans un délai de 48 heures, son rapport au service médical du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale.
Au vu de ce rapport, le médecin-conseil de l’assurance-maladie peut demander à la caisse :
- soit de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités, pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève, un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la saisine du salarié ;
- soit de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Si, après examen de l’assuré, le médecin-conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il en informe immédiatement l’intéressé et lui communique oralement une date de reprise du travail. Il informe également les services administratifs de la caisse et le médecin traitant (article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale).
L’employeur est alors en droit de ne pas verser les prestations complémentaires (arrêt du 26 octobre 1982).
► Rappelons que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait tenté de renforcer les conséquences de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur sur le versement des IJSS. Dans une décision du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel avait censuré cette mesure.

La réforme de l’assiette sociale des TNS a son décret
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette sociale des travailleurs non salariés à compter des cotisations et contributions dues au titre de 2025 pour les professions non agricoles (au titre de 2026 pour les TNS agricoles). Un décret (n° 2024-688) vient d’être publié pour en préciser certaines modalités telles que le plancher et le plafond de l’abattement relatifs à cette assiette.

Partage de la valeur : de nouveaux cas de déblocage
Neuf cas de déblocage anticipé de la participation et des sommes investies dans un PEE (plan d’épargne entreprise) sont déjà prévus par le code du travail (articles L. 3324-10, L.3 332-25 et R. 3334-22 modifiés du code du travail). Cette liste est complétée par trois nouveaux cas de déblocage :
- l’affectation à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale : les travaux visés sont les travaux de rénovation énergétique éligibles à l’éco-PTZ listés aux articles D.319-16 et D.319-17 du code de la construction et de l’habitation (exemples : travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ou des toitures) ;
- l’achat d’un véhicule utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie (camionnette, voiture, deux ou trois roues, quadricycles à moteur), ou d’un cycle à pédalage assisté neuf (article R.311-1 du code de la route) ;
- l’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d’un proche tel que défini aux articles L.3142-16 et L.3142-17 du code du travail relatifs au congé de proche aidant.
► Le renvoi aux dispositions relatives au congé de proche aidant implique-t-il que le salarié, son conjoint ou son partenaire pacsé soit effectivement en congé de proche aidant pour bénéficier du déblocage anticipé des avoirs ? Nous ne le pensons pas. Le renvoi à ses articles n’est limité qu’à la définition des proches pouvant être aidé dans le cadre d’un tel congé. Cette interprétation est corroborée par le fait que la demande de déblocage anticipée à ce titre peut être faite à tout moment et pas seulement au moment du congé (voir développements ci-après). Une confirmation administrative serait toutefois bienvenue.
La demande des deux premiers cas de déblocage anticipé (rénovation énergétique et véhicule propre) doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
► Quel est le fait générateur pris en compte pour ces deux cas ? Pour les travaux de rénovation énergétique, le fait générateur pourrait être, à l’instar du cas de déblocage relatif à la construction ou l’agrandissement de la résidence principale, la date du devis ou la date de facture d’achat des matériaux si le salarié réalise ces travaux lui-même. Pour le véhicule propre, il pourrait s’agir de la date d’achat ou de signature du bon de commande. Il serait souhaitable que l’administration précise les pièces justificatives à fournir pour ces deux cas de déblocage.
La demande du cas de déblocage anticipé pour l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment (article R.3324-23 modifié du code du travail).
Ces dispositions s’appliquent :
- pour les déblocages liés à la rénovation énergétique et à l’achat d’un « véhicule propre », aux faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire à ceux survenus après le 7 juillet 2024 ;
- pour les déblocages liés à l’activité de proche aidant, aux demandes présentées après le 7 juillet 2024.
La loi de transposition du 29 novembre 2023 a mis en place deux dispositifs expérimentaux de partage de la valeur, l’un dans les entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place la participation, l’autre dans certaines entités d’au moins 11 salariés du secteur de l’économie sociale et solidaire. Dans les deux cas, l’effectif pour apprécier le seuil de 11 salariés doit être déterminé selon les modalités prévues à l’article L.130-1, I du code de la sécurité sociale.
Ces modalités doivent également être utilisées pour apprécier le seuil de 50 salariés applicable pour l’exonération d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS des primes de partage de la valeur versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à des salariés percevant une rémunération inférieure à trois fois le Smic annuel.
Pour apprécier ces seuils, il faut donc retenir l’effectif « Sécurité sociale » , à savoir la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Attention ! L’article 1er du décret précité ne visant que le I de l’article L.130-1, le gel du franchissement de seuil pendant cinq ans (visé, lui, au II de l’article L. 130-1) n’est pas applicable pour ces dispositifs.
L’accord d’intéressement ou de participation doit indiquer, en cas de versement d’avances, les modalités de recueil de l’accord du salarié et « l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation » (articles R.3313-2 et R. 3324-21-1 modifiés du code du travail).
► La rédaction adoptée par le décret nous semble maladroite car elle laisse supposer que la restitution des sommes en cas d’affectation des sommes sur un plan est impossible. A notre avis, si l’avance a été placée sur un plan d’épargne salariale (donc bloquée), l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire, la somme placée étant considérée comme un versement volontaire n’ouvrant pas droit aux exonérations liées au dispositif.
Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise contre récépissé l’informant de cette possibilité.
A défaut d’accord exprès du salarié sur le principe du versement d’une avance au titre de la participation ou de l’intéressement, aucune avance ne lui est versée (article D. 348-1 nouveau du code du travail).
►Pour des détails sur l’information individuelle à fournir aux salariés, voir notre article du 3 juillet 2024.
Le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 complète les dispositions du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.
Pour rappel, le plafond annuel des versements de l’employeur complétant la contribution du salarié à un PEE est fixé à 8 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
Il prend en compte, le cas échéant, le montant du versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise du groupe, lui-même plafonné à 2 % du PASS par an.
Le décret n° 2024-644 a modifié le plafond annuel de ce versement unilatéral et l’a aligné sur le plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur (PPV).
Depuis le 1er juillet 2024, il est donc à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile et peut être porté à 6 000 euros par bénéficiaire et par an pour :
- les employeurs mettant en œuvre, à la date du versement unilatéral, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement, un dispositif d’intéressement lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mettre en place la participation, ou un dispositif d’intéressement ou de participation, lorsqu’ils ne sont pas soumis à cette obligation ;
- les associations et les fondations d’utilité publique ou d’intérêt général et les ESAT bénéficiant du relèvement du plafond de la PPV.
Le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 modifie, lui, l’article R.3332-8 du code du travail pour ajouter que, dans le cas où l’employeur procède à un tel versement unilatéral, le plafond total annuel d’abondement au PEE est relevé à 16 % du PASS. En l’absence de versement unilatéral, le plafond global reste fixé à 8 % du PASS.
► Le décret n° 2024-690 procède également au toilettage de certaines dispositions relatives à l’épargne salariale, sans changement sur le fond.


Tolérance zéro pour les propos racistes ou homophobes en entreprise
Dans le contexte politique actuel, propice à une forme de «libération de la parole», les signalements de propos racistes ou homophobes s’accumulent. Dans l’entreprise, lorsqu’ils sont le fait de salariés, ces propos ne peuvent pas être tolérés par l’employeur. Une réaction immédiate s’impose.
Le salarié qui tient des propos racistes ou homophobes dans l’entreprise n’exprime pas une opinion : il commet une infraction réprimée par les articles R 625-7 et suivants du Code pénal. En conséquence, le salarié qui exprime, dans l’entreprise, une opinion raciste ou homophobe ne peut pas prétendre exercer sa liberté fondamentale d’expression (CA Versailles 11-2-2003 n° 02-293).
Le salarié se rend également coupable de discrimination à l’égard de sa victime, protégée par l’article L 1132-1 du Code du travail. Celle-ci peut donc rechercher la responsabilité de l’employeur sur ce fondement.
Exemple —————————————————————————————————————
La Cour de cassation a récemment jugé que les propos à caractère raciste, tenant à la couleur de peau de la salariée qui en a été victime, tenus par sa supérieure hiérarchique, constituent des éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses origines. Le fait que ces propos aient été tenus en dehors des horaires de travail, au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, était indifférent car ils relevaient de la vie professionnelle de la salariée (Cassation 15-5-2024 n° 22-16.287).
——————————————————————————————————————————
L’atteinte à la dignité de la victime
Sont proscrites les injures à caractère raciste ou homophobe visant un salarié de l’entreprise. Mais, plus généralement, tous les comportements à caractère sexiste ou xénophobe sont prohibés : refus de l’autorité d’un supérieur hiérarchique en raison de son origine ou de son orientation sexuelle, fait de véhiculer des stéréotypes, plaisanteries douteuses, etc.
Ces propos et attitudes sont en effet attentatoires à la dignité du salarié qui en est victime. Or la Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que l’employeur évite tout comportement humiliant ou vexatoire à l’égard de ses salariés. Il doit en effet faire en sorte qu’ils aient une attitude respectueuse entre eux (voir notamment en ce sens Cassation 7-2-2012 n° 10-18.686).
A noter : Des injures racistes ou homophobes sont également punissables si elles sont proférées par un salarié à l’encontre d’un prestataire intervenant dans l’entreprise ou d’un client. Elles peuvent en effet ternir l’image de l’entreprise, ce qui justifie une réaction de l’employeur. Tel est le cas, par exemple, d’un salarié qui utilise la messagerie électronique de l’entreprise, faisant apparaître le nom de la société, pour tenir des propos antisémites à un client (Cassation 2-6-2004 n° 03-45.269).
La mise en jeu de l’obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité (article L 4121-1 du Code du travail). Les juges considèrent qu’il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales exercées par l’un de ses collègues. En cas de risque avéré ou d’incident, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il a pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il lui appartient de prouver (en ce sens, Cassation 25-11-2015 n° 14-24.444 ; Cassation 3-2-2021 n° 19-23.548).
L’employeur qui laisse un salarié proférer de telles injures ou adopter un tel comportement, sans prendre les mesures de prévention adéquates, manque donc à son obligation de sécurité et peut être condamné à indemniser la victime.
Exemple —————————————————————————————————————
Un employeur a été récemment condamné à verser 10 000 € de dommages-intérêts à un salarié victime de propos racistes et méprisants au sein de son équipe (CA Lyon 13-6-2024 n° 21/07945).
——————————————————————————————————————————
Si la victime prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’injures racistes, celle-ci produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité est jugé suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cassation 23-5-2013 n° 11-12.029). Même solution en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail motivée par l’inertie de l’employeur face aux propos homophobes dont était victime le salarié (CA Paris 2-7-2013 n° 11/05571).
L’employeur se doit de réagir immédiatement si un salarié se dit victime d’injures racistes ou homophobes ou fait état d’un environnement de travail hostile. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce salarié des conditions de travail compatibles avec sa dignité. À défaut, son inertie peut lui être reprochée et justifier l’attribution de dommages-intérêts à la victime, voire la rupture du contrat de travail à ses torts.
Si l’employeur, alerté sur la situation, ne réagit pas rapidement et que les remarques ou attaques racistes ou homophobes se répètent, elles peuvent dégénérer en harcèlement moral et engager sa responsabilité (CA Versailles 10-11-2011 n° 11/00027 ; CA Paris 2-7-2013 n° 11/05571 ; CA Aix-en-Provence 12-5-2017 n° 15/06139).
A noter : Même si les injures racistes ou homophobes portent atteinte à sa dignité, le salarié ne doit pas se faire justice lui-même. Une réaction violente à de tels propos constitue une faute susceptible d’être sanctionnée (Cassation 7-7-2009 n° 08-41.238).
Que peut faire l’employeur pour lutter contre le racisme ou l’homophobie dans son entreprise ? En premier lieu, il a tout intérêt à mener régulièrement des campagnes de prévention et/ou de formation auprès des managers et de l’ensemble des salariés, notamment en leur rappelant les règles de savoir-vivre en entreprise et les risques encourus en cas de comportement raciste ou homophobe.
En cas de signalement d’un incident, l’employeur doit entendre la victime et les personnes qu’elle accuse, afin d’établir les faits. Il peut également charger les représentants du personnel d’une enquête, afin d’obtenir un avis impartial sur la situation.
Exemple —————————————————————————————————————
Un salarié ayant dénoncé le comportement homophobe de ses collègues a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L’employeur a en effet prouvé qu’il avait envoyé au personnel une lettre circulaire rappelant les incidences disciplinaires, voire pénales, susceptibles de résulter de tels comportements, puis convoqué les parties en associant l’inspecteur du travail à sa démarche. Les juges ont considéré qu’il avait rempli son obligation de prévention (CA Montpellier 15-5-2013 n° 11-06233).
——————————————————————————————————————————
Ensuite, si les faits sont avérés, l’employeur doit prendre des mesures pour les faire cesser immédiatement. Si les faits ont eu lieu dans le cadre professionnel, il est en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié coupable.
A noter : La Cour de cassation a toutefois récemment jugé que l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire et sanctionner un salarié qui tient des propos racistes dans des courriels adressés à des collègues, via la messagerie professionnelle, dès lors qu’il s’agit de messages privés couverts par le secret des correspondances. Les juges ont considéré, dans cette affaire, que le salarié s’était exprimé dans le cadre de sa vie personnelle et que les faits ne pouvaient pas constituer un manquement à une obligation contractuelle (Cassation 6-3-2024 n° 22-11.016). Cette décision a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de la teneur des propos échangés par le salarié avec ses collègues.
Si le comportement du salarié est rattachable à sa vie professionnelle, l’employeur peut toutefois se placer sur le terrain disciplinaire. Par exemple, il a été jugé que l’employeur avait pu licencier pour faute un salarié ayant tenu des propos racistes après la journée de travail mais dans les locaux de l’entreprise (Cassation 16-10-2013 n° 12-19.670).
Le comportement raciste ou homophobe d’un salarié dans le cadre de sa vie privée peut toutefois avoir des conséquences au travail. En effet, si ce comportement crée un trouble caractérisé dans l’entreprise – par exemple si ses collègues s’en plaignent et refusent de travailler avec lui – l’employeur peut prononcer un licenciement non disciplinaire motivé par le trouble au bon fonctionnement de l’entreprise provoqué par cette attitude (en ce sens, Cassation 30-11-2005 n° 04-13.877 et n° 04-41.206 ; Cassation 16-9-2009 n° 08-41.837).
La Cour de cassation juge de manière constante que la tenue de propos racistes par un salarié est nécessairement fautive (Cassation 2-6-2004 n° 02-44.904). Cette faute est généralement jugée suffisamment grave pour justifier le licenciement immédiat, sans indemnités (Cassation 5-12-2018 n° 17-14.594 ; Cassation 8-11-2023 n° 22-19.049). Le Conseil d’état considère également que cette faute justifie une autorisation de licenciement d’un salarié protégé (CE 7-10-2022 n° 450492). La cour d’appel de Montpellier a récemment jugé qu’une telle faute justifie la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CA Montpellier 2-5-2024 no°21/01805). Les juges ne retiennent que peu souvent des circonstances atténuantes susceptibles de minorer le degré de gravité de cette faute. Par exemple, le salarié qui invoque la plaisanterie ou la simple grossièreté obtient rarement gain de cause auprès des tribunaux.


Le salarié peut refuser d’être réintégré à temps partiel comme préconisé par le médecin du travail
Le salarié déclaré apte à reprendre son poste de travail par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1226-8 du Code du travail). Cette obligation de réintégration s’impose à l’employeur comme au salarié, qui doivent tenir compte des réserves ou recommandations éventuelles du médecin du travail (Cassation 28-1-2010 n° 08-42.616), formulées lors de la dernière visite en date (Cassation 9-7-2014 n° 13-18.696 ; Cassation 13-4-2016 n° 15-10.400). La situation peut toutefois s’avérer compliquée lorsque, suivant les préconisations du médecin du travail, l’employeur est amené à faire une proposition de poste au salarié induisant une modification de son contrat de travail, comme en témoigne un arrêt du 19 juin 2024 (Cassation n° 22-23.143).
A noter : On rappellera, en effet, que l’article L 4624-6 du Code du travail impose à l’employeur de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. S’il ne le fait pas, il manque à son obligation de sécurité et peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié (Cassation 27-9-2017 n° 15-28.605).
En l’espèce, à l’issue de ses arrêts de travail pour accident du travail, une vendeuse est déclarée apte à temps partiel et port de charges limité par le médecin du travail. Tenant compte de ces préconisations, son employeur lui propose le 16 janvier 2020 un poste à temps partiel qu’elle refuse. Elle ne reprend pas son poste de travail et signe avec lui une convention de rupture qui prend effet en juillet 2020. Quelques mois plus tard, elle saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter, notamment, un rappel de salaire pour la période allant de janvier à juillet 2020, durant laquelle elle n’a pas été rémunérée.
La cour d’appel fait partiellement droit à sa demande en lui accordant un rappel de salaire pour la seule période allant du 9 au 16 janvier 2020. Elle retient que, s’il n’est pas contesté que la salariée n’a pas travaillé sur la période dont elle réclame rémunération, à partir du moment où l’employeur lui a proposé le 16 janvier 2020 un avenant au contrat de travail conforme aux préconisations médicales, et tenant compte de ses observations sur la rémunération, son refus n’apparaît plus justifié. Pour les juges du fond, sa liberté de ne pas contracter ne peut pas lui ouvrir droit au paiement du salaire à compter du 16 janvier, dès lors qu’elle n’a pas fourni de travail effectif et ne s’est pas tenue à la disposition de l’employeur qui proposait un aménagement conforme aux préconisations médicales.
La salariée se pourvoit en cassation, faisant valoir que le passage à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée. Dès lors, confronté à son refus, l’employeur, qui ne souhaitait pas engager la procédure de licenciement, aurait dû poursuivre l’exécution du contrat aux mêmes conditions qu’auparavant, en maintenant sa rémunération.
Les questions posées à la Cour de cassation étaient donc celles de savoir si la salariée était en droit de refuser une proposition de poste induisant une modification de son contrat de travail mais conforme aux préconisations du médecin du travail et si, en cas de refus d’une telle proposition, elle avait droit au maintien de sa rémunération.
La Cour de cassation répond positivement à ces deux questions et censure la décision des juges du fond. Elle pose comme principe que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat.
En effet, l’employeur ne peut pas unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord.
Dès lors, la salariée pouvait en l’espèce refuser la proposition de passage à temps partiel de son employeur, même si elle était conforme aux préconisations du médecin du travail, puisqu’elle constituait une modification de son contrat de travail, et prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture de son contrat de travail, y compris pour la période postérieure à cette proposition.
A notre avis : La Cour de cassation confirme ici, dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles, qu’en aucun cas l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail – en l’espèce, un passage à temps partiel induisant une baisse de sa rémunération – même si l’objectif est de se conformer aux préconisations du médecin du travail (Cassation 29-5-2013 n° 12-14.754 ; Cassation 24-5-2023 n° 21-23.941).
En revanche, c’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle affirme l’obligation pour lui de maintenir la rémunération d’un salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière de modification du contrat de travail selon laquelle, lorsqu’un salarié refuse une telle modification, l’employeur doit soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement. Il en résulte que, jusqu’au licenciement, le salarié a droit au maintien de son salaire (Cassation 26-11-2002 n° 00-44.517 ; Cassation 24-3-2010 n° 08-43.174).
Cette solution, qui peut sembler sévère pour l’employeur, a le mérite d’éviter une attitude attentiste de sa part, alors que le salarié ne peut plus percevoir d’indemnités journalières de la sécurité sociale ni, en principe, de salaire en l’absence de prestation de travail.
En cas de refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail, il reste à l’employeur la possibilité de se rapprocher du médecin du travail en vue d’aboutir à une solution permettant le maintien du salarié dans l’emploi. Si, malgré toutes ses démarches et sa bonne foi, aucune solution ne peut être trouvée, il est dans son intérêt que le contrat de travail soit rompu au plus vite en signant, le cas échéant, comme en l’espèce, une rupture conventionnelle avec le salarié, pour arrêter le paiement des salaires. Un licenciement peut aussi être envisagé en dernier recours mais cette voie peut s’avérer périlleuse en cas de litige.

Absence pour maladie et caisse de congés payés : des changements dans l’assiette des cotisations
Un décret du 28 juin 2024 ouvre la possibilité aux caisses de congés payés du BTP, du personnel artistique et technique employé de façon intermittente et à celle des travailleurs intermittents des transports d’intégrer dans leur règlement intérieur la prise en compte des salaires que les salariés auraient normalement perçu s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absence pour maladie dans l’assiette des cotisations versées par les employeurs affiliés à ces caisses.
► Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 30 juin 2024.

Partage de la valeur : de nouvelles précisions à connaître
Un premier décret publié au Journal officiel du 30 juin 2024 vient compléter la transposition de l’accord national interprofessionnel (Ani) sur le partage de la valeur conclu entre les partenaires sociaux le 10 février 2023. Il rend applicables plusieurs mesures de la loi du 29 novembre 2023 adoptée suite à cet Ani et il transpose certains articles de l’accord dont le contenu relevait du pouvoir réglementaire.
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024.
L’article 9 de la loi du 29 novembre 2023 permet aux bénéficiaires d’affecter en tout ou partie leur prime de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale ou retraite (PEE, PEI, Perco, PEREC, PERO), les sommes ainsi placées étant exonérées d’impôt sur le revenu.
Mais la mise en œuvre de cette faculté était suspendue à l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires relatives à l’information des bénéficiaires et aux délais de demande. C’est chose faite avec le décret du 29 juin 2024.
Depuis le 1er juillet 2024, si l’entreprise dispose d’un tel plan (PEE, PEI, Perco, PERECO, PERO), chaque somme versée au titre de la PPV doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
- le montant de la PPV attribuée à l’intéressé ;
- s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS : la PPV est en effet exonérée dans certains cas de ces contributions ;
- la possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation du ou des plans dont dispose l’entreprise ;
- le délai de demande d’affectation, qui est de 15 jours maximum à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, de cette fiche ;
- si la PPV est investie sur un plan, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles ainsi que les cas de déblocage anticipé.
Sauf opposition du salarié concerné, la fiche peut lui être remise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Depuis le 1er décembre 2023, la loi encadre le système d’avances sur intéressement et sur la participation ; celui-ci est donc sécurisé.
Les salariés peuvent bénéficier d’avances sur intéressement ou sur participation si l’accord d’intéressement ou de participation le prévoit (article L.3348-1, créé par la loi du 29 novembre 2023). Outre le fait d’être prévues par l’accord, les avances nécessitent l’autorisation expresse du bénéficiaire. Leur périodicité ne peut être inférieure au trimestre.
Les salariés doivent être informés de l’existence d’un dispositif d’avances sur participation ou d’intéressement, dans des conditions qui restaient à fixer par décret. C’est chose faite.
Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise contre récépissé l’informant de cette possibilité.
À défaut d’accord express du salarié sur le principe du versement d’une avance au titre de la participation ou de l’intéressement, aucune avance ne lui est versée (décret article 4, IV ; article D.3348-1 nouveau du code du travail).
► Le second décret, dont la publication devrait être imminente, prévoit de compléter le contenu obligatoire des accords d’intéressement et de participation quant à l’information à délivrer aux salariés, prévu par les articles R.3313-2 et R.3324-21-1 du code du travail. L’accord devrait ainsi indiquer, en cas de versement d’avances, les modalités de recueil de l’accord du salarié et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.
- le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance ;
- la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
- l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque ses droits définitifs sont inférieurs à la somme des avances reçues (situation de trop-perçu) ;
- l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou retraite : il constitue donc un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales ;
- lorsque l’avance est investie sur un plan d’épargne salariale ou retraite, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront indisponibles et les cas de déblocage anticipé ;
- les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’avance sur intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail ;
- l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Le plafond annuel des versements de l’employeur complétant la contribution du salarié à un PEE est fixé à 8 % du PASS. Il prend en compte, le cas échéant, le montant du versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise du groupe, lui-même plafonné à 2 % du PASS par an.
Le décret modifie plafond annuel de ce versement unilatéral et l’aligne sur le plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur (PPV).
Il est donc désormais fixé à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile et peut être porté à 6 000 euros par bénéficiaire et par an pour :
- les employeurs mettant en œuvre, à la date du versement unilatéral, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement, un dispositif d’intéressement lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mettre en place la participation, ou un dispositif d’intéressement ou de participation, lorsqu’ils ne sont pas soumis à cette obligation (article D.3332-8-1 modifié du code du travail) ;
- les associations et les fondations d’utilité publique ou d’intérêt général et les ESAT bénéficiant du relèvement du plafond de la PPV.
► Le second décret, dont la publication est probablement imminente, prévoit de modifier l’article R.3332-8 du code du travail pour ajouter que, dans le cas où l’employeur procède à un tel versement unilatéral, le plafond total annuel d’abondement au PEE est relevé à 16 % du PASS. En l’absence de versement unilatéral, le plafond global reste fixé à 8 % du PASS.
Depuis la loi du 9 mars 2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de présence pour le calcul de la prime de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord de participation (article L.3324-6 du code du travail).
L’adaptation de l’article D.3324-11 du code du travail, qui indique le salaire à prendre en compte en cas d’absence du salarié assimilée à une période de présence, n’avait pas été faite. C’est désormais le cas.
Le salaire à prendre en compte pour la période de congé de paternité est donc celui qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (décret article 4, II-3° ; article D.3324-11 modifié du code du travail).
Au 1er juillet 2024, le règlement d’un PEE, d’un PEI, d’un PERECO et d’un PERO doit proposer l’acquisition de parts d’au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable (article L.3332-17 du code du travail ; article L.224-3 du code monétaire et financier).
► Les Perco ne sont pas concernés par cette obligation.
La mise en œuvre de cette obligation était conditionnée à la publication d’un décret devant préciser la liste des labels ainsi que, pour les labels délivrés par l’Etat, leurs critères et modalités de délivrance.
L’article 3 du décret n° 2024-644, applicable à compter du 1er juillet 2024, donne la liste de ces labels :
- le label « investissement socialement responsable », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés dans le décret du 8 janvier 2016 ;
- le label « France finance verte », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D.128-1 et suivants du code de l’environnement ;
- le label « Relance », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par la charte issue de l’accord de place du 19 octobre 2020 ;
- le label « Finansol » dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par le règlement élaboré par l’association FAIR ;
- le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale » issu de l’accord du 29 janvier 2002, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par un cahier des charges.
Le décret procède également à un toilettage de diverses dispositions de l’épargne salariale (abrogation d’articles obsolètes, adaptation d’articles à des modifications législatives, corrections de coquilles), sans changement sur le fond.

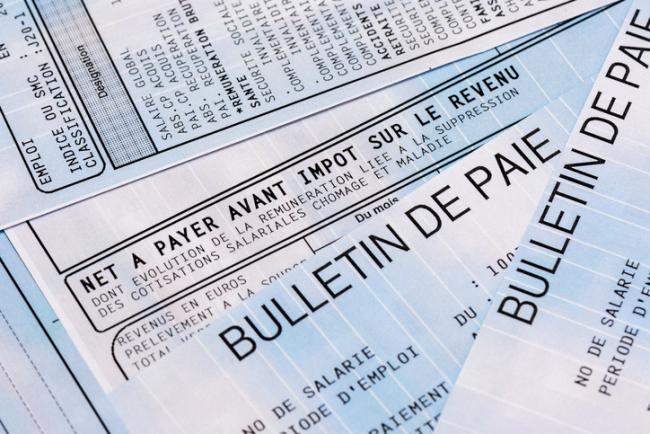
Le modèle provisoire de bulletin de paie s’appliquera jusqu’au 1er janvier 2026
Depuis le 1er juillet 2023, le montant net social (MNS) est une mention obligatoire des bulletins de paie. L’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de salaire a été modifié en conséquence par un arrêté du 31 janvier 2023, d’une part, pour intégrer ce nouvel agrégat et, d’autre part, pour procéder à plusieurs adaptations visant à davantage de simplification et de clarification dans la présentation des différentes rubriques du bulletin.
► Parmi les adaptations prévues : la création des rubriques « Cotisations et contributions sociales facultatives » et « Remboursement et déductions diverses » ; la réécriture de la rubrique « Exonération et allégements de cotisations » ou encore la suppression de certaines informations superflues.
Pour mémoire, l’arrêté du 31 janvier 2023 prévoyait une mise en œuvre en deux temps :
- un modèle temporaire, applicable par dérogation du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, sur lequel était uniquement ajoutée la mention du MNS au modèle existant, sans autre modification (sauf éventuellement la suppression de certaines mentions superflues) ;
- un modèle pérenne, harmonisé pour l’ensemble des salariés et intégrant l’ensemble des modifications (MNS et autres adaptations), obligatoire à compter du 1er janvier 2025, dont l’utilisation a déjà été anticipée par de nombreuses entreprises.
L’arrêté du 25 juin 2024 modifie l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2023 afin de prolonger d’une année l’application du modèle temporaire de bulletin de paie, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Le modèle pérenne officiel de bulletin de paie figurant à l’article 1er de l’arrêté de 2016 serait donc applicable à compter du 1er janvier 2026.
Une modification du modèle pérenne était attendue depuis le 1er janvier 2024 pour intégrer les nouvelles modalités de calcul du MNS prévues par le décret du 28 décembre 2023. On pouvait notamment s’attendre à la suppression de la différenciation cotisations et contributions sociales obligatoires/cotisations et contributions sociales facultatives, devenue sans intérêt. L’arrêté du 25 juin 2024 ne modifie pas ce modèle. Il se contente d’en reporter l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Un laps de temps nécessaire sans doute pour réfléchir, avec toutes les parties prenantes, à l’ultra simplification du bulletin de paie souhaitée par le gouvernement et dont l’ébauche figure dans le projet de loi de simplification de la vie économique présenté en conseil de ministres le 24 avril 2024. L’utilisation effective de ce nouveau bulletin de paie, qui est loin de faire l’unanimité, n’était pas prévue avant 2027.
Depuis le 1er janvier 2024, la définition du montant net social est codifiée au sein du code de l’action sociale et des familles (article R.262-12, II) et du code de sécurité sociale (article R.844-1, II) au titre des ressources prises en compte pour le calcul respectivement des droits au RSA et à la prime d’activité. En outre, depuis cette date, le MNS est ajouté à la liste réglementaire des mentions obligatoires du bulletin de paie. Aux termes de l’article R. 3243-1, 9° bis du code du travail, le bulletin doit en effet comporter le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R.844-1 du code de sécurité sociale.
L’arrêté du 24 juin 2024 modifie le II de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2016 pour substituer à la définition du MNS y figurant jusqu’ici le renvoi aux dispositions du code du travail. Il est ainsi désormais prévu que la valeur associée à la mention « Montant net social » correspond au montant visé au 9° bis de l’article R 3243-1 du code du travail.
En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur, l’arrêté est applicable depuis le 30 juin 2024.
|
Bulletin de paie : le BOSS met à jour la rubrique « Montant net social » |
|---|
|
Parallèlement, dans une mise à jour du 1er juillet 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) apporte quelques précisions à la rubrique « Montant net social » du bulletin de paie. Eléments pris en compte Un complément est tout d’abord apporté au tableau des éléments pris en compte dans le MNS. Il est ainsi précisé que l’indemnité de dédit formation ainsi que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce) versée par France travail doivent être prises en compte dans le calcul du MNS (Boss-MNS-II-A-1 modifié). Montant net social négatif L’administration ajoute un exemple sur l’affichage d’un MNS négatif sur le bulletin de paie. Pour mémoire, si les calculs aboutissent à un MNS négatif, celui-ci doit être affiché sur le bulletin de paie même si le net à payer est affiché à zéro. De même, en cas de trop versé, le MNS doit être indiqué avec une valeur négative, à condition que l’employeur demande le remboursement au salarié. ► Exemple : un salarié est absent tout le mois et n’est pas rémunéré pendant cette période. Il continue de verser sa cotisation due pour le financement des garanties de frais de santé (mutuelle). Dans ce cas, le salaire net à payer indiqué sur son bulletin de paie sera de zéro, mais le montant net social sera négatif puisque sa cotisation doit être déduite (Boss-MNS-37 modifié). Médailles d’honneur du travail Enfin, une coquille est corrigée sur les primes versées à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail. La prime versée par le comité social et économique (CSE) ou par l’employeur à l’occasion de (ou concomitamment à) l’attribution d’une médaille d’honneur du travail ou d’une médaille s’y substituant ne doit pas être intégrée dans le montant net social, dans la mesure où elle constitue un avantage en espèces qui est exempté socialement (Boss-MNS-24 modifié). La précédente rédaction laissait supposer que la prime n’était versée par l’employeur qu’en l’absence de CSE. |