ACTUALITÉ
SOCIAL
Métiers en tension : le formulaire est disponible
La loi du 26 janvier 2024 a mis en place un nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension jusqu’au 31 décembre 2026. Une circulaire du 5 février 2024 est venue détailler les modalités d’instruction des demandes. Le formulaire de demande d’autorisation de travail au titre des métiers en tension est désormais disponible sur le site service-public.fr. Il est accompagné d’une notice en ligne.
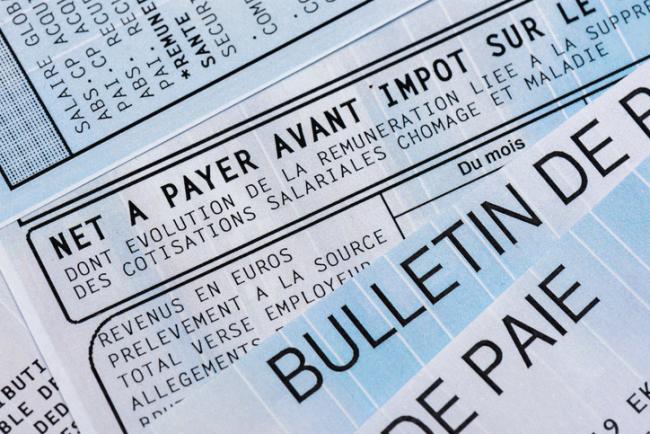
La délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à justifier le paiement effectif du salaire
Obligation essentielle du contrat de travail à la charge de l’employeur, le paiement du salaire représente la contrepartie du travail fourni par le salarié. Une décision du 7 mai 2024 nous rappelle que si le versement du salaire doit obligatoirement s’accompagner d’une remise d’un bulletin de paie, cette formalité ne justifie pas son paiement effectif.
Dans cette affaire, une négociatrice vente et location saisit la juridiction prud’homale à la suite de son licenciement. Elle demandait notamment le paiement d’une somme au titre de commissions pour ventes qu’elle n’avait pas perçues. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil). A ce titre, l’employeur justifiait le paiement de cette somme par le fait qu’elle avait été mentionnée dans le bulletin de paie et la feuille de commissionnement. Un argument suffisant pour la cour d’appel, qui admet que cette mention suffit à prouver le paiement et rejette par conséquent la demande de la salariée.
La Cour de cassation n’est pas du même avis et casse la décision. Après avoir cité le principe prévu à l’article 1353 du code civil, elle rappelle que « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation à tout ou partie du salaire et aux indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus ». Selon elle, le paiement du salaire se prouve uniquement par la production de pièces comptables, peu important l’acceptation sans réserve du bulletin de paie ou d’une feuille de commissionnement par le salarié.
► La jurisprudence rappelle régulièrement que le bulletin de paie ne constitue qu’un commencement de preuve, et que si l’employeur veut établir qu’il s’est bien acquitté du paiement du salaire, il doit notamment produire des pièces comptables (arrêt du 29 mars 2023). Les relevés bancaires de l’entreprise sont ainsi admis pour prouver le paiement (arrêt du 19 novembre 2008). En revanche, la remise de l’attestation Pôle emploi (arrêt du 21 septembre 2016), la remise d’un chèque à l’ordre du salarié ou encore la photocopie de ce chèque (arrêt du 19 avril 2023) ne suffisent pas à justifier le paiement du salaire.
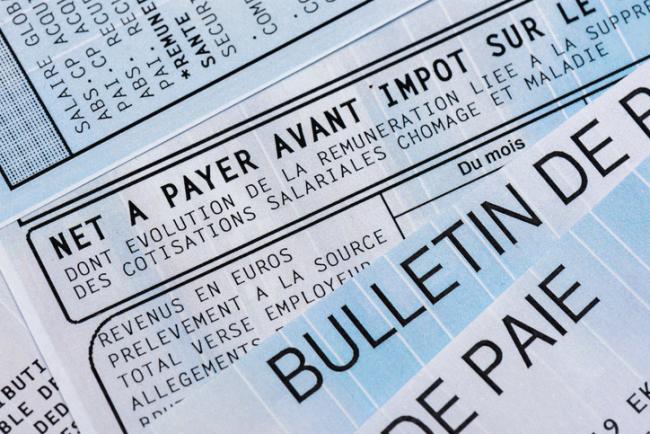

Affiliation, indemnisation, seniors : Gabriel Attal dévoile les futures règles de l’assurance chômage
« Si nous ne réformons pas l’assurance chômage aujourd’hui, nous risquons de caler sur la route du plein emploi », a indiqué Gabriel Attal avant-hier dans une interview accordée à La Tribune. Le Premier ministre prétend également que « ce n’est pas une réforme d’économie (…), preuve en est : la précédente réforme en 2019, nous l’avions faite quand le déficit était à 3 % ». L’allusion aux finances publiques tombe à pic puisque l’agence de notation Standard & Poor’s doit rendre son verdict sur la solvabilité de la dette française cette semaine, le 31 mai.
Comme cela avait été annoncé aux partenaires sociaux par la ministre du travail Catherine Vautrin la semaine dernière, le gouvernement va durcir la condition d’affiliation, ajouter un nouveau seuil de contracyclicité, augmenter de deux ans les bornes de la filière seniors. Le bonus-malus de cotisations chômage des employeurs qui embauchent en contrats courts serait étendu à de nouveaux secteurs à l’issue d’une concertation avec les partenaires sociaux.
Nouveau coup de rabot sur la condition d’affiliation. Après la réforme de 2019, qui avait introduit une condition de 6 mois d’emploi sur 24 mois au lieu de 4 mois sur 28 mois, les demandeurs d’emploi devront après la réforme avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour prétendre à une indemnisation.
On le voit, peu à peu, il faut avoir travaillé un nombre de mois plus important sur une période de plus en plus courte. De ce fait, la condition d’affiliation devient plus difficile à remplir. Des critères qui pénalisent particulièrement les jeunes qui peinent à accéder au marché du travail. Autres perdants : les personnes en CDD et les intérimaires.
La période de référence d’affiliation (20 mois au lieu de 24 mois) entraîne également une baisse de la durée d’indemnisation, c’est-à-dire la période pendant laquelle le demandeur d’emploi percevra son allocation chômage. Gabriel Attal « assume » qu’elle soit réduite de 18 à 15 mois et tente l’argument selon lequel « dans le même temps, nous renforçons massivement l’accompagnement avec France Travail ». Une démarche qui, au fil des réformes de l’ANPE puis de Pôle Emploi, a souvent rimé avec plus de contrôle des personnes au chômage.
► Matignon a indiqué que les règles du différé d’indemnisation ne seraient pas modifiées.
L’accès à l’emploi des seniors constitue l’un des points noirs du chômage français depuis la réforme des retraites. Comment travailler deux ans de plus alors que les politiques des entreprises consistent à favoriser leur départ anticipé ? Comme l’a montré le cabinet d’expertise Syndex, très peu d’accords se penchent sur le maintien et le développement des compétences et l’employabilité des seniors. Ils sont au contraire orientés sur les dispositifs de transition et d’accompagnement vers la retraite. En 2022, selon la Dares, seulement 56,9 % des seniors de 55 à 64 ans étaient en emploi.
Les partenaires sociaux n’ayant pas trouvé d’accord sur le sujet, notamment en raison d’une lettre de cadrage très contraignante, Gabriel Attal annonce trois mesures.
Une modification des bornes d’âge de la filière seniors
Jusqu’à présent, le régime plus favorable des seniors s’articulait autour de deux bornes d’âge : 53 et 55 ans. Une fois la réforme en vigueur, l’assurance chômage des seniors sera régie par un seul pivot : 57 ans. Ainsi, le premier pallier de 53 ans disparaît, le second pallier de 55 ans est reporté de deux ans à 57 ans, en cohérence avec la réforme des retraites qui a repoussé de deux ans l’âge légal de départ de 62 à 64 ans. Il existera donc un droit commun avant 57 ans et un régime spécifique après 57 ans.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- La période de référence d’affiliation passe à 30 mois au lieu de 36 mois à compter de 57 ans ;
- La durée maximale d’indemnisation sera de 15 mois pour les moins de 57 ans et de 22,5 mois pour les plus de 57 ans (après application du coefficient multiplicateur de 0,75) ;
- Les seniors seront exemptés de dégressivité de leur allocation à compter de 57 ans comme aujourd’hui ;
- La condition d’affiliation sera de 8 mois sur 20 mois avant 57 ans, et 8 mois sur 30 mois après 57 ans.
Matignon n’est cependant pas en mesure de déterminer ce qu’il adviendra de l’allongement de la durée d’indemnisation des plus de 53 ans en formation, « un dispositif très isolé sur lequel on vous reviendra », a-t-on dit à la presse avant-hier
« Bonus emploi seniors »
Un dispositif de « bonus emploi seniors » complétera l’indemnisation d’un senior au chômage s’il accepte un poste moins bien rémunéré que celui qu’il occupait avant de perdre son emploi, et ce pendant un an. Selon Matignon, il s’agit de s’inspirer du dispositif d’activité réduite permettant déjà de cumuler jusqu’à 30 % de l’allocation avec le revenu d’une activité professionnelle. Le » bonus emploi seniors » permettra de mobiliser jusqu’à 60 % de l’indemnisation chômage.
► Matignon a indiqué que ce bonus serait applicable indépendamment du motif de licenciement et de l’entrée dans un dispositif tel que le CSP.
CDI et index
Un CDI seniors (dans les mêmes termes que celui qui a été recalé par le Conseil constitutionnel au moment de la réforme des retraites pour cause de cavalier législatif) sera instauré. De même, l’index seniors devrait refaire surface sur le même modèle que l’index d’égalité professionnelle hommes-femmes et serait adopté dans le cadre de la future « loi travail 2 » à l’automne prochain.
Gabriel Attal confie à Catherine Vautrin le soin de mener des concertations après l’été sur le CDI seniors et une extension du bonus-malus de cotisations chômage des employeurs à de nouveaux secteurs de l’économie. Ce dernier dispositif est aujourd’hui limité à sept secteurs.
Pour l’instant, les mesures sur les contrats saisonniers restent à l’étude, notamment selon Matignon « le relèvement de 6 à 8 mois de leur condition d’affiliation ».
Le gouvernement a essuyé les critiques sur l’application de la contracyclicité dans le seul sens qui pénalise les chômeurs. Le dispositif adopté sous l’empire d’Elisabeth Borne était censé réduire l’indemnisation en cas d’embellie du marché du travail et l’améliorer en période de morosité. Pour l’instant, la durée d’indemnisation est réduite de 25 % en cas de taux de chômage inférieur à 9 % ou s’il ne progresse pas de plus de 0,8 point sur un trimestre. La réforme Attal introduirait un nouveau seuil : en cas de taux de chômage inférieur à 6,5 %, la durée d’indemnisation serait réduite de 40 %.
Or, selon l’Insee, le taux de chômage s’établit en légère hausse (+ 0,3 point par rapport au 1er trimestre 2023) mais de manière « stable » au 1er trimestre 2024 à 7,5 %. Matignon estime au contraire que la réforme « prépare la reprise économique de 2025, où la croissance reprendra et le chômage diminuera ».
Pour l’heure, les services du Premier ministre ne sont pas en mesure de chiffrer combien de demandeurs d’emploi basculeront au RSA du fait de ces nouveaux paramètres.
Les partenaires sociaux avaient négocié en novembre 2023 un projet d’accord que le gouvernement n’a pas agréé. Il en reprendra cependant les mesures relatives à la mensualisation de l’indemnité et au régime des créateurs d’entreprise. En revanche, le futur décret laisserait de côté les clauses prévoyant une baisse des cotisations patronales.
Le décret à paraître le 1er juillet s’appliquera aux nouveaux demandeurs d’emploi à compter du 1er décembre 2024. Pour mémoire, la Dares a chiffré que la dernière réforme a fait baisser de 17 % le nombre d’ouvertures de droits (lire cet article). Selon l’Unédic, organisme paritaire de gestion de l’assurance chômage, cette réforme 2024 devrait entraîner une baisse de 15 % du nombre de demandeurs d’emploi.

Congés payés et maladie : les précisions du gouvernement
Le site service-public.fr met à disposition un questions-réponses sur les nouvelles règles applicables aux congés payés en cas de maladie du salarié.
Nombre de jours de congés payés acquis en cas de maladie, calcul des droits et de l’indemnité de congés payés, information du salarié, report des congés payés, délai de réclamations, autant de points abordés par le site gouvernemental.
Bonus, le document donne des exemples précis, notamment sur les règles de report que nous reproduisons ici.
|
Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l’année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l’employeur l’informe le 13 mai 2024 de ses droits. Dans l’entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :
Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu’au 13 août 2025) pour les prendre. Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025. |

Mise en cause d’un accord collectif : à quelles conditions un accord de substitution peut-il être rétroactif ?
En principe, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas transmis au nouvel employeur. Le nouvel employeur n’est donc en principe pas tenu par les accords collectifs qui liaient le précédent employeur.
Le législateur a cependant atténué les effets de cette règle en préconisant l’ouverture de négociations soit pour adapter les anciens textes aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour élaborer une nouvelle convention ou de nouveaux accords.
C’est l’article L.2261-14 du code du travail. Ce texte renvoie aux mécanismes prévus en cas de dénonciation d’un accord collectif : obligation de négocier, survie provisoire des textes conventionnels dont bénéficiaient les salariés avant leur transfert et garantie de rémunération.
Ainsi, lorsque l’application d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (trois mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure). A défaut d’un nouvel accord dans ces délais, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 mois.
► La mise en cause de la convention ou de l’accord résulte de la survenance d’une des situations prévues par le texte (fusion, cession, scission, changement d’activité) sans qu’il soit besoin d’une dénonciation.
Dans cette affaire, un salarié est engagé, le 25 mai 1998, par une société en qualité de préparateur de commandes. Son contrat de travail est transféré à compter du 1er avril 2016 dans une autre société. Le statut conventionnel déterminant les grilles de salaires applicables à la première société est alors mis en cause. Un accord de substitution est conclu le 16 décembre avec effet rétroactif à la date du transfert, soit le 1er avril 2016.
La structure de la rémunération du salarié, définie par les dispositions conventionnelles en vigueur dans la première société, est modifiée, mais le montant brut prévu dans son contrat de travail est maintenu par le jeu d’un complément au salaire de base issu de la grille de salaires applicable dans la nouvelle société, complément apparaissant sur une ligne distincte.
Arguant qu’un accord de substitution ne peut avoir un effet rétroactif à la date de mise en cause de la convention antérieure, le salarié saisit la justice aux fins d’obtenir un rappel de salaires pour la période du 1er avril au 16 décembre 2016. A l’appui de sa demande, il allègue aussi la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur.
Les juges du fond rejettent ses demandes. Il se pourvoit en cassation.
Un accord de substitution peut-il avoir un effet rétroactif et entrer en vigueur au jour de la mise en cause de l’accord collectif antérieur ? C’est la question posée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle balaie d’abord l’argument relatif à la modification unilatérale de la rémunération par l’employeur : la structure de la rémunération n’était pas stipulée dans le contrat de travail du salarié mais prévue conventionnellement et le montant de sa rémunération était maintenu par le biais d’un complément de salaire.
Elle rappelle ensuite les termes de l’article L.2261-14 (précité), ainsi que l’article L.2261-1 du code du travail et la jurisprudence qui l’accompagne.
L’article L.2261-1 pose un principe d’application immédiate des accords collectifs le lendemain du jour de leur dépôt auprès de l’administration mais prévoit aussi la possibilité de stipulations contraires dans l’accord.
Selon une jurisprudence constante (arrêt du 11 juillet 2000 ; arrêt du 24 janvier 2007 ; arrêt du 28 novembre 2018 ; arrêt du 13 janvier 2021), un accord collectif ne peut contenir des stipulations à caractère rétroactif que si celles-ci sont favorables au salarié car l’accord collectif ne peut priver un salarié des droits acquis pour la période antérieure à la signature. En outre, un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord.
La Cour de cassation en déduit qu’un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de mise en cause de la convention ou l’accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.
Tel était le cas en l’espèce : si la structure de la rémunération des salariés transférés était modifiée par l’accord de substitution, le montant brut de leur rémunération était maintenu.


Le code du travail est-il adapté à l’essor de l’intelligence artificielle ?
Dans le cadre du séminaire sur les politiques de l’emploi, organisé par les ministères de l’économie et du travail mardi 21 mai 2024, juristes et économistes se sont penchés sur l’impact du développement de l’intelligence artificielle sur l’emploi. Parmi les questions abordées, celle de savoir s’il est nécessaire de modifier le code du travail afin de prendre en compte les nouvelles problématiques soulevées par l’IA. Grégoire Loiseau, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, plaide plutôt pour une adaptation des outils existants.
En matière de protection de l’emploi – afin de prévenir et pallier les suppressions de postes qu’il est pour l’heure difficile de quantifier – il convient « d’adapter les emplois à l’évolution des tâches » et de « permettre l’évolution des travailleurs dans leur emploi via une appropriation des outils numériques », insiste Grégoire Loiseau. Le droit du travail comporte déjà les outils adéquats. Le professeur de droit cite par exemple la modification du contrat de travail pour adapter les tâches et le cas échéant les fonctions, ou bien encore, la GEPP (ex GPEC). Aux employeurs qui attendraient que les salariés mobilisent leurs droit à CPF pour se former à l’IA, Grégoire Loiseau tient à rappeler que « la formation des travailleurs est d’abord une obligation de l’employeur d’adapter les travailleurs à l’évolution de leurs tâches et des postes » et que « la formation professionnelle doit d’abord être internalisée comme une obligation des entreprises et non seulement externalisée [via le CPF] ».
S’agissant de la protection au travail, l’employeur doit appréhender différemment son obligation de sécurité. « Le prisme aujourd’hui c’est la santé mentale », prévient le professeur de droit. Là encore, les outils existent déjà dans le code du travail pour prévenir les risques professionnels. Il convient toutefois de « les actualiser pour ajouter les risques liés à l’économie numérique », indique Grégoire Loiseau, à commencer par le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), « un outil extrêmement précieux pour la santé des travailleurs ». Il y a aussi la négociation obligatoire sur la QVCT – qui existe depuis 2021 – « qui intègre la négociation sur les risques professionnels et dans laquelle on peut y mettre les risques liés à l’IA ».
Les marges de manoeuvre du législateur national sont de toutes façons assez contraintes par le droit européen. « Il existe beaucoup d’instruments européens et le droit national doit se glisser dans les interstices laissés par [ce dernier] », analyse Grégoire Loiseau. C’est notamment le cas du RGPD qui constitue l’un des remparts de la protection des travailleurs face à l’IA. « Le RGPD interdit par exemple des décisions fondées uniquemement sur un algorithme sauf si elles sont nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat. Ne peut-on pas, par la loi ou par un accord collectif, exiger une intervention humaine sur toutes les décisions algorithmiques qui ont un impact sur les salariés ? », s’interroge l’universitaire.
« La directive sur les travailleurs des plateformes en passe d’être adoptée contient aussi un volet sur la protection des données des travailleurs des plateformes, rappelle Grégoire Loiseau. Il y aura une place pour le droit national lorsque la directive sera transposée ».
En droit interne, c’est la Cnil qui pour l’heure joue ce rôle de garde-fou pour les travailleurs confrontés à l’intelligence artificielle. Grégoire Loiseau rappelle ainsi la décision par laquelle la commission a condamné Amazon à une amende de 32 millions d’euros, en décembre dernier, pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif.
Mais si le droit du travail n’a pas besoin de mutations profondes pour s’adapter à l’IA, Grégoire Loiseau insiste sur la nécessité d’isoler la présence de l’IA dans le monde du travail. « Il est utile de pouvoir identifier les problématiques IA dans une logique d’acculturation ».
Ainsi, par exemple, si « on peut déjà consulter les représentants du personnel [sur l’introduction de l’IA dans l’entreprise] », il serait utile de « bien identifier les systèmes liés au développement de l’IA et de prévoir une expertise prise en charge à 100 % par l’employeur. La BDESE mériterait d’avoir des rubriques consacrées aux systèmes d’IA comme elle a été enrichie de données environnementales en 2022. C’et un outil permettant aux élus de s’approprier ces problématiques ».
Ce travail peut permettre « d’avoir une réflexion associant les élus ou les représentants syndicaux », assure le professeur de droit.
Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites et professeur d’économie à la Neoma Business School, s’oppose à la création de nouvelles obligations à la charge de l’entreprise et suggère plutôt « de se tourner d’abord vers la négociation interprofessionnelle, puis de branche et d’entreprise. Les partenaires sociaux doivent être la réponse plutôt que la loi qui alourdirait les obligations des entreprises ». Un point de consensus avec Grégoire Loiseau, « fervent convaincu de l’utilité de la négociation » qui plaide ainsi pour la négociation d’un accord national interprofessionnel (ANI) sur le numérique et l’IA ».
Pour l’heure, « en France, il n’y a pas d’accords collectifs sur ces sujets, ni de branche, ni d’entreprise », déplore pourtant Francesca Salis-Madinier, secrétaire nationale de la CFDT Cadres et membre de la commission gouvernementale de l’intelligence artificielle. La syndicaliste identifie des « freins et des peurs qui peuvent ralentir, voire bloquer, le processus [de négociation] ».
Elle cite notamment l’accord européen de 2020 sur les transitions numériques – avec un chapitre sur l’IA – qui « devrait être décliné dans les différents pays. En 2024, il n’y a toujours pas de déclinaison en France de cet accord ».
Pourtant, elle voit les choses « bouger » au sein des entreprises. « Lorsque la direction introduit un outil, les élus demandent à être informés-consultés et obtiennent une in fine une expertise ».
L’introduction de l’intelligence artificielle dans le monde du travail nécessite aussi une certaine « transparence » de la part des entreprises. « L’appel aux notions « d’exactitude et d’infaillibilité » lorsqu’on parle de l’IA contribue à renforcer le pouvoir de direction de l’employeur » et reste « une boite noire pour les salariés », explique Grégoire Loiseau. « Le droit du travail mérite d’aller plus loin et de consacrer des droits des travailleurs : en version basse, un droit à l’explicabilité, et en version haute, un droit à la contestabilité ».
C’est aussi la position de Francesca Salis-Madinier. « Un DRH qui utiliserait cet outil doit pouvoir être en mesure d’expliquer pourquoi il prend cette décision. Il faut trouver un système qui peut permettre l’explicabilité dès la conception. Or, ni la direction ni les syndicalistes ne sont préparés. Les représentants du personnel doivent être impliqués : pourquoi on utilise cet outil, dans quelle finalité et quels en sont les usages ? Comment on l’expérimente ? ». L’utilisation de l’IA « doit répondre aux besoins de l’activité des travailleurs et non être un placement commercial », met en garde la secrétaire national de la CFDT Cadres.

Inondations dans le Grand Est : l’Urssaf déclenche des aides
Suite aux inondations survenues dans les départements de Moselle et du Bas-Rhin, l’Urssaf active plusieurs aides :
► Les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité temporaire de soumettre leurs déclarations en raison des dommages causés par les inondations ne seront pas pénalisés. Les échéances de cotisations pourront également être reportées, avec les pénalités et majorations de retard faisant l’objet d’une remise d’office ;
► Les travailleurs indépendants touchés par les inondations ont la possibilité de demander le report de leurs échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. De plus, ils peuvent solliciter une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI).

Avertir par téléphone un salarié de son licenciement peut rendre la rupture abusive
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière doit comporter l’énoncé du ou des motifs de rupture du contrat de travail (article L 1232-6 du code du travail). Le licenciement verbal, qui par définition n’est pas motivé, est systématiquement jugé sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, voir notamment Cassation 23-6-1998 n° 96.41.688).
A noter : Malgré son irrégularité, le licenciement verbal rompt le contrat de travail (Cassation 12-3-1992 n° 90-44.174). Mais il ne peut pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture (Cassation 28-5-2008 n° 07-41.735 ; Cassation 12-11-2002 n° 00-45.676). Par un arrêt du 3 avril 2024 (pourvoi n° 23-10.931), la Cour de cassation rappelle le risque encouru par l’employeur qui prévient téléphoniquement un salarié de son licenciement le jour même de l’expédition de sa lettre de licenciement.
En l’espèce, après avoir été contacté téléphoniquement le 7 février 2019 par la directrice des ressources humaines de son entreprise qui l’a informé de son licenciement, un salarié reçoit par la suite une lettre de licenciement pour faute grave postée le même jour. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Pour sa défense, l’employeur fait valoir que la société a prévenu le salarié de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement par courtoisie, afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé le licenciement du salarié sans cause réelle sérieuse. La cour d’appel avait relevé que le salarié rapportait la preuve qu’il avait été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, et que cette conversation avait eu lieu avant l’expédition de la lettre de licenciement. Les déclarations du salarié étaient en effet confortées par le témoignage de deux collègues qui avaient écouté la conversation car le salarié avait enclenché le haut-parleur du téléphone.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, rappellent qu’un appel téléphonique ne peut pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement. Ce principe s’applique même si la lettre de licenciement est adressée au salarié le jour même, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait qu’en déduire que le salarié avait été licencié verbalement et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il importe peu, à cet égard, que l’employeur ait voulu épargner au salarié l’annonce publique de son licenciement.
A noter : La solution aurait certainement été différente si l’employeur avait pu démontrer que la lettre de licenciement avait été postée avant la conversation téléphonique. En effet, la Cour de cassation, qui juge de manière constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement (Cassation 6-5-2009 n° 08-40.395 ; Cassation 28-9-2022 n° 21-15.606), accorde une attention particulière à la chronologie des faits.
Elle a ainsi jugé dans un arrêt de 2022 qu’une cour d’appel ne peut pas décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le salarié a été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement, sans rechercher si ledit courrier n’a pas été expédié avant la conversation téléphonique (Cassation 28-9-2022 n° 21-15.606). Dans l’arrêt du 3 avril 2024, le témoignage des collègues du salarié a été décisif pour permettre aux juges du fond d’établir cette chronologie. Il est donc recommandé à l’employeur qui, par courtoisie, souhaite informer de vive voix son salarié de son licenciement de faire preuve d’une extrême prudence et de veiller à pouvoir rapporter la preuve que la conversation est bien postérieure à la lettre de licenciement.


La Cour des comptes préconise une auto-déclaration pour les arrêts de travail de courte durée
Dans un rapport publié lundi sur « l’organisation territoriale des soins de premier secours », la Cour des comptes préconise de faire évoluer les règles relatives aux arrêts de travail de courte durée. S’appuyant sur l’exemple de la Grande-Bretagne et du Québec, les juges de la rue Cambon suggèrent de recourir à « l’auto-déclaration » par les salariées des arrêts de travail de courte durée.
Ainsi, pour faire face aux tensions en matière d’offre de soins, les certificats d’arrêts de travail de très courte durée ne sont plus justifiés par les médecins dans ces deux pays mais par une simple déclaration du patient. « Un tel système pourrait permettre de libérer des milliers de consultations qui pourraient être redirigées vers un véritable rôle de soin », estime la Cour des comptes.
Toutefois, nuance la Cour, « la suppression des certificats médicaux, pour ces arrêts de travail de très courte durée, suppose que d’autres mécanismes de régulation soient adoptés dans les entreprises ou leurs branches, voire au niveau national, avec par exemple l’établissement d’une durée de carence d’ordre public qui généraliserait une période minimale d’un ou deux jours réputés non indemnisables. Plus généralement, des dispositifs internalisés, au niveau des entreprises ou des branches, seraient appelés à prendre le relais ».

Le consentement à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est harmonisé
Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS).
Pour bénéficier de la DFS, il faut que le salarié :
- exerce une profession qui figure sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 si elle comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 (arrêté du 20 décembre 2002, article 9) ;
- supporte effectivement des frais professionnels lors de son activité professionnelle (voir, par exemple, arrêt du 19 janvier 2017). En l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la DFS n’est pas applicable (Boss-FP-2130).
L’administration a prévu une suppression progressive de la DFS dans certains métiers, la DFS n’étant pas applicable pour les salariés ne supportant pas effectivement des frais professionnels. Les secteurs et les métiers concernés par cette suppression sont la propreté, la construction, le transport routier de marchandises, l’aviation civile, les journalistes, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant ou enregistré et les VRP.
Le paragraphe 2330 du Boss prévoit les modalités selon lesquelles le consentement du salarié à la DFS est recueilli pour les secteurs et métiers concernés par la suppression progressive de la DFS.
Dans sa dernière mise à jour du Boss, l’administration le modifie une nouvelle fois et prévoit désormais pour l’ensemble des secteurs et métiers précités que, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
Pour rappel, le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante.
► A l’origine, l’administration prévoyait que, si le consentement des salariés avait été recueilli avant 2023 (et en 2023 pour les métiers de la propreté), le consentement de ces salariés couvrait la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. Le Conseil d’Etat a ensuite annulé cette précision pour les journalistes. L’administration a pris en compte cette décision et a appliqué pour les journalistes, les métiers des casinos et des cercles de jeux, les métiers du spectacle vivant et enregistré et les VRP les précisions précitées. L’administration avait toutefois conservé les précisions d’origine pour les autres métiers de la propreté, de la construction, du transport routier de marchandises et de l’aviation civile.

