Dans cette affaire, une salariée subit un accroissement de ses tâches, des avertissements injustifiés et une absence de prise de congés en 2016. S’estimant victime d’un harcèlement moral, elle saisit la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes de Paris la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral. La cour d’appel confirme le jugement, estimant que les faits rapportés par la salariée n’ont pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ni d’altérer son état de santé, et ne peuvent donc pas être qualifiés de harcèlement. La salariée ne partage pas cette analyse et se pourvoit en cassation. Elle soutient que la cour d’appel en ne qualifiant pas les faits de harcèlement moral, alors même que l’employeur n’était pas parvenu à en apporter la preuve contraire ni à apporter de justification étrangère à tout harcèlement, a méconnu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
La Cour de cassation doit alors déterminer si le juge, après avoir constaté l’existence de faits présentés par le salarié laissant présumer un harcèlement moral, puis l’absence de justification par l’employeur, peut considérer qu’ils ne caractérisent pas un harcèlement moral au motif qu’ils n’ont pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail ni d’altérer l’état de santé de celui-ci ?
L’article L.1152-1 du code du travail, qui définit la notion de harcèlement moral, dispose qu' »aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait reconnu que la salariée établissait des faits précis qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral. Elle avait également constaté la défaillance de l’employeur à prouver que ceux-ci étaient étrangers à tout harcèlement conformément au régime probatoire prévu par l’article L.1154-1 du code du travail. Elle refusait pourtant de reconnaître que les faits rapportés par la salariée laissaient présumer un harcèlement moral, au motif que ceux-ci n’avaient pas entrainé la dégradation effective de ses conditions de travail ni de son état de santé. Selon les juges du fond, cette dégradation effective constituait donc une condition sine qua non de la qualification de harcèlement moral.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’avertissement du 8 septembre 2015 était injustifié et que l’employeur ne fournissait aucune explication sur l’absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016, ce dont il résultait que l’employeur ne prouvait pas que ces deux agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation sous-entend ainsi que la dégradation effective de l’état de santé ou des conditions de travail n’est pas pas une condition exclusive et nécessaire à la reconnaissance d’un harcèlement moral.
Cette position rejoint celle de la chambre criminelle, qui considère depuis longtemps que la dégradation des conditions de travail ou de la santé n’est pas une condition à la qualification de harcèlement moral, en estimant que « la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral » (arrêt du 6 décembre 2011 ; arrêt du 14 janvier 2014). En droit pénal, il n’est par conséquent pas nécessaire que les actes aient effectivement produit des effets délétères sur le salarié, il suffit qu’ils soient de nature à les produire. Les définitions du harcèlement moral au travail étant les mêmes en droit pénal (article 222-33-2 du code pénal) et en droit du travail (article L.1152-1 du code du travail), il est cohérent que les chambres criminelle et sociale s’alignent quant à leur interprétation.
Cependant, bien que cette dégradation ne soit pas requise au stade de la qualification du harcèlement, comme nous l’enseigne la Cour de cassation, il faut garder à l’esprit qu’elle reste un facteur d’appréciation du préjudice subi par le salarié, et donc du montant des dommages et intérêts qui seront accordés à ce dernier par le juge.
La Cour de cassation, qui rappelle régulièrement les juges du fond à l’ordre sur l’application du régime de preuve du harcèlement moral confirme donc une fois de plus que ceux-ci doivent s’en tenir à une application rigoureuse des deux étapes prévues par l’article L.1154-1 du code du travail.
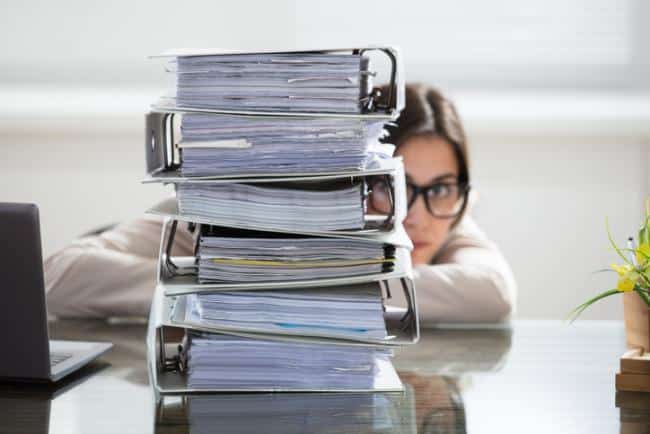

Commentaires récents