ACTUALITÉ
SOCIAL

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : le décret est paru
Pour rappel, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) permet aux employeurs d’intéresser financièrement les salariés à la valorisation financière de leur entreprise, sans passer par un mécanisme d’actionnariat salarié. La prime octroyée aux salariés grâce à cet outil est attribuée si la valeur de l’entreprise augmente sur trois ans. Cette prime bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur.
Concrètement, un montant de référence qui peut être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail est fixé par l’accord. A ce montant, on applique, pour calculer le montant de la prime due, un taux de variation de la valeur de l’entreprise lorsque ce taux est positif. Lorsque le taux de variation est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation. La valeur de l’entreprise est obtenue différemment selon que l’entreprise est ou non cotée en bourse.
Tous les salariés de l’entreprise ou du groupe bénéficient du plan de valorisation de l’entreprise dès lors qu’ils justifient :
- d’une ancienneté d’au moins 12 mois ;
- ou d’une ancienneté inférieure à 12 mois fixée par le plan.
Le plan peut être mis en place selon les mêmes modalités que celles prévues pour la participation.
Le décret du 30 juin 2024 fixe notamment les modalités de dépôt de l’accord de PPVE, son contrôle administratif, les modalités d’information individuelles des bénéficiaires et les modalités d’affectation de la prime à un plan d’épargne salariale ou retraite.
Le PPVE doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » dans les conditions de droit commun de dépôt des accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement. Ce dépôt est donc effectué par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement.
Doivent y être jointes les pièces suivantes :
- dans tous les cas, la version signée des parties ;
- lorsque le plan est conclu par accord collectif de travail, une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, et, s’il y a lieu, le procès-verbal du référendum d’entreprise organisé pour valider l’accord ;
- dans les trois autres cas (conclusion d’un accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives, conclusion d’un accord au sein du CSE, ratification d’un projet d’accord par les 2/3 du personnel), les documents prévus pour le dépôt de tels accords pour la mise en place des dispositifs d’épargne salariale (articles D.2245-1 à D.3345-3 du code du travail).
Le contrôle de l’accord est fait par l’autorité administrative dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour le contrôle des accords et règlements d’épargne salariale.
Pour rappel, l’administration du travail délivre un récépissé de dépôt de l’accord et des documents annexes et transmet lesdits documents sans délai à l’Urssaf qui dispose d’un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales ou réglementaires.
Ce délai ne court qu’à réception par l’organisme des documents obligatoires précités nécessaires au contrôle, et sous réserve que l’organisme ait préalablement informé le déposant de ce délai, dans ce même délai de trois mois.
Fiche d’information à remettre au début du plan
Après le dépôt de l’accord instituant le PPVE, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
- le montant de référence qui lui est attribué ;
- le cas échéant, le critère de modulation qui lui est appliqué ;
- la règle de valorisation applicable ;
- les conditions prévues pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans.
La remise de cette fiche peut être faite par voie électronique dans des conditions de nature à garantir son intégrité, sauf opposition du salarié concerné.
Fiche d’information à remettre lors du versement de la prime
Les sommes attribuées en application du PPVE doivent faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant pour chaque salarié :
- le montant de référence qui lui a été attribué ;
- le montant de la prime qui lui a été attribuée ;
- la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
- la possibilité d’affectation de ces sommes à un plan d’épargne salariale ou retraite (PEE, PEI, Perco, PERECO, PERO) et le délai de demande d’affectation (voir ci-après) ;
- lorsque la prime est investie sur un tel plan, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles et les cas de déblocage anticipé.
En outre, une note annexée à cette fiche doit rappeler les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le PPVE.
Comme la fiche à remettre au début du plan, cette fiche peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir son intégrité, sauf opposition du salarié concerné.
La demande d’affectation des sommes distribuées par application du PPVE à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERECO ou PERO) doit être formulée par les bénéficiaires dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, de la fiche d’information remise lors du versement de la prime.
Rappelons que le salarié peut affecter tout ou partie de sa prime à un tel plan. Les sommes placées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 3,75 % du PASS.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise après l’expiration du délai de trois ans prévu par le PPVE mais avant la date de versement de la prime, l’employeur doit recueillir l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demander de le prévenir de changements d’adresse éventuels.
Lorsque le calcul de la prime intervient après le départ de salariés susceptibles d’en bénéficier, la fiche d’information à remettre lors du versement de la prime et son annexe leur sont adressées pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de la prime. Passé ce délai, elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 30 ans (article L.518-24 du code monétaire et financier).
► Les sommes attribuées aux salariés en application d’un PPVE sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de la fin de la période de trois ans de durée du plan, et versées en une ou plusieurs fois dans les 12 mois suivants. Selon nous, le texte peut se lire de deux façons : on peut considérer que le délai de 12 mois court pour toutes les entreprises à compter de l’expiration du premier délai maximal de sept mois, ou qu’il court à compter de la date à laquelle les sommes ont été effectivement arrêtées dans l’entreprise, à l’intérieur de ce délai de sept mois. Selon l’interprétation retenue, le point de départ des délais de mise à disposition des sommes par l’entreprise puis par la CDC diffèrent. Un éclairage de l’administration sur ce point serait bienvenu.

Le régime actuel de l’assurance chômage est prolongé jusqu’au 31 juillet
Les règles actuelles d’indemnisation du régime d’assurance chômage, qui avaient été prolongées jusqu’au 30 juin 2024 par décret, sont prolongées d’un mois supplémentaire, jusqu’au 31 juillet 2024, par le décret n° 2024-648 du 30 juin.
Un nouveau texte devrait paraître d’ici fin juillet 2024 pour préciser les futures règles d’indemnisation par l’assurance chômage. Les règles de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage (bonus-malus chômage) restent applicables jusqu’au 31 août 2024.

Le refus de signer le CDD ne caractérise pas la mauvaise foi du salarié
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L 1242-12 du code du travail). Selon une jurisprudence constante, l’absence de signature du CDD par l’une ou l’autre des parties est assimilée à un défaut d’écrit et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) (Cassation 14-11-2018 n° 16-19.038). La Cour de cassation considère qu’un salarié qui a refusé de signer le contrat peut ensuite s’en prévaloir pour obtenir la requalification du contrat, même s’il a accepté de travailler. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cassation 7-3-2012 n° 10-12.091 ; Cassation 10-4-2019 n° 18-10.614).
Rappelons que le contrat signé doit être remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche (article L 1242-13 du code du travail). Cependant, depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée (article L 1245-1 du code du travail).
En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de vendeur, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, par contrat à durée déterminée du 8 octobre 2016 au 8 février 2017, lequel avait été renouvelé une première fois jusqu’au 4 juin 2017. Le salarié avait refusé de signer un nouveau renouvellement de son CDD, n’étant pas d’accord avec son contenu, mais avait continué à travailler. Il avait saisi la juridiction prud’homale en vue notamment d’obtenir la requalification de son contrat en CDI.
Pour la cour d’appel, si la poursuite du travail au-delà du terme ne vaut pas accord du salarié au renouvellement de son contrat et entraîne la requalification en CDI, le refus du salarié de signer peut être pris en compte dès lors qu’il présente un caractère abusif. Elle avait estimé que le salarié ne pouvait pas utiliser le refus de signature pour opposer à l’employeur une action en requalification fondée sur l’absence d’écrit. Mais elle n’avait pas établi en quoi le refus de signature caractérisait la mauvaise foi du salarié.
Assez classiquement, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la signature d’un CDD a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI, qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cassation 7-3-2012 et 10-4-2019 précités).
Elle censure (Cassation n° 22-11.623) l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande du salarié après avoir constaté que le 5 juin 2017 l’employeur avait proposé au salarié un renouvellement de son CDD jusqu’au 7 juillet 2017, qu’il était avéré que ce dernier avait continué à travailler jusqu’au terme du contrat tout en refusant de le signer au motif qu’il n’était pas d’accord avec son contenu. Pour la Haute Cour, de tels motifs, tenant à la poursuite du contrat, étaient impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié.
A notre avis : En pratique, il est préférable pour l’employeur de remettre au salarié son contrat et de lui demander de le signer dès son arrivée dans l’entreprise ou même avant celle-ci. S’il se heurte à un refus de signature du salarié, il doit refuser de l’engager, sous peine de se voir imposer une requalification du contrat s’il ne dispose pas d’éléments de preuve qui lui permettront, le cas échéant, de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de ce dernier.


Rupture conventionnelle : conditions et effets de l’existence d’un vice du consentement de l’employeur
Pour signer une rupture conventionnelle homologuée, les parties au contrat de travail doivent avoir la commune intention de rompre ce contrat. Toutefois, la jurisprudence admet que l’existence d’un litige au moment de la rupture n’affecte pas la validité de la convention. De même, le consentement de chacune des parties ne doit pas avoir été vicié, c’est-à-dire qu’il doit être exempt de notion de dol, violence ou erreur, sous peine de nullité de la rupture.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Aussi, une rupture conventionnelle peut-elle être annulée si les conditions requises par cet article sont réunies.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 19 juin 2024, un responsable commercial signe avec son employeur une rupture conventionnelle le 20 novembre 2018.
Le contrat est rompu le 31 décembre suivant.
L’employeur demande en justice la nullité de la convention de rupture pour dol.
La cour d’appel accède à sa demande. Elle juge que le salarié a bien vicié la rupture conventionnelle par des manœuvres dolosives, prononce la nullité de la rupture et le condamne au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité spécifique perçue à tort et de l’indemnité compensatrice de préavis. Plus concrètement, elle estime que le salarié a commis une réticence dolosive « du fait du défaut d’information volontaire (…) sur le projet d’entreprise initié dans le même secteur d’activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés », l’employeur ne s’étant déterminé qu’au regard « du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management ».
Le salarié se pourvoit en cassation, considérant pour sa part :
- qu’en l’absence de clause de non-concurrence, il n’était pas tenu de révéler spontanément à son employeur son projet de création d’activité concurrente et les actes préparatoires qu’il avait effectués, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne pouvait lui être imputée ;
- que la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.
Mais la Cour de cassation, elle aussi, donne raison à l’employeur.
Elle rappelle que, selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Or, il est établi que l’employeur s’est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié et que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. La cour d’appel a ainsi estimé, à raison, sans faire peser sur le salarié une obligation d’information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d’entreprendre, que le consentement de l’employeur avait été vicié.
► Les précédents ne sont pas légion. La cour d’appel de Metz a annulé une convention de rupture pour dol et erreur en raison de faits commis par le salarié qui auraient justifié son licenciement pour faute grave (en l’occurrence des vols de matériels) (cour d’appel de Metz, 6 mai 2013, n° 11/01105). En revanche, dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour avoir annulé une rupture conventionnelle au motif que le salarié avait invoqué un projet fallacieux de reconversion professionnelle pour obtenir l’accord de l’employeur à la rupture, sans constater que ce projet avait déterminé le consentement de ce dernier (arrêt du 11 mai 2022). Les faits pouvaient paraître plus graves car le salarié ne s’était pas contenté de dissimuler des éléments, il avait menti à son employeur, mais il n’avait pas été établi, ici, par les juges du fond, que les manœuvres du salarié avaient été déterminantes. A l’inverse le contentieux du vice du consentement du salarié est plus nourri et l’arrêt du 19 juin 2024 peut être rapproché d’un arrêt récent dans lequel la Cour de cassation a annulé une rupture conventionnelle car l’employeur avait dissimulé au salarié qu’il préparait un plan de sauvegarde de l’emploi concernant son poste au moment où la rupture avait été signée, le privant ainsi du bénéfice du plan (arrêt du 6 janvier 2021).
Le salarié conteste également devant la Cour de cassation les conséquences déduites par la cour d’appel de l’existence d’un vice du consentement, à savoir la nullité de la convention produisant les effets d’une démission, toute démission devant « résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque ».
Mais la Cour de cassation suit là encore la cour d’appel, jugeant que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission ». En l’espèce, les juges du fond ayant retenu que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle ont exactement décidé que la nullité produisait les effets d’une démission.
► Le salarié est ainsi définitivement condamné à rembourser à son ex-employeur l’indemnité spécifique de rupture perçue au moment de la rupture de son contrat et à verser lui verser une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
C’est la première fois que la Cour de cassation accède à la demande en nullité d’une rupture conventionnelle d’un employeur pour vice du consentement et qu’elle fait produire à cette nullité les effets d’une démission. Elle n’avait jusqu’ici été saisie qu’une seule fois d’une telle demande mais n’y avait pas accédé (voir notre remarque ci-avant sur l’arrêt du 11 mai 2022). Si cette solution est inédite, elle n’en est pas moins logique, puisque les Hauts magistrats jugent depuis longtemps que la nullité d’une rupture conventionnelle prononcée pour vice du consentement du salarié produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause et sérieuse.


Nouvelle modalité d’évaluation de l’avantage en nature logement
Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié gratuitement ou avec une faible participation de sa part un logement, cette mise à disposition constitue un avantage en nature qui doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale. Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature était, jusque récemment, évalué :
– soit forfaitairement, selon un barème mensuel comprenant 8 tranches qui varie en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié et du nombre de pièces principales du logement. Ce barème intègre les avantages accessoires, déterminés selon une liste limitative (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) ;
– soit d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts ou, à défaut, la valeur locative réelle du logement (la valeur locative réelle s’entend du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable) et d’après la valeur réelle des avantages accessoires (arrêté du 10-12-2002 article 2 ; Boss, Avantages en nature n° 230 et suivants, 1-5-2024)
En raison de la suppression de la taxe d’habitation (sauf sur les résidences secondaires), un arrêté publié le 20 juin (NOR : ECOS2414114A) a modifié l’article 2 de l’arrêté du 10-12-2002 concernant les modalités, autre que forfaitaires, de l’évaluation des avantages en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, depuis le 21-6-2024, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature doit être évalué :
– soit forfaitairement, comme auparavant ;
– soit d’après la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l’avantage en nature est actualisée en application de l’article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l’article 1518 bis du même code.

Le taux de cotisation AGS est relevé à 0,25 % à compter du 1er juillet 2024
Le Conseil d’administration de l’Agence de garantie des salaires (AGS) a unanimement décidé, lors de sa réunion du 18 juin 2024, de relever le taux de cotisation AGS de 0,20 % à 0,25 % au 1er juillet 2024. La cotisation AGS, exclusivement patronale, est fixée, depuis le 1er janvier 2024, à 0,20 % tant sur la tranche A que sur la tranche B. Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2023, elle était de 0,15 %.

Exonération des cotisations patronales en ZFRR
À compter du 1-7-2024, le dispositif d’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour l’embauche du 1er au 50e salarié pendant 12 mois dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sera remplacé par une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour l’embauche du 1er au 50e salarié pendant 12 mois dans les nouvelles zones France ruralités revitalisation (ZFRR).
Ainsi, les entreprises implantées en ZFRR qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole et qui ont moins de 50 salariés pourront bénéficier, sous conditions, et pendant 12 mois maximum, d’une exonération de cotisations patronales d’assurance maladie (maladie-maternité-invalidité-décès), de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée et des allocations familiales, pour l’embauche, entre le 1-7-2024 et le 31-12-2029, de leurs 50 premiers salariés dans au moins un établissement situé en ZFRR.
Les embauches doivent être effectuées à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité pour une durée d’au moins 12 mois. L’exonération est totale si la rémunération horaire du salarié est inférieure ou égale à 1,5 Smic, puis elle s’applique de façon dégressive et s’annule lorsque la rémunération horaire atteint 2,4 Smic (article L 241‑19, I du code de la sécurité sociale).
Le classement en ZFRR des communes repose sur trois catégories de critères, la densité de population, l’évolution démographique ainsi que le revenu des habitants définis par l’article 44 quindecies A du CGI. Le classement des communes en ZFRR est établi par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, sera révisé tous les 6 ans (article 44 quindecies A, IV du CGI).
Selon un communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 17 700 communes sont zonées France ruralités revitalisation, 13 départements sont intégralement zonés et les territoires de montagne sont pris en compte dans leur spécificité. Un arrêté du 19-6-2024 (arrêté NOR : TREB2414964A), publié officiellement le 20-6-2024, dresse la liste des communes classées en ZFRR (lire aussi cet article). Ce classement prend effet au 1-7-2024.

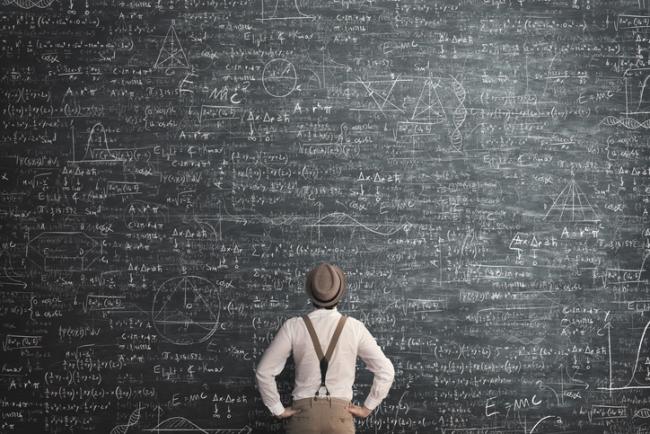
Participation volontaire et possibilité expérimentale de prévoir une formule de calcul moins favorable aux salariés : les précisions administratives
Pour favoriser le développement de la participation volontaire, la loi du 29 novembre 2023 transposant l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise accorde la possibilité aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place un régime de participation volontaire dérogeant à la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dans un sens moins favorable aux salariés.
Le ministère du travail vient de publier un « Questions-réponses » sur cette mesure expérimentale d’une durée de cinq ans.
Rappelons que l’objectif de ce dispositif expérimental est d’exonérer les entreprises faisant le choix d’une formule dérogeant à la formule légale d’une comparaison de leur résultat à celui de la formule légale et de l’obligation de verser a minima le résultat de cette dernière.
► Cette simplification n’a toutefois pas pour effet de supprimer les autres effets des dispositions relatives à la participation, précise le ministère. Ainsi, pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, l’entreprise doit toujours respecter l’un des quatre plafonds prévus à l’article L. 3324-2 du Code du travail en cas de formule dérogatoire ou la mise en place d’un PEE/PEI (QR n° 1).
Les entreprises peuvent conclure un tel accord de participation volontaire expérimental au titre de leur premier exercice clos à compter du 30 novembre 2023 (QR n° 5).
L’expérimentation ne durant que cinq ans, son dernier exercice d’application doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028 (QR n° 6).
► Exemple : une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre (exercice civil) peut mettre en place ce dispositif dérogatoire à compter du 1er janvier 2023. Son dernier exercice d’application sera celui ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2027. Une entreprise qui clôture son exercice au 31 juillet peut mettre en place ce dispositif à compter du 1er août 2024 ; son dernier exercice d’application sera celui ouvert du 1er août 2027 au 31 juillet 2028.
Le ministère rappelle que sont concernées par le dispositif les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation mais qui peuvent s’y soumettre volontairement (QR n° 2).
Autrement dit, sont concernées :
- les entreprises de moins de 50 salariés : attention ! une entreprise de moins de 50 salariés mais faisant partie d’une UES assujettie à la participation n’est pas éligible au dispositif expérimental (QR n° 3) ;
- les entreprises d’au moins 50 salariés qui bénéficient du moratoire de 5 ans ;
- les entreprises d’au moins 50 salariés qui bénéficient, au 1er décembre 2023, du report de trois ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d’intéressement, le temps du report ;
- les nouvelles entreprises d’au moins 50 salariés dont la création ne résulte pas d’une fusion, totale ou partielle, d’entreprises préexistantes qui bénéficient d’un report de deux ans ;
- les entreprises d’au moins 50 salariés dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une RSP selon la formule légale : ces entreprises doivent tout de même surveiller leur bénéfice net fiscal tous les ans pour le cas où il deviendrait suffisant pour calculer une RSP selon la formule légale (QR n° 4).
Un plan d’épargne interentreprises (PEI) comportant un accord de participation ne peut pas prévoir cette nouvelle formule dérogatoire (QR n° 15). En effet, dans un tel cas, les entreprises concernées sont dispensées de conclure un accord de participation et peuvent décider unilatéralement d’appliquer la participation financière de leur entreprise. Or, la négociation collective est privilégiée pour la mise en œuvre du dispositif expérimental (sauf en cas d’adhésion à un accord-type de participation de branche – voir ci-après).
Le ministère rappelle que ce dispositif de participation expérimental peut être mis en place (QR n° 7) :
- soit en concluant un accord de participation d’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 3322-6 du Code du travail : rappelons que cet article prévoit la mise en place d’un dispositif de participation volontaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un tel régime (accord collectif de travail, accord avec des représentants syndicaux, accord avec le CSE ou ratification d’un projet d’accord par les 2/3 du personnel), le recours à la décision unilatérale en cas de participation volontaire à formule dérogatoire moins favorable aux salariés est donc exclu (QR n° 8) ;
- soit en reprenant le dispositif prévu par leur branche (accord de branche agréé) par le biais d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale (QR n° 13) : les branches doivent ouvrir une négociation sur une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale au plus tard le 30 juin 2024 (QR n° 11).
Les entreprises disposant déjà d’un accord de participation ne peuvent pas le modifier pour bénéficier du dispositif expérimental, précise le ministère (QR n° 9). Si elles veulent en bénéficier, elles n’ont d’autre choix que de dénoncer l’accord puis négocier un nouvel accord dont l’échéance ne pourra aller au-delà du 29 novembre 2028.
Remarque : rappelons que pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être dénoncés avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. A cet effet, les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.
En principe, l’accord de participation doit être conclu avant l’expiration du délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (article L.3323-5 du code du travail). Ce délai limite s’applique, que l’accord de participation soit obligatoire ou volontaire.
Toutefois, précise l’administration, lorsque l’accord prévoit une dérogation au mode de calcul de la RSP, le respect du caractère aléatoire de la participation impose que ce mode de calcul dérogatoire s’applique à au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion de l’accord (les résultats sont considérés comme prévisibles dès le 1er jour du 2e semestre de l’exercice).
► Exemple : si une entreprise ayant un exercice fiscal calé sur l’année civile souhaite mettre en place un accord de participation dérogatoire à compter de l’exercice 2023, cet accord devra s’appliquer a minima aux exercices 2023 et 2024 s’il est conclu d’ici le 30 juin 2024 (les résultats ne sont pas considérés comme prévisibles avant le 1er juillet pour l’exercice 2024). Si l’accord est conclu à compter du 1er juillet 2024, il devra s’appliquer a minima aux exercices 2023, 2024 et 2025.
La formule de calcul dérogatoire ne peut pas reposer sur des objectifs de performances de l’entreprise, exprime le ministère du travail, contrairement à l’intéressement. « Cette formule doit reposer sur des résultats financiers et non des objectifs liés à la productivité », précise-t-il (QR n° 16).
► La participation est entièrement attachée aux résultats de l’entreprise. L’expérimentation n’en change pas l’esprit.
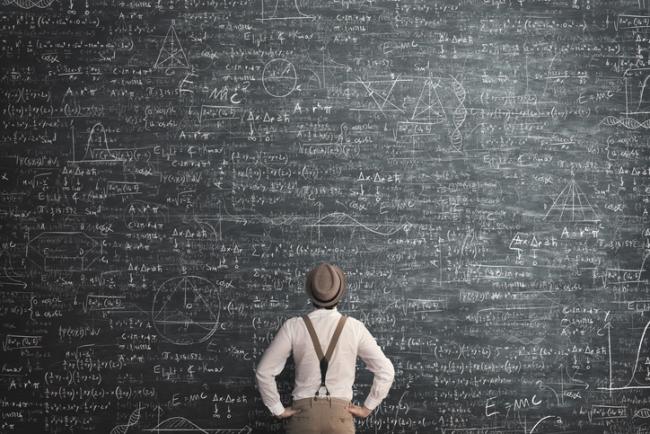

Violation d’une clause de non-concurrence frappée de nullité : quelle incidence sur la contrepartie financière ?
Un salarié avait été engagé en qualité d’attaché technico-commercial sédentaire par une entreprise offrant des services d’aéraulique du bâtiment. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an sur l’ensemble du territoire français. Après sa démission, son employeur a saisi la juridiction prud’homale afin de voir constater la violation de son obligation de non-concurrence et d’obtenir en conséquence le remboursement de la contrepartie financière versée.
Devant la Cour de cassation, l’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé la clause de non-concurrence sans avoir apprécié concrètement la restriction à la liberté du travail apportée par la clause, de ne pas avoir préservé la clause en réduisant son champ d’application géographique au périmètre correspondant à l’intérêt légitime de l’entreprise et, enfin, de ne pas lui avoir accordé le remboursement de l’indemnité versée pour la période où le salarié n’a pas respecté l’obligation prévue par la clause annulée.
Constituant une entrave à la liberté de travailler du salarié, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Cassation 10-7-2002 n°s 00-45.135, n° 00-45.387 et n° 99-43.334).
Le seul champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle (Cassation 20-1-1999 n° 96-45.669 ; Cassation 3-7-2019 n° 18-16.134 ; Cassation 15-12-2021 n° 20-18.144). Ainsi, la clause comportant une interdiction de concurrence sur l’ensemble du territoire français n’est pas nécessairement nulle (Cassation 18-2-1997 n° 94-44.202 ; Cassation 15-12-2009 n° 08-44.847). C’est seulement associé à d’autres éléments, en particulier la portée de la clause et la spécificité de l’activité exercée, que le champ d’application géographique peut constituer une entrave à la liberté de travail (Cassation 25-3-1998 n° 95-41.543 ; Cassation 23-10-2001 n° 99-44.219).
Pour prononcer la nullité de la clause, il appartient aux juges du fond, à partir des éléments versés aux débats, d’établir en quoi celle-ci empêche le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle (Cassation 18-12-1997 n° 95-43.409 ; Cassation 15-12-2021 n° 20-18.144).
En l’espèce, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-17.036) approuve la cour d’appel d’avoir annulé la clause après avoir relevé que le caractère concurrentiel et mouvant de l’activité de l’entreprise ne justifiait pas la restriction à la liberté de travail du salarié prévue par la clause de non-concurrence, excessive au regard de sa qualification de technico-commercial, et fait ainsi ressortir que cette clause, compte tenu des fonctions effectivement exercées, n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Le juge peut, lorsqu’une clause de non-concurrence ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en limitant son effet dans le temps, dans l’espace ou ses autres modalités (Cassation 18-9-2002 n° 00-42.904).
Au sujet d’une clause de non-concurrence incompatible avec les stipulations de la convention collective applicable, la Cour de cassation a estimé que le juge ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié (Cassation 12-10-2011 n° 09-43.155).
Cette exigence devait-elle s’appliquer au-delà du contexte d’une clause incompatible avec la convention collective ? L’arrêt du 22 mai 2024 répond à cette question par l’affirmative. La Cour de cassation confirme, en effet, cette solution : le juge ne peut réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité est invoquée par le salarié.
En principe, un contrat nul ne peut produire aucun effet, ce qui implique que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Mais cela n’est pas toujours possible lorsque le contrat a été exécuté, en particulier lorsqu’il s’agit d’une clause de non-concurrence prévoyant une entrave à la liberté de travailler en contrepartie du versement d’une indemnité. Et la situation se complique d’autant lorsque la clause annulée n’a pas été respectée.
Pour faire droit au pourvoi de l’employeur reprochant à la cour d’appel de ne pas lui avoir accordé le remboursement de l’indemnité pour la période où le salarié n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence, la Cour de cassation articule sa jurisprudence organisant les restitutions résultant d’une clause de non-concurrence nulle avec celle sur les conséquences de la violation d’une clause de non-concurrence.
Le salarié conserve l’indemnité perçue…
Selon la Cour de cassation, si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré. Il s’ensuit que, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle (Cassation 17-11-2010 n° 09-42.389). Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
A noter : Pour attribuer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi, la Cour de cassation se fonde sur le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et sur l’article L 1121-1 du Code du travail, aux termes duquel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Pour rappel, en cas de violation de la clause de non-concurrence, le salarié conserve le droit au paiement de la contrepartie pécuniaire pour la période antérieure pendant laquelle il a respecté son obligation (Cassation 27-3-1996 n° 92-41.992 ; Cassation 18-2-2003 n° 01-40.194) ; la violation de la clause ne lui permet plus de prétendre au bénéfice de cette contrepartie même s’il respecte à nouveau son obligation de non-concurrence (Cassation 31-3-1993 n° 88-43.820 ; Cassation 5-5-2021 n° 20-10.092 ; Cassation 24-1-2024 n° 22-20.926).
Dans l’arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation, qui applique sa jurisprudence au cas d’une clause nulle, estime que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Ainsi, la Haute Juridiction décide que, pour débouter l’employeur de ses demandes d’indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d’appel ne pouvait retenir que la clause de non-concurrence était nulle, sans rechercher si le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.
A noter : Si le salarié ayant violé une clause de non-concurrence nulle ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave à la liberté de travailler, il devrait néanmoins pouvoir être indemnisé du préjudice distinct résultant de la nullité de la clause comme cela a été jugé antérieurement (Cassation 27-9-2017 n° 16-12.852).


Discrimination liée au handicap et non-respect de l’obligation de reclassement : régime probatoire
En vertu de l’article L.5213-6 du code du travail, l’employeur doit prendre des mesures appropriées d’aménagements raisonnables pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserves que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 du même code. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination.
Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur le régime probatoire applicable en cas de non-respect de ces obligations.
► Le rapporteur fait valoir que l’étude des arrêts d’appel sur ce sujet révèle une confusion sur cette question, les cours d’appel se fondant tantôt sur l’obligation de reclassement et tantôt sur la discrimination. Or, le mécanisme probatoire de ces deux notions, les sanctions et le contrôle qu’exerce la Cour de cassation dessus sont discincts.
Ainsi, la notice jointe à l’arrêt rappelle qu’il convient de distinguer ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce qui relève du droit de la discrimination, dont la sanction est la nullité du licenciement.
En l’espèce, une salariée reconnue en qualité de travailleur handicapé est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été discriminée car l’employeur n’a pas mis en place de mesures d’aménagements, elle saisit les tribunaux pour obtenir la nullité de son licenciement.
Les juges d’appel font droit à sa demande. Ils retiennent que la société n’a pas respecté les obligations de l’article L.5213-6 du code du travail, puisqu’elle n’a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé et n’a proposé aucune mesure particulière à la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant à la cour de ne pas avoir appliqué le mécanisme probatoire de la discrimination issu de l’article L.1134-1 du code du travail. Elle en livre un mode d’emploi en deux temps pour les juges du fond saisis d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap. Ceux-ci doivent ainsi :
- en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ;
- en second lieu, rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
En conséquence, si le salarié décide de fonder son action sur la discrimination, il doit dans un premier temps présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, la seule qualité de travailleur handicapé ne constituant pas, à elle seule, un tel élément.
► La Cour de cassation avait déjà jugé dans une précédente affaire que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le fait que l’employeur refuse de prendre les mesures pour permettre au salarié de conserver son emploi, sans justifier de leur caractère disproportionné, caractérise une discrimination liée au handicap et entraîne la nullité du licenciement (arrêt du 3 juin 2020).

