ACTUALITÉ
SOCIAL

Suivi médical des salariés : un questions-réponses du ministère du travail du 18 septembre fait le point
Le ministère du travail a publié une liste de 31 « questions-réponses » (QR) relatives au suivi de l’état de santé des salariés sur son site le 17 septembre qui a été mise à jour le 18 septembre. Ces QR sont réparties sous cinq rubriques :
- les compétences de certains professionnels de santé au travail intervenant au sein du SPST (service de prévention et de santé au travail) en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs : collaborateur médecin, infirmier de santé au travail, infirmier non formé en santé au travail, infirmier intérimaire, médecin praticien correspondant ;
- les visites d’information et de prévention : documents ne pouvant être délivrés au travailleur à l’issue d’une visite d’information et de prévention, l’orientation possible vers une visite d’aptitude… ;
- les spécificités du suivi individuel renforcé ;
- les visites de reprise, de préreprise, à la demande de l’employeur ou du médecin du travail : documents à remettre au salarié, informations délivrées ;
- la déclaration d’inaptitude
Dans son questions-réponses, le ministère du travail laisse entendre que des textes réglementaires seront prochainement publiés ou sont attendus en évoquant :
1) La nécessité de la publication de deux arrêtés pour mettre en place de manière effective le recours au médecin praticien correspondant ;
2) La publication prochaine d’un arrêté, remplaçant celui du 16 octobre 2017, modifiant les modèles d’attestation de suivi et d’avis d’aptitude et d’inaptitude. En effet, dans trois réponses, le ministère du travail a fait allusion à ce projet d’arrêté mais de manière maladroite car laissant entendre que la publication de cet arrêté était déjà actée :
- « l’attestation de suivi dont le modèle figure en annexe de l’arrêté de 2017 a été modifiée C’est à cet effet que le modèle d’attestation de suivi a été modifié pour permettre de rappeler que le poste a déjà, par le passé, fait l’objet d’un aménagement » ;
- « l’actualisation des modèles de fiches (d’attestation de suivi) a été nécessaire afin de prendre en compte les principales évolutions apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail en matière de suivi individuel de l’état de santé : les nouvelles délégations aux infirmiers de santé au travail (IDEST), la création des médecins praticiens correspondants et de la visite de mi-carrière. Cette mise à jour a également été l’occasion de les simplifier et d’effectuer des améliorations et des éclaircissements, par exemple, la mention d’un aménagement de poste en cours, d’une réorientation vers le médecin du travail, l’intégration des visites post-exposition et post-professionnelle, la possibilité de rédiger et préciser certaines indications sur la fiche d’aptitude » ;
- de nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude seront publiés par arrêté prochainement pour tenir compte des évolutions issues de la loi du 2 août 2021″.
Nous reprenons ci-après, les réponses du ministère du travail dans les cinq rubriques qui nous semblaient apporter des précisions nouvelles et intéressantes.
| Professionnels de santé au travail du SPST | |
| Collaborateur médecin |
|
| Interne en médecine du travail |
|
| Infirmier de santé au travail |
|
| Infirmier intérimaire |
« En cas de besoins/surcharges ponctuels, les services de prévention et de santé au travail peuvent recourir à des infirmiers intérimaires. Ces infirmiers sont autorisés à exercer leurs missions propres, dans le respect des dispositions des articles R.4311-1 et suivants du code de la santé publique. Ils peuvent, à cet égard, conduire des entretiens infirmiers mentionnés à l’article R.4623-31 du code du travail, mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité, indépendamment des visites et examens intervenant dans le cadre du suivi individuel des travailleurs et prévus par le code du travail, par exemple en matière de prévention des conduites addictives. Ceux ayant suivi une formation spécifique en santé au travail pourront effectuer certaines visites et examens ». ► Le recours à un infirmier intérimaire sans compétence en santé au travail nous semble problématique dans la mesure où le ministère du travail prévoit que cet infirmier pourrait conduire des entretiens infirmiers prévus par le code du travail sans avoir connaissance des spécificités de la prévention dans le milieu du travail. Cela contrevient à l’article R.4623-29 qui prévoit que « si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue » . Est ce que l’infirmier intérimaire, du fait de la précarité de son emploi, pourra suivre une telle formation ? |
| Médecin praticien correspondant (« médecin de ville ») |
|
| Visite d’information et de prévention : documents à délivrer | |
| Orientation sans délai vers le médecin du travail à l’issue d’une visite d’information et de prévention | « En fonction de l’organisation du service (de santé au travail), cette visite (auprès du médecin du travail) peut même avoir lieu immédiatement. La réorientation vers le médecin du travail est immédiate par la programmation d’un rendez-vous avec le médecin du travail dans les meilleurs délais ». |
| Suivi des travailleurs exposés au groupe 2 des agents biologiques |
|
| Spécificités du suivi individuel renforcé | |
| Postes à risque définis réglementairement (évoqués au II du R.4624-23) outre la liste prévue au I de l’article R.4624-23) |
« En l’état actuel des textes, entrent dans le champ du II de l’article R.4624-23 du code du travail, c’est-à-dire les postes à risque définis réglementairement en sus de la liste établie dans le I, les catégories suivantes de postes :- les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage (article R.4323-56 du code du travail) ;
► Cette liste permet de donner plus de précisions au II de l’article R.4624-23 du code du travail qui se contente de prévoir : « Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code ». |
| Exclusion des chauffeurs poids lourds du suivi médical renforcé |
« Les chauffeurs poids lourds n’entrent pas dans la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R.4624-23 du code du travail et relèvent du suivi médical de droit commun prévu par le code du travail ». ► Le ministère du travail explique cette exclusion en précisant que l’examen d’aptitude spécifique demandé aux chauffeurs poids lourds n’est pas prévu par le code du travail mais par le code de la route et donc n’est pas visé par l’article R.4623-56-II du code du travail. |
| Autres visites et examens | |
| Visite non périodique (visite de mi-carrière, visite de reprise, visite à la demande) |
« Les visites « non périodiques » (visites de reprise, et à la demande) peuvent être « couplées » avec une visite périodique. À l’issue de ces visites conjointes, le professionnel de santé devra établir et remettre deux fiches, une pour la visite périodique et une seconde pour l’autre visite ». ► Le ministère du travail étend la règle issue de l’article L.4624-2-2 concernant la visite de mi-carrière aux autres visites non périodiques. Il appartiendra aux juges de se prononcer. |
| L’inaptitude et ses suites | |
| Echange employeurs/médecin du travail |
|
| Situation du travailleur dans l’attente de la décision d’inaptitude (délai de 15 jours) |
« Dans l’attente de la décision d’inaptitude (pendant la période dévolue aux échanges, aux études de poste et des conditions de travail avant le constat de l’inaptitude du travailleur) qui doit être prise dans un délai limité à 15 jours (à compter de la visite de reprise), le travailleur perçoit sa rémunération. Dans certains cas, le travailleur pourra bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ». ► Cette précision semble contraire à l’article L.1226-4 (ou L.1226-11) qui prévoit que la rémunération du salarié déclaré inapte n’est due qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la visite de reprise. Ce qui semble exclure toute rémunération entre la visite de reprise et le constat d’inaptitude lorsque ce constat a été notifié ultérieurement (dans le délai de 15 jours). Il appartiendra aux juges de donner leur appréciation. |


Inaptitude : la proposition de reclassement conforme est présumée loyale
L’employeur peut licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement un salarié déclaré inapte s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 (inaptitude non professionnelle) ou L.1226-10 (inaptitude professionnelle) du code du travail et conforme aux préconisations du médecin du travail. Dans ce cas, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite en application de l’article L.1226-2-1 ou L.1226-12 du code du travail (arrêt du 13 mars 2024 ; arrêt du 26 janvier 2022) .
Toutefois la Cour de cassation a toujours précisé que cette présomption ne joue que si l’obligation de reclassement a été exécutée loyalement (arrêt du 26 janvier 2022). Mais sur qui pèse la charge de la preuve du caractère loyal de la proposition de reclassement ? La Cour de cassation vient de répondre clairement que cette preuve incombe au salarié.
En l’espèce, un salarié contestait son licenciement pour inaptitude pour non-respect de l’obligation de reclassement. L’employeur lui avait proposé neuf postes au sein du groupe, conformes aux préconisations du médecin du travail mais tous éloignés géographiquement du domicile du salarié, raison pour laquelle celui-ci les avait refusés.
La cour d’appel lui fait droit après avoir relevé qu’il existait de nombreux autres postes à pourvoir et que la société ne produisait pas le registre unique du personnel de ses établissements situés en région Normandie. Elle en avait déduit qu’’à défaut de rapporter la preuve qu’il n’existait pas en Normandie de postes disponibles compatibles avec les qualifications et les capacités physiques restantes du salarié, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle considère que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en s’appuyant sur l’’article 1354 du code civil selon lequel « la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ».
Il en résulte que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
A titre d’exemples, l’obligation de reclassement est déloyale lorsque :
- l’employeur propose certains postes préconisés par le médecin du travail mais pas celui qui avait été pourtant déjà occupé par le salarié, pour lequel il était demandeur et qui était disponible (arrêt du 26 janvier 2022) ;
- l’employeur ne propose pas le poste en télétravail préconisé par le médecin du travail même si le télétravail n’était pas mis en place dans l’entreprise (arrêt du 29 mars 2023).
► En conséquence, le salarié aura tout intérêt à échanger avec le médecin du travail, ainsi qu’avec le CSE, s’il existe, sur ses desiderata sur le poste de reclassement pour orienter les recherches de reclassement de l’employeur. Si un tel poste est disponible, répond aux compétences du salarié et qu’il a été préconisé par le médecin du travail, l’employeur devra le proposer en priorité pour exécuter loyalement son obligation de reclassement.


L’obligation de négocier sur la GEPP est subordonnée à l’existence d’un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l’entreprise
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’ouvrir des négociations au moins une fois tous les quatre ans, sur les thèmes suivants (article L.2242-1 du code du travail) :
- la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, (c’est-à-dire les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale mais aussi les plans d’épargne retraite d’entreprise) ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération) et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
► L’existence d’une section syndicale se manifeste par la désignation d’un ou plusieurs délégués syndicaux si l’effectif de l’entreprise atteint au moins 50 salariés. Si l’effectif est inférieur, cette existence se manifeste lorsqu’un membre du CSE est désigné comme délégué syndical.
Les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés (ou entreprises communautaires comportant un comité d’entreprise européen d’au moins 300 salariés et une entreprise d’au moins 150 salariés en France) doivent également ouvrir des négociations au moins tous les quatre ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (article L.2242-2 du code du travail).
L’article L.2242-2 précité ne subordonne pas expressément l’obligation de négocier sur la GEPP à l’existence de syndicats représentatifs dans l’entreprise, comme le fait l’article L.2242-1. Cette condition s’applique-t-elle aussi à ce thème ?
Dans un arrêt du 19 janvier 2022 qui portait sur la négociation obligatoire relative à la GEPP, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles L.2242-1 et L.2242-2 précités et dans des termes généraux, que « l’obligation de négociation est subordonnée à l’existence dans l’entreprise d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives » dans l’entreprise. L’arrêt d’appel est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel. Mais l’affaire lui revient. L’occasion, pour elle, de réitérer sa position en précisant, cette fois-ci, que la condition s’applique bien à la négociation relative à la GEPP.
► A l’époque des faits, les négociations sur la GEPP (dénommée GPEC) devaient être ouvertes tous les trois ans.
Dans cette affaire, une société comptant environ 1 200 salariés au sein de 122 magasins est assignée en justice par un syndicat, le 27 novembre 2018. Celui-ci réclame, entre autres, que soit ordonné à la société d’ouvrir des négociations sur la GEPP (GEPC à l’époque des faits) sous astreinte et le paiement de dommages-intérêts pour entrave à la négociation.
En effet, aucune négociation relative à la GPEC n’avait été ouverte par l’employeur entre 2015 et 2019.
Le syndicat avait désigné le 26 juillet 2012 un délégué syndical mais uniquement pour un des sept établissements distincts que compte l’entreprise, en application du PAP.
Ce n’est qu’à la suite des élections d’octobre 2016 que le syndicat désigne, le 16 novembre 2016, deux délégués syndicaux au niveau de l’entreprise.
Il est débouté une première fois de ses demandes aux motifs que :
- la désignation des deux délégués syndicaux n’est intervenue que le 16 novembre 2016 (l’un d’entre eux s’est, en outre, vu retirer son mandat en 2017) ;
- en 2015 et 2016, aucune négociation annuelle obligatoire n’a pu être ouverte en raison de l’absence systématique du délégué syndical aux réunions ;
- le syndicat n’a évoqué cette négociation pour la première fois que le 31 octobre 2018 et ne l’a expressément sollicitée que le 18 juin 2019.
► Les juges rappellent également que la périodicité de cette négociation était triennale jusqu’au 20 décembre 2017 puis quadriennale ensuite.
La Cour de cassation casse l’arrêt (arrêt du 19 janvier 2022 précité). Le motif tenant à l’absence de demande de négociations est inopérant. De plus, il résultait des constatations des juges d’appel que le syndicat était représentatif au sein de l’entreprise depuis 2012 (le périmètre de désignation du délégué syndical désigné en 2012 n’avait visiblement pas été remis en cause par la société).
L’affaire est rejugée en appel pour le même résultat mais cette fois-ci, les juges d’appel relèvent bien la désignation du délégué syndical en 2012 ne portait que sur un des sept établissements de l’entreprise et qu’aucun délégué syndical n’avait été désigné au niveau de l’entreprise jusqu’au 16 novembre 2016. Ils en concluent que le délai de la négociation d’un accord sur la GEPP n’était pas acquis au moment de la saisine du tribunal par le syndicat le 27 novembre 2018.
A bon droit, selon la Cour de cassation.
Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation, cette fois-ci, ne fonde sa décision que sur l’article L 2242-2 du code du travail et précise bien que « l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ».
Ce faisant, dès lors que l’entreprise dispose d’un syndicat représentatif et de délégués syndicaux, l’employeur doit ouvrir des négociations au moins une fois tous les quatre ans (tous les trois ans à l’époque des faits de l’espèce), sous peine d’une condamnation au versement de dommages et intérêts pour entrave à la négociation.
Peu importe à cet égard l’absence systématique du délégué syndical aux réunions ou la sollicitation tardive du syndicat.
En revanche, cette obligation ne s’impose à l’employeur qu’à partir du moment où la représentativité du syndicat est reconnue. S’agissant des négociations obligatoires, elle s’impose donc dès lors qu’un délégué syndical est désigné au niveau de négociation requis (à savoir ici, l’entreprise).
► Pour rappel, la représentativité d’un syndicat ne peut être contestée de façon générale. Elle ne peut l’être que par rapport à l’exercice d’une prérogative précise (arrêt du 7 décembre 1995 ; arrêt du 24 janvier 2018). La contestation de la représentativité surgit en général à l’occasion de la désignation d’un délégué syndical qui entraîne la mise en œuvre de l’obligation de négocier.


L’indemnité pour repos compensateur non pris est exclue de l’assiette des indemnités de rupture
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement dont l’assiette est égale, selon la formule la plus avantageuse pour lui, à (articles L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail) :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, celle de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En outre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur. Son montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut fixés légalement (article L 1235-3 du code du travail).
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.520), la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la question de savoir si l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement et celle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à un salarié doivent ou non intégrer l’indemnité qui lui est octroyée par ailleurs au titre des contreparties obligatoires en repos non prises.
A noter : S’agissant de l’assiette de l’indemnité de licenciement, la Cour de cassation a déjà jugé que doivent y être inclus :
– un rappel de salaire correspondant à la période de référence (Cassation n° 00-44.789 ; Cassation n° 21-16.057), mais pas un rappel de commission versé pendant la période de référence correspondant en réalité à des droits acquis auparavant (Cassation n° 87-41.500) ;
– les pourboires, lorsque ceux-ci sont centralisés par l’employeur (Cassation n° 78-41.528) ;
– les indemnités de congés payés, qu’elles soient versées par l’employeur ou par une caisse de congés payés (Réponse Richard : Assemblée nationale 17-2-1992 n° 50902) mais pas l’indemnité compensatrice de congés payés non pris car cette créance salariale ne correspond pas à la période de référence (Cassation n° 03-45.318).
En l’espèce, un responsable des dépôts soumis à une convention de forfait annuel en jours est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Il demande également dans ce cadre que la convention de forfait qu’il a signée lui soit déclarée inopposable (CA Riom 22-11-2022 n° 20/00479) et formule diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel juge la convention de forfait privée d’effet et le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui verser notamment (CA Riom 22-11-2022 n° 20/00479) :
– une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018 pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;
– une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en intégrant au montant du salaire de référence retenu pour leur calcul le montant de la première indemnité.
Estimant que cette dernière indemnité n’aurait pas dû être intégrée dans le salaire servant de base au calcul des deux indemnités de rupture, l’employeur se pourvoit en cassation. À l’appui de son pourvoi, il fait valoir que l’indemnité allouée au titre du repos compensateur non pris en raison de la contestation, par ses soins, de l’existence d’heures supplémentaires a le caractère de dommages-intérêts et n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité légale de licenciement ni dans celle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’écartant de l’avis de l’avocate générale référendaire, qui considérait que l’indemnité de repos compensateur non pris revêtait une nature salariale et devait donc être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Pour elle, la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n’a pas à être prise en compte pour déterminer le salaire de référence servant au calcul des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A noter : Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation retient que l’indemnité pour repos compensateur non pris a la nature de dommages-intérêts. Elle en a ainsi jugé pour dire que cette indemnité :
– n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales (Cassation n° 00-17.851) ;
– n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cassation n° 99-45.890).
La Cour de cassation considère, en effet, que le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi (Cassation n° 99-40.879 ; Cassation n° 03-45.385 ; Cassation n° 21-12.068), comme c’était le cas dans l’affaire jugée le 4 septembre 2024 puisque, l’employeur ayant mis en œuvre une convention de forfait non valable, le salarié n’avait pas pu formuler de demande de prise de la contrepartie en repos.
Néanmoins, la question de la nature de cette indemnité pouvait se poser au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription. Elle retenait en effet que l’indemnité pour repos compensateur non pris était soumise à la prescription applicable aux salaires (Cassation n° 02-47.163 ; Cassation n° 03-45.482 ; Cassation n° 19-14.522). Ces arrêts étaient toutefois antérieurs à ceux dans lesquels la Haute Juridiction a dégagé un critère pour la détermination de la prescription applicable à chaque demande. Elle considère en effet désormais que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cassation n°s 18-23.932, 19-10.161, 19-14.543, 20-12.960, 19-16.655). La Cour de cassation posant ici clairement, dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin de ses chambres civiles, la nature de dommages-intérêts de cette indemnité pour repos compensateur non pris, il était logique qu’elle fasse évoluer sa jurisprudence en matière de prescription par rapport à cette indemnité comme elle vient de le faire dans un arrêt du même jour (Cassation n° 22-20.976).


Actions relatives aux salaires et indemnités : nouvelles illustrations de la prescription applicable
La Cour de cassation a posé pour principe, dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021, que la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande (Cassation n°s 18-23.932, 19-10.161, 19-14.543, 20-12.960 et 19-16.655). Elle a illustré ce principe s’agissant de demandes principales en rappels de salaires fondées sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours, la monétisation du compte épargne-temps, la requalification du contrat à temps partiel en temps plein, la contestation de la classification professionnelle ou encore l’inégalité de traitement.
Les délais de prescription applicables aux actions prud’homales sont fixés par plusieurs textes de portée générale et assortis de dérogations. L’article L 1471-1 du Code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine du droit (article L 1471-1, al. 1 du code du travail), tandis que la prescription annale (12 mois) s’applique aux actions relatives à la rupture du contrat de travail (article L 1471-1, al. 2). Le texte exclut les actions en réparation d’un dommage corporel (10 ans) et les actions fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral (article L 1471-1, al. 3). L’article L 3245-1 du Code du travail prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Mais d’autres délais de prescription spéciaux sont susceptibles de primer sur le délai annal, biennal ou triennal. La demande du salarié peut relever de la prescription de 5 ans afférente à l’action relative à une discrimination (article L 1134-5). Ainsi, la demande de versement d’une gratification afférente à la médaille du travail, fondée sur des faits de discrimination à raison de l’âge, relève de la prescription quinquennale de l’article L 1134-5 et non de la prescription salariale (Cassation n° 19-14.543).
Enfin, chaque fois que l’action ne relève d’aucun texte spécial, c’est la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du Code civil qui s’applique. C’est le cas de l’action exercée sur le fondement d’un harcèlement en application des articles L 1152-1 et L 1153-1 du Code du travail ou de l’action fondée sur le manquement de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire (Cassation n° 22-17.240).
Dans plusieurs arrêts du 4 septembre 2024 destinés à la publication, la chambre sociale de la Cour de cassation applique le principe de détermination du délai rappelé ci-dessus à diverses actions en dommages et intérêts ou en rappels de salaires formés par le salarié au cours d’une même action. Ces solutions illustrent l’office du juge qui doit, pour chaque demande, rechercher la nature de la créance objet de celle-ci et déterminer la prescription applicable.
Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 23-13.931, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la question des règles de prescription applicables dans le cas d’une demande portant sur l’affectation de jours de repos non pris à un plan d’épargne retraite, en l’espèce un Perco. Dans ce litige, un salarié d’une société du secteur du BTP demande le 19 décembre 2016 à son employeur le transfert de 4 jours de RTT vers le dispositif de Perco mis en place dans la branche dont relève son entreprise. L’accord-cadre instituant ce plan d’épargne stipule que les salariés de la branche qui n’ont pas accès à un plan d’épargne salariale d’entreprise, de groupe ou interentreprises peuvent adhérer directement à ce Perco. Mais l’employeur refuse d’effectuer cette affectation. L’intéressé saisit le conseil de prud’hommes le 25 avril 2019 pour demander à titre principal le transfert des 4 jours de repos ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral et, à titre subsidiaire, le paiement de l’indemnité de RTT pour ces 4 journées perdues.
La cour d’appel juge l’ensemble des demandes irrecevables, considérant qu’elles sont relatives à l’exécution du contrat de travail et relèvent donc de la prescription biennale prévue par l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Or, le salarié a saisi le juge 2 ans et 4 mois après sa demande de transfert des jours.
Le salarié forme un pourvoi en cassation, faisant valoir, pour l’ensemble de ses demandes, l’application de la prescription triennale relative aux créances de nature salariale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation répond en 3 temps, chaque demande du salarié devant faire l’objet d’une analyse autonome pour déterminer la nature de la créance et, ainsi, la durée de prescription applicable.
La demande de transfert de 4 jours de RTT sur un Perco est de nature salariale
S’agissant de la demande du salarié portant sur le transfert de 4 jours de RTT sur le Perco, la cour d’appel a considéré qu’elle relevait de l’exécution du contrat de travail. Mais l’analyse de la Cour de cassation est différente : elle relève que l’article L 3334-8 du Code du travail autorise le salarié, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à verser sur le Perco des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.
Or, comment sont valorisés les jours de repos non pris ? L’arrêt rappelle que l’indemnité pour jours de RTT correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail. Et la chambre sociale d’en déduire que la demande du salarié relative au versement de jours de RTT sur le Perco a une nature salariale.
A noter : En effet, les jours de RTT constituent la contrepartie d’un travail supérieur à 35 heures hebdomadaires (Cassation n°10-20.473) et l’indemnité pour jours de RTT non pris correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l’exécution d’un travail entre 35 et 39 heures (Cassation n° 04-17.096).
La cour d’appel a donc violé les textes relatifs à la prescription et au Perco en déboutant le salarié, alors que ce dernier avait bien saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de prescription de 3 ans après la date de sa demande d’affectation de jours de RTT au Perco.
A notre avis : L’affectation de « sommes correspondant à des jours de repos non pris » est également possible sur un Pereco, le plan d’épargne retraite institué par la loi Pacte du 22 mai 2019 (article L 224-2, 2° du code monétaire et financier). La solution de l’arrêt du 4 septembre 2024 semble transposable à ce plan, étant donné la similarité des textes relatifs aux 2 dispositifs quant aux modalités d’alimentation. La solution devrait également être applicable, selon nous, aux demandes portant sur le transfert vers un plan d’épargne retraite de jours de repos affectés à un compte épargne-temps (CET). Il a déjà été jugé que l’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un CET, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale (Cassation n° 19-14.543).
La demande de réparation du préjudice relève de l’exécution du contrat de travail
S’agissant des demandes du salarié de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral résultant de la perte de chance de placement des 4 jours sur ces fonds et d’abondement de ces sommes, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond selon laquelle il ne s’agit pas d’une action en paiement ou en répétition du salaire mais d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail, qui se prescrit par 2 ans comme prévu par l’article L 1471-1 du Code du travail. Comme le souligne l’avis rendu sur cette affaire par l’avocate générale référendaire, Mme Molina, les demandes du salarié sont de nature indemnitaire, pour réparer un préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
A noter : Dans son étude de 2023 intitulée «La prescription en droit du travail», la Cour de cassation indique que les créances indemnitaires constituent le cœur du champ d’application du délai biennal de prescription, prenant l’exemple de l’inégalité de traitement : lorsque le salarié invoque une telle inégalité, sa demande d’un rappel de salaire relève de la prescription triennale mais sa demande de dommages-intérêts entre dans le champ de l’article L 1471-1 du Code du travail.
Le pourvoi du salarié faisait valoir que cette demande de réparation d’un préjudice était intrinsèquement liée à la demande principale, de nature salariale, portant sur le transfert des jours de RTT sur le Perco, et devait dès lors se voir appliquer la même durée de prescription de 3 ans. Mais l’avis de l’avocate générale insiste sur le fait que le juge doit analyser distinctement, pour chaque demande, la nature de la créance, sans tenir compte d’un lien de dépendance nécessaire entre une demande et une autre. Il s’agit de l’application dite «distributive» des règles de prescription.
La demande d’indemnités compensatrices de RTT perdues est de nature salariale
À titre subsidiaire, le salarié sollicitait le paiement d’indemnités compensatrices au titre des 4 jours de RTT qu’il avait perdus du fait de leur non-affectation au Perco par l’employeur, ainsi que les congés payés afférents. La cour d’appel avait rattaché cette demande aux demandes principales et avait appliqué la prescription biennale. Elle avait ainsi débouté le salarié. La Haute Juridiction casse l’arrêt de cour d’appel sur ce point, en rappelant que l’indemnité pour jour de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale. La demande relevait donc de la prescription triennale.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, dit «repos compensateur de remplacement» (article L 3121-28 du code du travail). Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie (articles D 3171-11 et D 3171-12).
Dans l’affaire n° 22-20.976, une salariée, licenciée en février 2017, formule une demande de dommages-intérêts au titre de ce repos en raison de l’absence de communication de ce document d’information par son employeur. La cour d’appel la déboute de sa demande au titre des années 2012 à 2014 au motif que cette dernière avait reçu mensuellement ses bulletins de paie et avait pu constater, le cas échéant, l’absence d’information sur le nombre de repos compensateurs auxquels elle pouvait prétendre. La cour d’appel, appliquant un délai de prescription triennal, considère l’action prescrite. L’arrêt de la cour d’appel est censuré pour violation de la loi.
L’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription biennale…
Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation juge que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L 1471-1 du Code du travail.
Auparavant, la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait, en matière de repos compensateur (devenu «contrepartie obligatoire en repos»), que le délai de prescription applicable à une telle demande était de 5 ans (Cassation n° 04-45.881 ; Cassation n° 05-43.713 ; Cassation n° 08-40.891). Cette solution était transposable au repos compensateur de remplacement.
A notre avis : La présente décision s’explique à notre sens par l’application désormais constante du principe selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. La Cour de cassation juge en effet que l’indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l’employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts (Cassation n° 99-45.890). Or, la chambre sociale applique habituellement la prescription biennale aux actions en paiement de dommages-intérêts (par exemple, Cassation n° 16-21.735).
… et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits
Une fois le délai de prescription fixé, restait à déterminer son point de départ. La Cour de cassation juge que, lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Dans des arrêts antérieurs, la chambre sociale avait déjà jugé que le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où le salarié avait eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’avait pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (Cassation n° 10-30.664 ; Cassation n° 11-26.901 ; Cassation n° 13-16.840).
A notre avis : Ainsi, sauf en cas de rupture du contrat de travail, le délai de prescription ne court pas tant que l’employeur n’annexe pas le document d’information au bulletin de paie. En revanche, lorsque l’employeur remet ce document mensuellement, le délai de prescription court à compter de cette remise pour la période considérée.
L’action en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement…
L’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 22-22.860 concerne un salarié licencié le 3 septembre 2018. Estimant avoir subi un harcèlement moral, il saisit la juridiction prud’homale le 14 février 2020 en nullité de son licenciement pour harcèlement et dommages-intérêts pour licenciement nul, soit plus de 12 mois après la rupture du contrat de travail. La cour d’appel applique la prescription annale de l’article L 1471-1, al. 2 et déclare son action prescrite. La décision est censurée.
En l’espèce, la cour d’appel a repoussé le point de départ du délai de 12 mois pour agir en contestation de la rupture. L’employeur n’ayant pas produit l’accusé de réception de la lettre de licenciement, les juges d’appel considèrent que le point de départ est constitué par la date de la lettre de contestation adressée le 20 novembre 2018 par le salarié.
… se prescrit par 5 ans…
La Cour de cassation rappelle que, si la prescription annale s’applique aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, son application est exclue lorsque l’action est exercée sur le fondement d’un harcèlement. Aussi, l’action en nullité du licenciement est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil lorsque le licenciement trouve son origine dans une situation de harcèlement moral subi sur le lieu de travail.
… à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son action
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Mais la chambre sociale ne précise pas ici explicitement le point de départ de l’action en nullité du licenciement fondé sur le harcèlement moral allégué.
A notre avis : La chambre sociale a posé pour principe que le point de départ du délai de prescription est la date du prononcé du licenciement, qui constitue le dernier acte de l’auteur présumé du harcèlement (Cassation n° 19-21.931). Elle a ensuite précisé que le délai court à compter du dernier fait incriminé commis avant la cessation du contrat de travail (Cassation n° 21-24.051). En l’espèce, le point de départ serait-il fixé à la date de la notification du licenciement ou à celle de la lettre de contestation du licenciement par le salarié puisque la date certaine de notification du licenciement n’est pas connue ? Dans les deux cas l’action serait recevable.
Les salariés victimes de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié ont droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire (article L 8223-1 du code du travail). Dans l’affaire n° 22-22.860, la Cour de cassation se prononce également sur le régime de prescription applicable à cette indemnité.
L’action en indemnité pour travail dissimulé est soumise à la prescription biennale…
En l’espèce, le salarié, licencié le 3 septembre 2018, engage, contre son employeur, une action judiciaire en paiement de l’indemnité forfaitaire le 14 février 2020. L’employeur reproche à la cour d’appel d’avoir accédé à cette demande. Il fait valoir que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois, en application de l’article L 1471-1, al. 2 du Code du travail, et que c’est donc cette prescription annale qui doit s’appliquer dans la mesure où le paiement de ladite indemnité est subordonné à la rupture de la relation de travail.
Cette analyse n’est pas retenue par la Cour de cassation. Après avoir rappelé le principe selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, elle décide que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise à la prescription biennale de l’article L 1471-1, al. 1er du Code du travail en retenant que le droit à l’indemnité naît en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations au cours de la relation de travail (Cassation n° 14-17.955 ; Cassation n° 14-15.611). La prescription applicable est donc celle concernant l’exécution du contrat de travail.
A noter : La solution retenue est conforme à l’avis de l’avocate générale, Mme Molina. Celle-ci considère, notamment, que « l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, qui indemnise le salarié victime de travail dissimulé, tend uniquement à réparer la dissimulation d’emploi, consécutive à une faute de l’employeur survenue au cours de la relation de travail et non à la rupture du contrat de travail ». Elle ajoute que « la rupture du contrat de travail, nécessaire pour le versement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, n’est qu’une condition et non le fondement de la demande. Cette condition ne change pas la nature de sanction de l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations au cours de la relation de travail, et donc durant l’exécution du contrat de travail. L’indemnité réparant un préjudice subi du fait de la dissimulation d’emploi salarié et non du fait de la rupture du contrat de travail, la prescription biennale est applicable à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ».
Et son point de départ est fixé à la date de rupture du contrat
La Cour de cassation précise par ailleurs, à cette occasion, que l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat de travail. Elle confirme ainsi que le point de départ de la prescription de 2 ans correspond à la date de rupture du contrat (Cassation n° 04-42.608). En l’espèce, le salarié pouvait saisir le juge jusqu’au 3 septembre 2020. Son action introduite le 14 février 2020 était donc recevable.

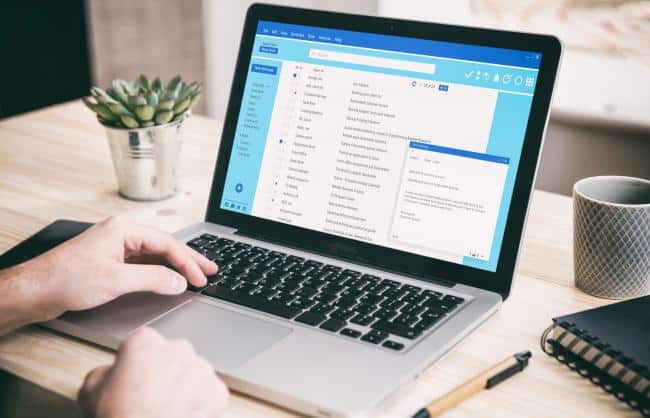
La renonciation par courriel à la clause de non-concurrence n’est pas valable si une lettre recommandée est exigée
Le contrat de travail peut prévoir la faculté pour l’employeur de renoncer à une clause de non-concurrence, dans un certain délai à compter de la rupture. Cette renonciation ne produit aucun effet et l’employeur est tenu de payer la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence imposée au salarié s’il renonce tardivement à la clause (Cassation n° 98-42.290). Qu’en est-il s’il ne respecte pas le formalisme afférent à cette renonciation, qui doit survenir le plus souvent par lettre recommandée avec avis de réception ?
La chambre sociale de la Cour de cassation juge (pourvoi n° 22-17.452), par cet arrêt du 3 juillet 2024, que l’employeur qui souhaite renoncer à la clause de non-concurrence est tenu de le faire selon les modalités prévues par cette clause, sous peine d’invalidité de la renonciation. Ainsi, il ne peut suppléer l’envoi d’un courrier postal en recommandé avec demande d’avis de réception par un courriel. Cet arrêt, destiné à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, confirme un précédent (Cassation n° 19-18.399), pour en pérenniser la solution.
A noter : il ne paraît cependant pas remettre en question la jurisprudence selon laquelle une renonciation à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement elle-même serait valable, quand bien même les dispositions conventionnelles prévoiraient l’envoi d’une lettre recommandée dans un certain délai après la notification du licenciement (Cassation n° 11-26.007).
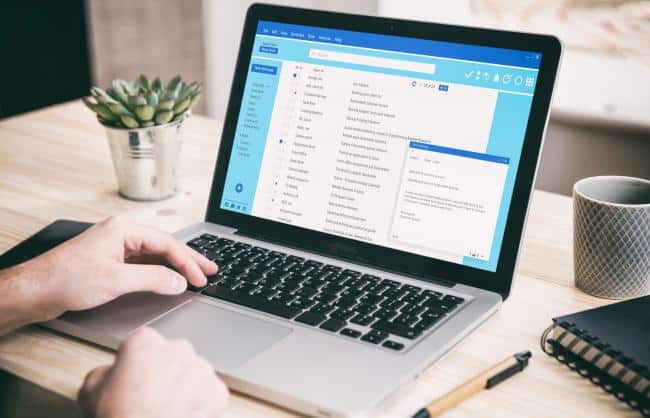

Quelle durée pour la période d’essai quand plusieurs CDD précèdent un CDI ?
Lorsqu’après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) un salarié est embauché, sans délai, par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par le même employeur et pour le même poste, la durée de ce CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau CDI. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du CDD (article L 1243-11, al. 2 et 3 du code du travail). Selon la jurisprudence, cette règle s’applique également lorsque plusieurs CDD se sont succédés avant l’embauche en CDI, et même lorsque les différents CDD sont séparés par de courtes périodes d’interruption ; dans ce cas, la durée de la période d’essai du CDI doit être réduite de la durée de ces différents CDD (Cassation n° 12-12113). La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler cette règle et même d’aller un peu plus loin dans son analyse.
En revanche, sauf fraude à la loi, l’employeur n’a pas à réduire la durée de la période d’essai du nouveau CDI si le nouvel emploi correspond à un emploi différent exigeant des qualités et des compétences différentes (Cassation n° 89-45508).
Une salariée infirmière diplômée d’État a été engagée par trois CDD, du 18 au 31 mai 2017, du 1er au 30 juin 2017 et du 1er au 30 août 2017, puis par un CDI le 4 septembre 2017 qui prévoyait une période d’essai de deux mois. L’employeur a notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai le 15 septembre 2017. La salariée a saisi le juge prud’homal d’une demande d’inopposabilité de la période d’essai et de requalification de la rupture de son CDI en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a fait valoir que l’employeur ne pouvait pas lui imposer une période d’essai de deux mois alors qu’elle avait déjà occupé son emploi durant deux mois et demi en CDD. Malgré la brève interruption de la relation de travail en juillet 2017, l’employeur devait réduire la période d’essai du CDI de la durée globale de l’ensemble de ses CDD.
En appel, les juges l’ont débouté de sa demande. Ils ont considéré que les deux premiers CDD ne se trouvaient pas dans la continuité du troisième CDD et du CDI conclu à sa suite en raison de l’interruption d’un mois entre le deuxième et le troisième CDD, intervenue en juillet 2017. Seule la durée du CDD du 1er au 30 août devait être déduite de la période d’essai qui expirait le 4 octobre 2017. L’employeur, qui a rompu la période d’essai par lettre du 17 septembre 2017, se trouvait encore dans le délai pour le faire.
La Cour de cassation (n° 23-10.783) a censuré la décision des juges. Sur le fondement de l’article L 1243-11, elle a rappelé que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou de plusieurs CDD, la durée du ou de ces CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI. Elle a déclaré que la salariée avait exercé, depuis le 18 mai 2017, en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle. La même relation de travail s’était poursuivie avec l’employeur depuis le 18 mai 2017. Ainsi, la durée des trois CDD devait être déduite de la période d’essai.
Lorsqu’à l’expiration d’un ou de plusieurs CDD, la relation de travail se poursuit par la conclusion d’un CDI sur le même emploi, la durée des CDD doit être déduite de la période d’essai prévue par le CDI, et peu importe que les CDD aient été espacés d’un mois. Ce qui importe c’est la continuité fonctionnelle entre les différents contrats.


La Cour de cassation se penche sur l’indemnité pour licenciement abusif d’un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté
Dans le cadre d’un litige relatif à un licenciement, à défaut d’accord entre des parties, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le juge doit justifier dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie (article L 1235-1 du code du travail).
Le salarié qui est licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Cassation n° 20-19.524).
Si le licenciement d’un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Dans le cas où le salarié n’est pas réintégré, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, le juge doit accorder au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est fixé par un barème d’indemnisation. Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité est compris entre des montants minimaux (planchers) et des montants maximaux (plafonds). Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le barème ne fixe que le montant minimal de l’indemnité (article L 1235-3 du code du travail). Les planchers et les plafonds des barèmes varient en fonction du salaire mensuel brut du salarié et de son ancienneté dans l’entreprise. Ces barèmes d’indemnisation s’imposent au juge (Cassation n°s 21-15.247 et 21-14.490).
En dessous d’un an d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, les barèmes ne fixent aucun montant minimal de l’indemnité. Dans ce cas, c’est le juge qui fixe le montant de l’indemnité, en appréciant la situation concrète du salarié et en prenant en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié.
Un salarié engagé le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial par une entreprise comptant moins de 11 salariés a été licencié pour faute grave moins d’un an après son embauche, le 3 avril 2018. Le salarié a réclamé en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, les juges ont considéré, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, le salarié qui bénéficie d’une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de 11 salariés ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation estimant qu’en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui bénéficie d’une ancienneté inférieure à un an se voit octroyer, lorsqu’il ne bénéficie pas d’une réintégration, une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire brut, quel que soit le nombre de salariés employés par l’entreprise.
La Cour de cassation (n° 23-11.825) a donné raison au salarié. Elle a rappelé que si le salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge doit octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié. Pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire. Il en résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à accorder au salarié.


Les dossiers sociaux qui attendent le nouveau gouvernement
► Enjeu : le gouvernement Barnier prendra-t-il de nouvelles orientations sur l’assurance chômage ? Après plusieurs semaines d’hésitation, Gabriel Attal avait décidé de suspendre sa réforme de l’assurance chômage censée entrer en vigueur le 1er décembre 2024.
► Pistes envisageables : les organisations syndicales étant fermement opposées à ce projet, elles feront savoir au gouvernement leurs revendications, par exemple un abaissement de la condition d’affiliation côté CFDT et l’agrément de l’accord négocié au sein de l’Unédic en novembre 2023 pour Force Ouvrière. Pour l’instant, un décret a prorogé le régime antérieur au projet de réforme jusqu’au 31 octobre. Il pourrait être de nouveau suspendu le temps d’y voir plus clair et de rencontrer les partenaires sociaux.
Se posera également la question du régime de bonus-malus sur les cotisations chômage des employeurs utilisant des contrats courts. Le dispositif a lui aussi été reconduit jusqu’au 31 octobre mais le précédent gouvernement prévoyait de revoir les secteurs concernés après des rencontres avec les syndicats. Rappelons également qu’un pan de la réforme a consisté à supprimer les allocations chômage aux salariés abandonnant leur poste. Le gouvernement Attal avait également annoncé la suppression de l’allocation spécifique de solidarité (AS) pour les chômeurs en fin de droit avant de finalement y renoncer. Enfin, les inspections des finances et des affaires sociales ont rendu un rapport préconisant de réaliser 610 millions d’économies sur les crédits de soutien aux demandeurs d’emploi dès 2025.
► Débat parlementaire : à défaut d’ouverture, en septembre, d’une session extraordinaire, la nouvelle session ordinaire débutera le 1er octobre, journée choisie par la CGT, la FSU et Solidaires pour leur mobilisation.
► Enjeu : après la dernière réforme de 2023 qui a rencontré une forte opposition syndicale et populaire pendant six mois de mobilisation, le gouvernement devra trancher entre un statu quo et une réouverture explosive du dossier. Les organisations syndicales vont demander à Michel Barnier une abrogation de la réforme, à savoir principalement la suppression de l’âge légal de départ à 64 ans et de l’allongement de la durée de cotisation. Le nouveau Premier ministre a d’ailleurs précisé qu’il était prêt à « améliorer » le texte et souhaitait rencontrer les centrales syndicales à ce sujet.
► Pistes envisageables : Il est cependant peu probable qu’il tente de revenir sur les fondamentaux de la réforme à savoir l’âge légal de départ à 64 ans. Le sujet sera sans doute inflammable pour le gouvernement si différentes forces politiques décident d’unir leurs forces à l’Assemblée en ce sens.
► Débat parlementaire : ce sujet pourrait mettre le gouvernement en difficulté devant l’Assemblée nationale. Le 31 octobre, le Rassemblement national consacrera sa journée de niche parlementaire au réexamen de la réforme des retraites, une réforme que la gauche et le groupe Liot souhaitent aussi abroger.
► Enjeu : les salaires et le pouvoir d’achat figurent en haut des préoccupations des Français en raison de l’inflation. Il sera difficile pour le gouvernement de ne pas y répondre. Parmi les revendications de l’intersyndicale figure la question de l’augmentation des salaires grignotés par l’inflation. Alors que les primes Macron se font une place dans les sujets de négociation dans les entreprises, les syndicats sont déterminés à œuvrer en commun pour le pouvoir d’achat des salariés. Ils pousseront également en faveur d’une augmentation du Smic au-delà de la seule revalorisation automatique liée à l’inflation.
► Pistes envisageables : s’il y a peu de chances que le gouvernement Barnier n’accède aux vœux du nouveau Front Populaire et des syndicats en matière de salaires, le gouvernement Attal aurait laissé à Michel Barnier un projet de refonte des exonérations patronales de cotisations autour du Smic. Les dispositifs existants seraient fusionnés en un système unique et dégressif à hauteur de 3 Smic au lieu de 3,5. La mesure serait issue du rapport Bozio-Wasmer demandé en son temps par Élisabeth Borne. Enfin, pendant la campagne des élections législatives, Gabriel Attal avait évoqué des évolutions de la prime de pouvoir d’achat (« prime Macron »). Il proposait de porter son plafond à 10 000 euros annuels (au lieu de 6 000) et de pouvoir en mensualiser le versement. Reste à voir si Michel Barnier reprendra l’idée.
► Débat parlementaire : si le Nouveau Front populaire poussera en faveur de hausses de salaires et d’un Smic à 1 600 euros net par mois, le gouvernement sera peut-être attiré par les propositions de l’ex majorité et de la droite autour de primes défiscalisées.
► Enjeu : redresser les comptes au regard de la baisse de recettes fiscales, de l’augmentation du déficit (peut-être 5,6 % du PIB pour 2024) et de l’augmentation des dépenses d’arrêt maladie, tout en apportant un début de solution au problème de pouvoir d’achat et à la situation du secteur de la santé (hôpitaux, Ephad…).
► Pistes envisagées ou envisageables :
- des coupes budgétaires (Gabriel Attal a envoyé cet été des lettres plafonds aux ministères comprenant des coupes de crédits comme -11 % pour les crédits emploi et travail de 2024 au ministère du travail, et l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection des finances préconisent de réaliser 610 millions d’euros d’économies sur les crédits de l’accompagnement à l’emploi dès 2025 et 1,8 milliards d’économie sur la période 2025-2027) ;
- une possible remise en cause de l’absence d’augmentation des impôts (Michel Barnier a dit ne pas s’interdire davantage de justice fiscale) afin de bénéficier de davantage de rentrées fiscales. Bruno Le Maire a suggéré deux mesures urgentes : la taxation des rachats d’action et une nouvelle contribution des énergéticiens. D’autres pistes pourraient être débattues : taxation des ménages les plus aisés, augmentation de l’impôt sur les sociétés…
- des changements en matière d’arrêts de travail afin d’en limiter la croissance ;
- une refonte des cotisations sociales afin de permettre une hausse du revenu net sur les feuilles de paie (voir ci-dessous), etc.
► Débat parlementaire : si la droite devrait insister sur la maîtrise et la réduction des déficits et sur la revalorisation du travail, la gauche devrait mettre en avant son programme : refonte de l’impôt sur le revenu, conditionnement des aides aux entreprises, hausse du Smic, conférence sociale sur les salaires…
► Enjeu : l’assurance maladie s’inquiète d’une très forte progression du nombre des arrêts maladie en 2024, dont le coût pourrait atteindre 16 milliards d’euros cette année. L’an dernier, le projet de budget de la sécurité sociale avait déjà limité la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation.
► Pistes envisagées : renforcement des contrôles des arrêts de travail, imposition de jours de carence supplémentaire (autrement dit, un délai supplémentaire entre le jour de déclaration de l’arrêt et le début de son indemnisation). Le directeur de la Cnam plaide aussi, dans une interview aux Echos, en faveur d’un nouveau système d’indemnisation des arrêts de travail « plus soutenable financièrement mais aussi plus juste ». Dans l’immédiat, la Cnam va renforcer ses contrôles.
► Débat parlementaire : si un texte voit le jour sur ce sujet au sein du PLFSS, nul doute que le débat sera vif au parlement, certains députés pourraient relayer le constat des organisations syndicales, à savoir que l’intensification du travail et l’allongement de la vie active sont à l’origine de la hausse du nombre d’arrêts.
► Enjeu : la situation française reste préoccupante quant aux nombres d’accidents du travail, et notamment des accidents de travail mortels.
► Pistes envisagées : jusqu’à présent, les gouvernements Borne et Attal avaient annoncé une campagne de communication (réalisée en 2023) ainsi qu’un plan d’action afin de prévenir ces accidents à élaborer après une conférence sociale. A noter que les partenaires sociaux ont proposé, en juin 2024, de nouvelles règles de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles, à la suite de la controverse sur l’article 39. En résumé, si aucun changement n’est à prévoir pour le préjudice professionnel, l’incapacité personnelle serait évaluée selon le barème du concours médical et une nouvelle indemnisation serait calculée selon le référentiel Mornet, utilisé par les juges civils dans le contentieux de la réparation du dommage corporel. Le législateur reprendra-t-il ces pistes dans le prochain PLFSS ?
► Débat parlementaire : là encore, le clivage droite-gauche pourrait se manifester. Si l’exécutif met en pratique le plan d’action promis par Gabriel Attal lors des législatives, la gauche pourrait relancer son idée de restaurer un CHSCT indépendant et d’inscrire les risques psychosociaux dans le tableau des maladies professionnelles reconnues.
► Enjeu : la précédente majorité relative et son gouvernement avaient relancé l’idée d’une nouvelle simplification des obligations des entreprises mais aussi, pour l’automne, d’un nouvel acte de la réforme du code du travail après les ordonnances de 2017. Un rapport parlementaire suggérait même un relèvement des seuils sociaux qui aurait eu de fortes conséquences sur les prérogatives des CSE. Le projet avait aussi repris la demande de la CPME d’un test PME avant toute législation concernant les petites entreprises, une disposition écartée par le Conseil d’Etat. Autre idée évoquée par l’ancien ministre de l’économie, dont le directeur de cabinet Jérôme Fournel dirige aujourd’hui le cabinet de Michel Barnier : réduire le délai dont dispose un salarié pour contester son licenciement. Enfin, Gabriel Attal avait évoqué l’idée de confier davantage de négociations au niveau de l’entreprise.
► Pistes envisagées : Michel Barnier reprendra-t-il ces idées ? Nul ne le sait. Mais dans sa première interview à TF1, le 6 septembre, il a évoqué « l’inflation normative » qui pénalise selon lui l’entreprise. La dissolution a en tout cas mis un coup d’arrêt à l’examen par l’Assemblée d’un projet de loi sur la simplification qui comprenait notamment la réduction de deux à un mois du délai d’information préalable des salariés en cas de vente de fonds de commerce.
► Débat parlementaire : le clivage gauche-droit est bien réel sur cette question. L’ancienne majorité et le Rassemblent national pourraient s’accorder sur des mesures de simplification pour les entreprises. A l’inverse, la gauche prône un élargissement du droit d’intervention des salariés dans l’entreprise et un rétablissement du CHSCT.
► Enjeu : juguler le déficit de France compétences, estimé à plus d’un milliard d’euros, en 2024.
► Pistes envisagées : dans le cadre de la revue des dépenses, transmis aux parlementaires, le 4 septembre, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’Inspection générale des finances IGF) identifient 1,5 milliard d’euros d’économies potentielles et 421 millions de recettes supplémentaires. Parmi les propositions chocs, la suppression de l’aide à l’apprentissage pour les niveaux 6 (licence) et 7 (master) ; la taxation des revenus des apprentis ; une réforme systémique des niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage ; une redynamisation de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (pour les entreprises de plus de 250 salariés qui embauchent moins de 5% d’apprentis) ainsi qu’un meilleur ciblage du FNE-formation (Fonds National pour l’Emploi-Formation).
► Débat parlementaire : si aucun projet de loi ne semble se profiler en matière de formation professionnelle, des ajustements pourraient se fondre dans le PLF pour 2025. Les partis politique se sont peu exprimés sur cette question pendant la campagne des élections législatives, hormis Renaissance. Dans son programme, le Nouveau front populaire insistait, lui, davantage sur un droit « renforcé » et « non bradé à l’entreprise », c’est-à-dire sur une remise en cause probable du co-financement entreprise/salarié du compte personnel de formation.
► Enjeu : améliorer le taux d’emploi des seniors pour permettre aux plus âgés de quitter le marché du travail au moment de la liquidation de leur retraite à taux plein. Pour ce faire, les partenaires sociaux, Medef et U2P en tête, sont partants pour relancer les négociations sur les salariés expérimentés après l’échec des discussions sur le pacte de la vie au travail, en avril dernier. L’U2P souhaite également élargir la discussion à l’allègement du coût du travail. Reste toutefois deux inconnues : quel sera le sort réservé à cette négociation, si un compromis se dessine et quid des projets d’accords finalisés, en mai, sur le compte épargne-temps universel (Cetu) et les transitions professionnelles, sans l’aval du Medef et de la CPME ? L’U2P a mené seul ces discussions. Le gouvernement Attal avait prévu d’inscrire ces trois sujets dans une future loi travail qui devait être présentée à l’automne à l’Assemblée nationale. Le nouvel exécutif devra trancher.
► Pistes envisagées : Plusieurs axes de discussion pourraient être au menu des prochains échanges sur l’emploi des seniors, à savoir le vieillissement de la population active, la pénibilité, les fonds de péréquation en matière d’inaptitude notamment ou encore les carrières longues.
► Débat parlementaire : si le sujet semble assez consensuel, plusieurs partis politiques, notamment la gauche et le RN, pourraient profiter de cette porte ouverte pour relancer le débat sur l’abrogation de la réforme des retraites et réaffirmer leur opposition à l’allongement de la vie active.
Quant au Cetu, il ne figure pas au programme du Nouveau front populaire mais il pourrait être défendu par Renaissance.
► Enjeu : permettre davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail, de façon aussi à attirer les candidats vers les entreprises, via une politique incitative.
► Pistes envisagées : L’idée avait été avancée par Gabriel Attal, lors des législatives, d’une expérimentation dans le privé de la semaine de 4 jours de travail, pour permettre » aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler de bénéficier eux aussi d’un jour de repos supplémentaire ». Le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée mène une mission sur le sujet.
► Débat parlementaire : si un tel projet était présenté, on peut s’attendre à des débats sur la facilitation de la vie quotidienne, côté positif, mais aussi, côté négatif, sur le risque d’intensification du travail liée à la suppression d’un jour de travail sans aménagement des objectifs ni recrutements.
► Enjeu : A l’issue de la conférence sociale du 16 octobre 2023, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait annoncé son intention de construire un Index de l’égalité professionnelle « plus ambitieux, plus transparent, plus fiable » qui devait permettre d’anticiper la transposition de la directive européenne du 10 mai 2023. Laquelle prévoit l’obligation de communiquer des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’ici le 7 juin 2026.
► Pistes envisagées : la Première ministre avait donc donné 18 mois aux partenaires sociaux pour réviser ce dispositif. Parmi les axes de réforme, créer un nouvel indicateur sur la répartition femmes-hommes des 10 % des rémunérations les moins élevées ; retravailler l’indicateur sur le taux de promotion des salariés ; réviser la marge de tolérance de 5% admise pour calculer les écarts de rémunération entre les sexes ; renforcer les sanctions aux entreprises ou encore utiliser les pénalités pour abonder un fond de promotion de l’égalité
► Débat parlementaire : si le Nouveau Front populaire veut mettre l’égalité professionnelle en avant, il n’a pas mentionné dans son programme, un nouveau texte législatif, insistant pour que les lois existantes soient d’abord appliquées. Le RN s’érige lui aussi en défenseur des droits des femmes. Mais en mai 2023, selon Le Monde, les eurodéputés avaient choisi de s’abstenir ou avaient voté contre la directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations, arguant que ces nouvelles règles ajoutaient une charge supplémentaire pour les petits employeurs. Ce même argument avait été repris par François-Xavier Bellamy (Les Républicains, LR) qui s’y était également opposé.
► Enjeu : annoncé mi-janvier par le chef de l’Etat, le projet de congé parental, destiné aux deux parents, devait encourager plus de pères à prendre un congé et réduire l’impact sur la carrière professionnelle des mères. En 2021, seulement 0,8 % des pères avaient pris ce congé, contre 14 % des mères.
► Pistes envisagées : le projet propose un nouveau congé mieux rémunéré mais plus court, chaque parent percevrait 50 % du salaire plafonné à 1 900 euros par mois pour une période de trois mois. Ce nouveau dispositif coexisterait avec l’actuel congé parental offrant ainsi aux familles plus de flexibilité selon leurs besoins financiers et professionnels. Des concertations ont été lancées en mai dernier, avec les syndicats, les élus et les associations familiales sur la future réforme. Mais plusieurs questions restent à trancher : devra-t-il remplacer l’actuel congé parental ou être une alternative ?
► Débat parlementaire : Le dispositif pourrait trouver sa traduction juridique dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS). Si la gauche pourrait reprendre à son compte les critiques syndicales tant sur le montant de l’indemnisation que sur sa durée, le Rassemblement national et Les Républicains n’en font pas mention dans leur programme.
► Enjeu : le nouveau Premier ministre s’était prononcé en faveur d’une maîtrise des flux migratoires, voire d’un gel de ces flux. Voudra-t-il aller plus loin que la dernière loi sur l’immigration ? C’est ce qu’attend de lui le Rassemblement national, la droite réclamant également un texte législatif reprenant les dispositions de la dernière loi censurées par le Conseil constitutionnel.
► Pistes envisagées : une reprise des textes censurés par le Conseil constitutionnel pourrait être envisagée par l’exécutif, mais le débat promet d’être très tendu.
► Débat parlementaire : alors que la loi sur l’immigration avait grandement fragilisé la majorité relative dont disposait, avant la dissolution, Emmanuel Macron, les échanges pourraient être indécis en cas de nouveau projet législatif. Roland Lescure, l’ancien ministre de l’industrie, s’est déclaré, dans Libération, favorable à une immigration de travail et hostile à tout gel migratoire.
♦ Toujours sur les sujets sociaux, d’autres projets de loi et propositions de loi lancés ou évoqués avant la dissolution pourraient, ou non, resurgir comme :
- le projet d’un bulletin de salaire simplifié dans le cadre du projet de loi sur la simplification ;
- la proposition de loi visant à davantage recourir au testing pour prévenir les discriminations ;
- la proposition de loi visant à interdire les discriminations capillaires ;
- la proposition de loi visant à « reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail »;


Ne pas respecter les temps de pause et faire travailler un salarié durant un arrêt maladie lui cause automatiquement un préjudice
Depuis quelques années, la jurisprudence tend à relativiser la notion de préjudice causé au salarié du fait du manquement de l’employeur à certaines obligations. Là où ce préjudice était auparavant « automatiquement » établi du seul fait du manquement, la situation est aujourd’hui plus nuancée, la jurisprudence exigeant dans certains que le salarié démontre ce préjudice pour prétendre à réparation.
Elle en a déjà donné une illustration dans un autre arrêt du 4 septembre dernier, s’agissant d’une salariée reprochant à son employeur de lui avoir demandé d’accomplir une tâche professionnelle au cours de son congé maternité, et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une visite médicale à la suite de ce congé.
Dans l’affaire commentée ici, une salariée demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour divers motifs.
Elle sollicitait notamment une indemnisation pour manquement à la réglementation sur la durée du travail, l’employeur n’ayant pas respecté la règle des 20 minutes de pause obligatoire dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
► Ce principe est par ailleurs clairement énoncé par l’article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003.
Elle avait en effet l’habitude d’accomplir 10h30 de travail en continu tous les lundis, ces heures étant enregistrées et compensées (paiement d’heures supplémentaires et/ou repos compensateurs), ce dont elle ne s’était, selon l’employeur, jamais plainte. Les juges du fond rejettent la demande de la salariée, du fait qu’elle ne démontrait pas en avoir subi un quelconque préjudice.
Mais les juges de cassation ne sont pas de cet avis : le seul constat du non-respect des règles relatives aux temps de pause ouvre droit à réparation, sans que la salariée ait à établir la réalité de son préjudice.
Une décision somme toute logique compte-tenu des décisions déjà rendues – dans le même sens – en matière de repos hebdomadaire ou de dépassement des durées maximales de travail (arrêt du 7 février 2024).
La salariée reprochait également à son employeur de l’avoir fait travailler alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, la faisant venir à trois reprises sur son lieu de travail pour y accomplir, ponctuellement et sur une durée limitée, une tâche professionnelle. Là encore, il arguait du fait que la salariée ne s’en était pas plainte et là encore, la cour d’appel avait rejeté sa demande du fait de l’absence de préjudice démontré.
Et là encore, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : l’employeur faisant travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie commet un manquement ouvrant automatiquement droit à réparation. Une décision logique et conforme à la position prise ce même 4 septembre dans l’affaire du congé maternité.

